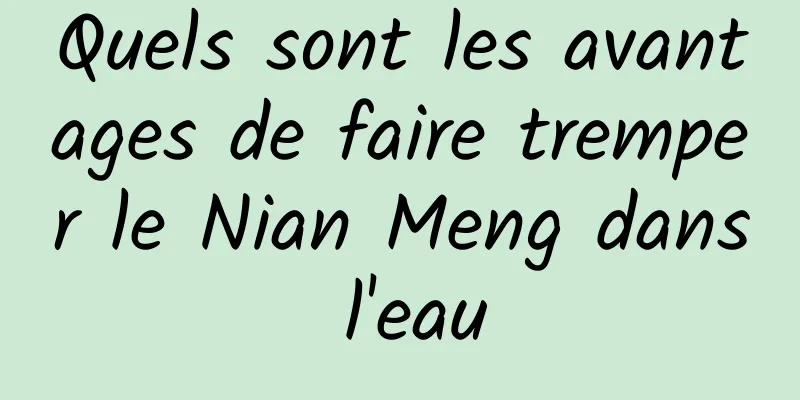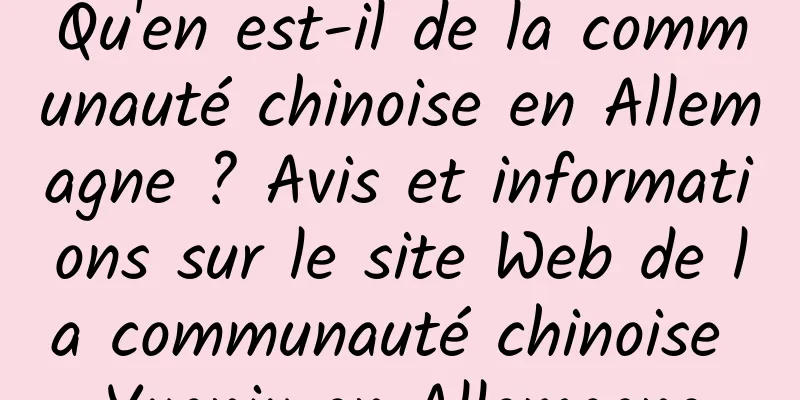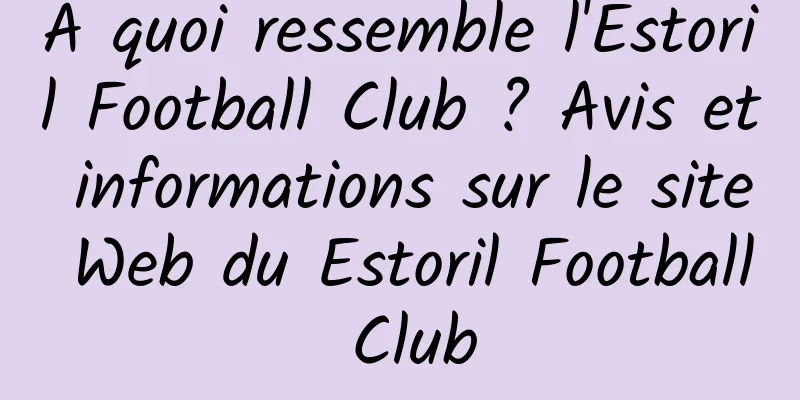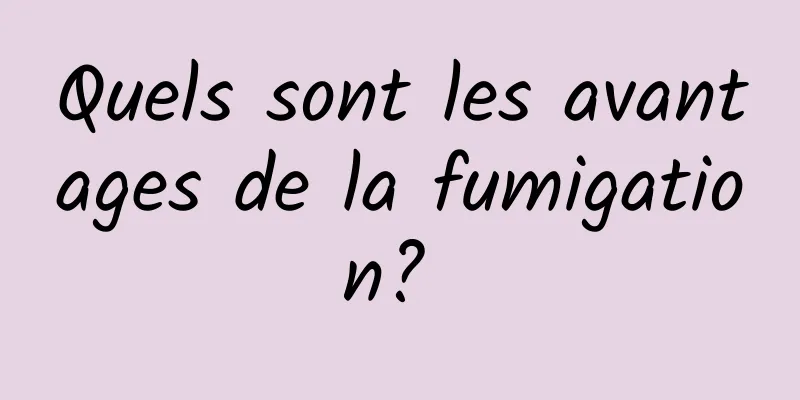Tu es un gars sympa, mais je ne sortirai pas avec toi.
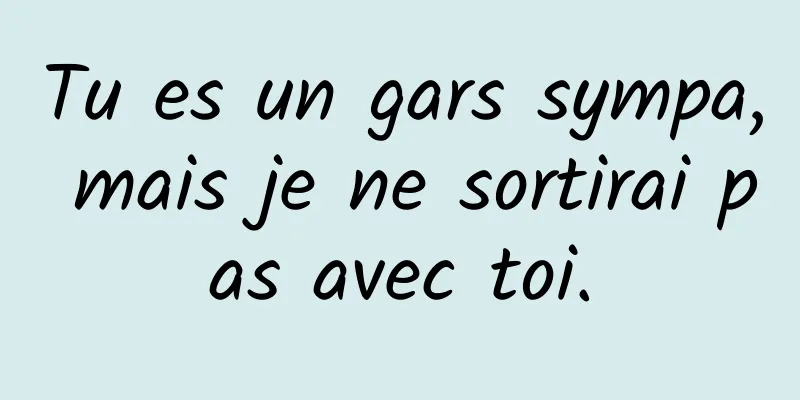
|
Presse Léviathan : Lorsque nous aidons un inconnu, comme un mendiant ou un enfant qui a abandonné l’école, s’agit-il d’une forme d’auto-kitsch ou d’un comportement purement altruiste ? Le premier sert principalement à satisfaire le besoin de se toucher (faire face à sa « compassion qui n’a nulle part où aller »), et si le second existe (l’altruisme), son essence est-elle encore l’égoïsme ? Autrement dit, les bonnes actions faites pour les autres contribuent en fin de compte à notre propre bien-être. Un ami a souligné qu'il existe un point de vue qui réfute l'égoïsme psychologique, selon lequel les sacrifices que font certaines personnes dépassent de loin les récompenses qu'elles reçoivent (par exemple, un prisonnier ne dénoncerait pas quelqu'un même s'il était torturé à mort), donc cela ne peut pas être entièrement expliqué par l'égoïsme psychologique. Bien sûr, c'est une autre question. Retour à cet article. Je crois que beaucoup de gens ont réfléchi à cette question : allons-nous tomber amoureux d’une personne au bon cœur ? Ou alors, vivriez-vous avec un conséquentialiste ? Il existe d’innombrables exemples de ce problème, comme celui d’un végétarien qui considère le bien-être des animaux comme aussi important que celui des humains, celui d’une personne qui pense que sauver des enfants non scolarisés revient à prendre soin de soi… Dans la série télévisée The Good Place, le personnage principal Eleanor en veut initialement à Chidi parce qu'il essaie toujours de lui apprendre à être une bonne personne. C’est pourquoi tout le monde déteste le gardien moral qui aime être un prédicateur. © Colleen Hayes/NBC/NBCU Photo Bank via Getty ImagesImaginez ceci : vous avez travaillé dur toute l’année. Tu es épuisé. Votre cerveau et chaque cellule de votre corps ont désespérément besoin de vacances reposantes. Heureusement, vous et votre partenaire avez réussi à économiser 3 000 $. Vous proposez un voyage à Hawaï : les eaux bleues vous appellent ! Il y a juste un problème : votre partenaire refuse et pense que vous devriez plutôt donner l'argent à une œuvre caritative. Pensez simplement au nombre de moustiquaires antipaludiques que 3 000 dollars pourraient permettre d’acheter pour les enfants des pays en développement ! Vous pourriez commencer à vous poser une question : pourquoi mon partenaire semble-t-il se soucier davantage d’un inconnu à l’autre bout du monde que de moi ? Les philosophes vous diront que votre partenaire est probablement un utilitariste ou un conséquentialiste, quelqu’un qui croit qu’une action est morale si elle produit de bonnes conséquences, et que tout le monde devrait bénéficier de manière égale de ces conséquences, pas seulement ceux qui nous sont les plus proches. En revanche, votre réponse suggère que vous êtes un déontologiste, qui croit qu’une action est morale si elle remplit un devoir, et que nous avons certains devoirs envers certaines personnes – nos conjoints, par exemple – et que nous devrions donc donner la priorité aux besoins de nos conjoints plutôt qu’à ceux des étrangers. Si vous êtes agacé par les réactions conséquentialistes aux vacances hawaïennes, vous n’êtes pas seul, selon une étude du Crockett Lab de l’Université de Yale. La neuroscientifique Molly Crockett a mené plusieurs études pour déterminer comment nous percevons différents types d’agents moraux. Elle a découvert que lorsque nous recherchons un partenaire ou un ami, nous avons fortement tendance à choisir des déontologistes, les considérant comme plus moraux et dignes de confiance que les conséquentialistes. (www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022103117308181) En d’autres termes : si nous cherchons un rendez-vous ou un ami avec qui sortir, nous n’avons pas besoin de chercher plus loin les différentes personnes super-bienveillantes qui croient au conséquentialisme. (Il convient de noter que les déontologues peuvent également faire de bonnes actions tous les jours, mais d’une manière complètement différente.) Les recherches de Crockett soulèvent un certain nombre de questions : pourquoi nous méfions-nous des conséquentialistes alors que nous admirons leur altruisme ? Avons-nous raison d’être méfiants ou devrions-nous essayer de réprimer cette envie ? Que signifie cette méfiance pour le mouvement de l’altruisme efficace, qui soutient que nous devrions investir nos ressources dans des causes qui feront le plus de bien à l’humanité, où qu’elles se trouvent dans le monde ? J'ai contacté Crockett pour discuter de ces problèmes avec elle. Ce qui suit est une transcription de notre conversation, éditée pour plus de longueur et de clarté. Sigal Samuel : Autrefois, c’étaient généralement les philosophes qui étudiaient les questions de moralité et d’altruisme, et ils s’intéressaient particulièrement au dilemme du sacrifice. Le dilemme sacrificiel le plus célèbre est le problème du tramway : faut-il choisir activement de diriger un tramway en fuite de manière à ce qu'il tue une personne afin de sauver la vie de cinq personnes sur une autre voie ? Les conséquentialistes disent oui, car vous maximisez le bien général, et ce sont les résultats qui comptent. Les déontologues disent non, car vous avez le devoir de « ne pas tuer comme moyen d’arriver à une fin », et votre devoir est le plus important. Dans vos recherches, vous examinez ces types de dilemmes sacrificiels, qui impliquent de faire le mal. Mais vous examinez également le dilemme de la « bienfaisance impartiale », qui implique de faire le bien, et en particulier l’idée que lorsque nous faisons le bien, nous ne devrions pas donner la priorité à notre famille et à nos amis. Pourquoi avez-vous décidé de faire des recherches sur ces dilemmes ? Molly Crockett : Sur le plan psychologique, étudier la gentillesse impartiale est très enrichissant car cela va au cœur de nombreux conflits que nous rencontrons dans nos relations sociales à mesure que le monde devient plus globalisé et que nous commençons à réfléchir à la façon dont nos actions affectent les personnes que nous ne rencontrerons jamais. Aujourd’hui, pour être un citoyen du monde efficace, nous devons lutter contre la forte tendance psychologique à donner la priorité à la famille et aux amis. Nous avons donc voulu examiner les conséquences socio-interpersonnelles que les gens pourraient ressentir lorsqu’ils ont des opinions conséquentialistes. Ouest : Alors, qu'as-tu trouvé ? MO : Nous avons constaté qu’en général, lorsque les gens sont confrontés à un dilemme de sacrifice, ils privilégient clairement les partenaires sociaux non conséquentialistes. Si les gens disent que sacrifier une personne pour en sauver d’autres est mal, nous leur ferons davantage confiance. Nous observons le même schéma de préférences face au dilemme du « juste bon ». Cette tendance n’est pas aussi forte que dans le dilemme du sacrifice, ce qui me semble logique car, sur le plan psychologique, une action bénéfique a tendance à laisser une impression plus faible sur nous qu’une action nuisible. Mais nous constatons toujours que nous avons tendance à privilégier les non-conséquentialistes lorsque nous décidons avec qui nous voulons être amis ou avec qui nous associer. © phys.org SW : Il y a une exception au dilemme de la juste bienveillance, n’est-ce pas ? Il s’avère que lorsque nous recherchons un leader politique, nous préférons en réalité les conséquentialistes. Pour ma part, mon intuition est que nous préférons différents types d’agents moraux pour différents rôles sociaux. Vos résultats ont-ils été surprenants ? MO : Eh bien, il est intéressant de constater que, jusqu’à présent, la psychologie morale a principalement examiné des cas hypothétiques impliquant des inconnus. Mais de nouvelles recherches suggèrent qu’en réalité, le contexte relationnel est très important lorsqu’il s’agit de juger la moralité des autres. Récemment, j’ai commencé à travailler avec Margaret Clark à l’Université de Yale, qui est une experte en intimité. Nous testons certaines de nos hypothèses selon lesquelles les obligations morales sont propres à des relations interpersonnelles particulières. Voici un exemple classique : imaginons qu’une femme nommée Wendy pourrait facilement préparer un repas pour un jeune enfant, mais qu’elle ne le fait pas. Est-ce que Wendy a fait quelque chose de mal ? Cela dépend de qui est l’enfant. Si elle ne parvenait pas à fournir des repas à ses enfants, alors elle faisait quelque chose de mal ! Mais si Wendy est propriétaire d’un restaurant et que l’enfant ne meurt pas de faim, alors il n’y a pas de relation interpersonnelle particulière entre eux qui créerait pour elle une obligation particulière de nourrir l’enfant. Ouest : C’est vrai. La philosophie a horreur de la contradiction et de l’incohérence, et appliquer la déontologie dans certains cas et le conséquentialisme dans d’autres peut paraître contradictoire. Il peut toutefois être plus raisonnable d’appliquer différentes philosophies morales dans différents contextes relationnels. L'explication que vous donnez à travers vos recherches sur la raison pour laquelle nous préférons nous marier ou nous lier d'amitié avec des déontologues est la suivante : si je cherche quelqu'un avec qui me marier, alors je voudrais naturellement que cette personne me préfère à un étranger d'un autre pays. Mais poussons cette réflexion un peu plus loin : est-il possible que notre préférence ne soit pas due au fait que nous voulons quelqu’un qui nous donne la priorité, mais parce que le fait d’être entouré de personnes radicales et bienveillantes nous fait nous sentir mal dans notre peau ? —En d’autres termes, parce que nous nous sentons comme des connards immoraux comparés à eux ? MO : C’est une question très intéressante et quelque chose que nous n’avons pas encore testé empiriquement, mais elle est très cohérente avec les recherches du psychologue de Stanford Benoit Monin sur la dérogation envers les bienfaiteurs. Il a essentiellement montré ce phénomène que vous aviez prédit, à savoir que les gens ressentent moins de chaleur envers les personnes extrêmement morales et altruistes. Ses recherches suggèrent que la mesure dans laquelle les gens n’aiment pas les végétariens est liée à leurs propres sentiments à l’égard des conflits moraux que soulève la consommation d’animaux. (journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1948550611415695) © RNZ West : Oui, nous n'aimons généralement pas être entourés de personnes qui nous font ruminer sur des sujets inconfortables. Surtout s'ils sont très directs ou opiniâtres et que vous devez être avec eux tout le temps, comme s'ils étaient votre partenaire romantique. Vos recherches portent également sur ce que l’on appelle le modèle de choix du partenaire. Pouvez-vous expliquer cela un peu ? MO : La « sélection du partenaire » est un mécanisme par lequel les traits de personnalité évoluent parce que les traits évolués rendent les gens plus susceptibles d’être sélectionnés comme partenaires sociaux. De nombreuses études suggèrent que notre préférence pour la coopération a évolué grâce à un mécanisme de sélection du partenaire, car les personnes naturellement plus coopératives sont plus susceptibles d’être sélectionnées comme partenaires sociaux. Ils bénéficient d’une sélection par le biais du capital social et de la reproduction, puis transmettent ces traits à la génération suivante. Ce que je veux dire, c’est que certaines de nos intuitions morales peuvent s’expliquer par le même mécanisme. Dans la mesure où nos intuitions déontologiques indiquent aux autres que nous sommes de meilleurs partenaires sociaux, cela nous rend plus susceptibles d’être sélectionnés, et donc transmis à la génération suivante. Xi : Attendez, pouvez-vous développer un peu cette explication de l’évolution ? Lorsque vous dites « par la reproduction », voulez-vous dire que les parents qui ont des opinions déontologiques sont plus susceptibles d’élever leurs enfants de manière déontologique ? MO : C’est une chose, et une autre… c’est plus une spéculation, mais peut-être que les intuitions morales déontologiques ont une composante génétique, de sorte qu’elles peuvent être transmises héréditairement. De toute évidence, il n’existe pas de gène qui régisse les intuitions déontologiques. Il n’existe pas de correspondance exacte entre la génétique et les traits psychologiques complexes. Mais dans la mesure où ces traits découlent de processus cérébraux (et il existe de nombreuses preuves que c’est le cas), il peut y avoir une composante héréditaire. SW : Cela me rappelle le nouveau livre de la neurophilosophe Patricia Churchland, Conscience, qui parle des bases biologiques de la moralité. Récemment, Churchland et moi avons discuté de la manière dont les différences cérébrales façonnent nos positions morales et de la manière dont ces différences sont susceptibles d’être hautement héréditaires, étant donné qu’elles sont basées sur des différences génétiques. La génétique n’est donc pas tout, mais elle joue un rôle. MO : C'est tout à fait le cas. Dans l’ensemble, mes résultats sont très cohérents avec les vues de Churchland. Je pense que son point de vue est cohérent avec certaines de nos recherches empiriques montrant que lorsque les gens décident de se faire du bien en faisant du mal aux autres, leur activité cérébrale suit dans quelle mesure les autres les blâment pour ce choix néfaste. La conscience peut être la façon dont le cerveau prédit la façon dont les autres percevront notre comportement. Peter Singer : philosophe australien de renom, militant pour la libération animale, professeur de bioéthique à l'Université de Princeton et professeur honoraire au Centre de philosophie appliquée et d'éthique publique de l'Université de Melbourne, en Australie. Il se spécialise dans l’étude de l’éthique appliquée et réfléchit aux questions éthiques dans une perspective utilitaire. Il est connu pour son livre Libération animale et son essai Famine, Affluence et Moralité. © The Conversation SW : Lorsque vous écrivez sur les implications de vos recherches, vous parlez spécifiquement de l’altruisme efficace, un mouvement défendu par Peter Singer, qui est probablement le philosophe utilitariste le plus influent aujourd’hui. Vous dites que ces résultats suggèrent que si vous êtes un altruiste efficace, la perception que les gens ont de vous pourrait être un obstacle, et que cela pourrait affecter la capacité du mouvement à se développer. Que peuvent faire les altruistes efficaces pour atténuer les perceptions négatives potentielles d’eux-mêmes ? MO : Je pense qu’il y a plusieurs possibilités. Tout d’abord, voici le problème : nous avons montré dans d’autres recherches que lorsque les gens évaluent à quel point les bonnes actions sont admirables, ils prennent en compte à la fois les avantages de ces actions et le sentiment positif qu’ils ressentent lorsqu’ils les accomplissent. Nous pourrions même dire que nos données suggèrent que lorsque les gens jugent une action comme louable, ils accordent plus d’importance à la façon dont l’action fait sentir aux autres, à tel point que les gens pourraient penser que si un acte apporte très peu de bénéfice mais vous fait sentir très bien à l’intérieur, il est en fait plus louable qu’un acte qui semble détaché et froid mais apporte beaucoup de bénéfice. Dans cette perspective, les altruistes efficaces pourraient mettre l’accent sur la satisfaction personnelle qui pourrait découler du don à des causes efficaces et parler de leurs expériences personnelles de participation au mouvement, en utilisant ce contexte pour décrire ce que cela signifie pour eux. Maintenant, dans mon laboratoire, nous commençons à réfléchir beaucoup à la narration : comment les histoires que nous racontons sur nous-mêmes et sur le comportement des autres nous font-elles sentir comme des personnes morales ? Et comment ces histoires changent-elles réellement notre comportement à long terme ? Les récits sont très puissants pour façonner notre psychologie, et je pense que le mouvement de l’altruisme efficace a, d’une certaine manière, manqué l’occasion de les exploiter pour y parvenir. SW : Donc, si j'ai un récit sur moi-même qui souligne qu'une façon de donner qui a plus de preuves pour la soutenir, coûte moins cher et apporte plus de bénéfices me rend réellement heureux et épanoui, raconter ce récit pourrait rendre les gens plus intéressés par ma façon de faire le bien ? Mo : C’est possible. Bien sûr, raconter cette histoire pourrait entrer en conflit avec l’effet de dénigrement des bienfaiteurs. Il faut donc être prudent. Je pense que cette conversation illustre à quel point il est difficile de changer un comportement éthique. Vous pouvez essayer de changer de comportement en actionnant de nombreux « leviers » différents, mais ils entrent souvent en conflit les uns avec les autres. Ainsi, si vous appuyez sur un levier, il déplacera par inadvertance d’autres leviers, annulant ainsi son effet. Nous avons affaire à un système complexe. Par Sigal Samuel Traduit par Kushan Relecture/Les pas légers du lapin Article original/www.vox.com/future-perfect/2019/8/27/20829758/altruism-morality-molly-crockett-study-dating-do-gooders Cet article est basé sur l'accord Creative Commons (BY-NC) et est publié par Kushan sur Leviathan L'article ne reflète que les opinions de l'auteur et ne représente pas nécessairement la position de Leviathan |
<<: Qu'est-ce que l'anti-glycation ? Les produits anti-glycation sont-ils un gaspillage d’argent ?
>>: Il existe huit dimensions de la micro-santé ! L'article cellulaire définit la santé
Recommander des articles
Puis-je boire du vin si j'ai mal au ventre ?
Les personnes souffrant de problèmes d'estoma...
Comment éviter les « récifs » sur la route de la santé
Auteur : Zheng Yuan, Hôpital Bethune du Shanxi Ré...
Quelle est la raison de l'engourdissement du bout de l'annulaire
Il est très courant que nos membres ressentent un...
Qu'en est-il de Faraday Future ? Avis sur Faraday Future et informations sur le site Web
Quel est le site Web de Faraday Future ? Faraday F...
Rhinite ou rhume ? Ces symptômes doivent être distingués
Ces derniers temps, la différence de température ...
Quel type de médicament dois-je utiliser s'il y a des particules injectées de sang dans mes yeux
Parfois, lorsque des yeux injectés de sang appara...
Quels sont les symptômes de l'anthrax cutané ?
L'anthrax cutané est une maladie contagieuse ...
La bonne façon de faire tremper les concombres de mer dans un thermos
Les concombres de mer sont un mets délicat que no...
À quels problèmes faut-il prêter attention en cas d’hamartome rénal ?
En parlant d'hamartome rénal, je pense que be...
Le vinaigre est-il efficace pour éliminer le tartre ?
Dans notre vie quotidienne, nous utilisons souven...
Et que dirais-tu de Fairy Tail ? Critique et informations sur le site Web de « Fairy Tail »
Quel est le site Web de « Fairy Tail » ? « Fairy T...
Tout le monde félicite mon enfant parce qu’il est blanc, gros et mignon, mais qui sait, il est confronté à un risque énorme ?
Le mois de mars est arrivé et de nombreuses perso...
Comment traiter la polyarthrite rhumatoïde ?
La polyarthrite rhumatoïde est une maladie articu...
Le meilleur traitement pour les verrues plates, la combinaison de la médecine chinoise et occidentale donne de bons résultats
Les verrues plates sont plus fréquentes chez les ...