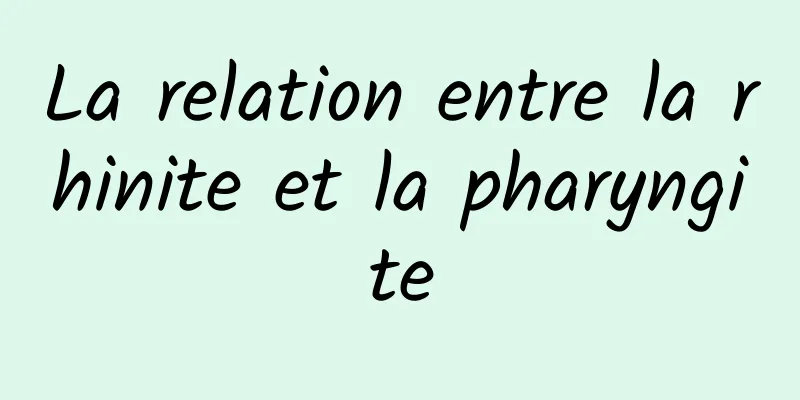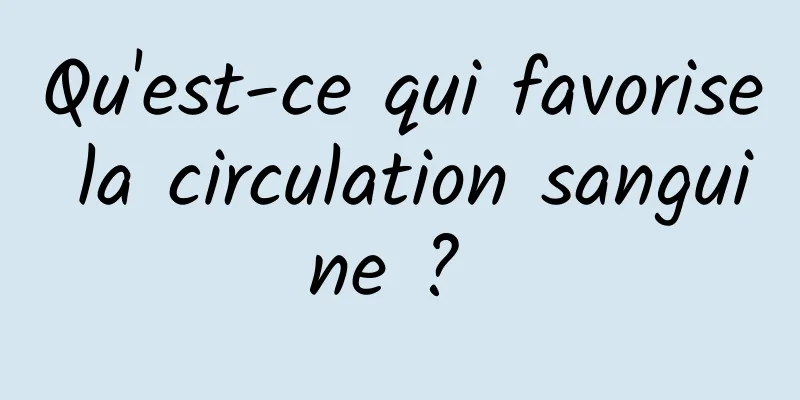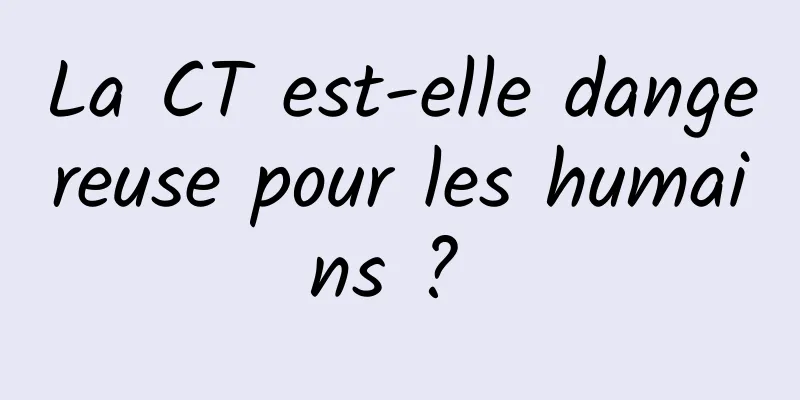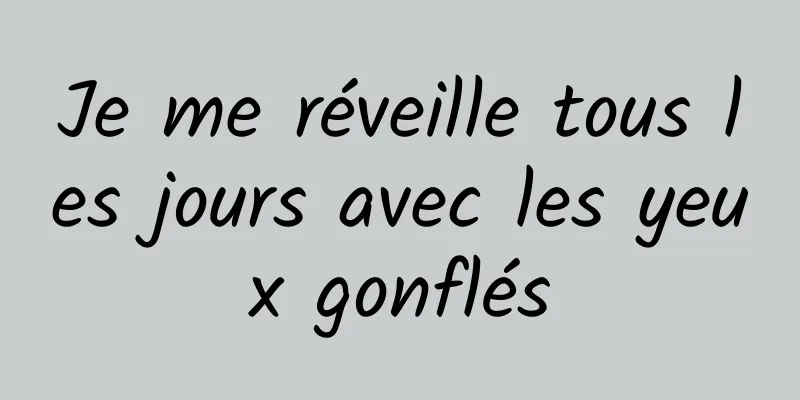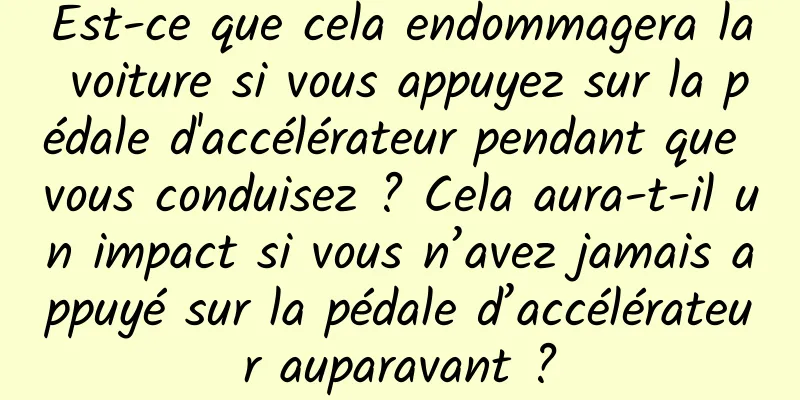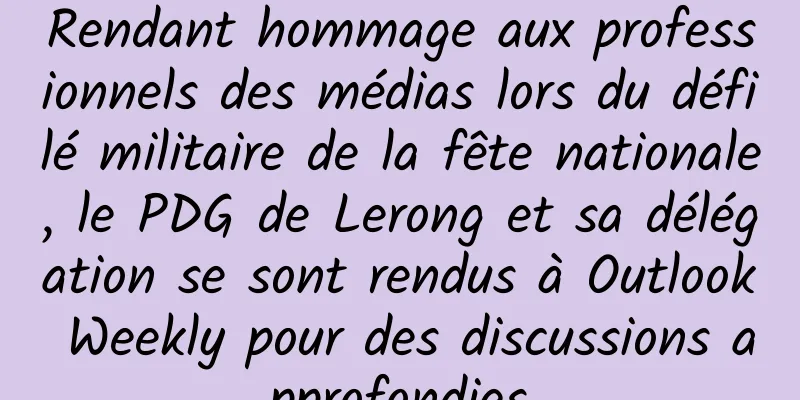L’épidémie n’est pas terminée pendant les jours caniculaires de l’été, et elle causera encore plus de problèmes en automne et en hiver ?
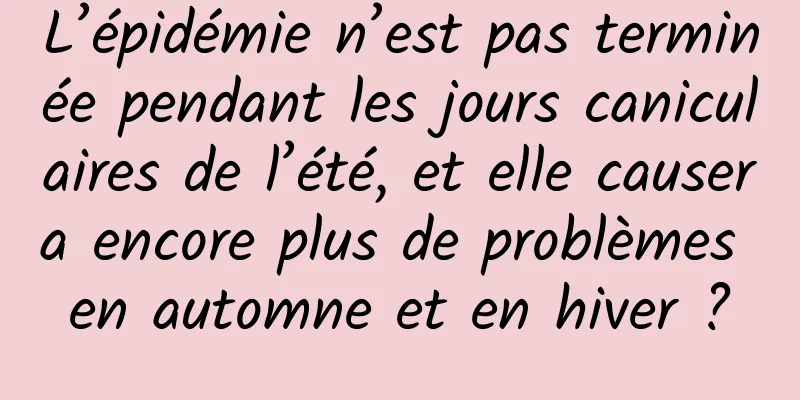
|
Il y a des milliers d’années, les humains ont remarqué que certaines maladies étaient répandues à certaines saisons. Est-ce à cause du climat/de la météo ? Est-ce à cause des schémas d’activité humaine ? Ou est-ce parce que le système immunitaire lui-même est parfois fort et parfois faible ? Ce mystère ancien reste non résolu à ce jour. Il faudra également du temps pour déterminer si la COVID-19 présente également des caractéristiques saisonnières. Écrit par | Idobon Début 2020, lors d’une forte saison grippale, le nouveau coronavirus s’est également propagé rapidement et s’est répandu dans le monde entier. Depuis le début de l’épidémie, les gens espèrent que le COVID-19 disparaîtra progressivement à mesure que la température augmentera, tout comme la grippe. En février, le président américain Trump a évoqué à plusieurs reprises une théorie selon laquelle le nouveau coronavirus serait tué lorsque le temps se réchaufferait en avril. Cependant, à ce jour, le nombre de nouveaux cas confirmés aux États-Unis dépasse les 70 000 par jour. Il y a plus de 2 500 ans, les humains ont découvert que de nombreuses maladies infectieuses sont plus fréquentes à certaines saisons. Par exemple, la grippe a tendance à survenir plus fréquemment pendant les hivers froids et secs. Mais la saisonnalité des maladies n’a pas encore été bien expliquée. Andrew Loudon, chronobiologiste à l'Université de Manchester, a déclaré que cette question est très difficile à étudier car il faut parfois deux ou trois ans pour vérifier « l'hypothèse saisonnière de la maladie », et le fait de ne pouvoir réaliser que cette seule expérience au cours d'études postdoctorales est très préjudiciable à la carrière. Plus important encore, ce domaine regorge de variables confondantes et les chercheurs peuvent facilement tomber dans le piège de fausses corrélations. En 2018, Micaela Martinez, écologiste spécialisée dans les maladies infectieuses à l'Université de Columbia, a publié une étude dans PLOS Pathogens[1], constatant qu'au moins 68 maladies infectieuses sont saisonnières, mais que leurs cycles épidémiques ne sont pas synchronisés et varient en fonction de la zone épidémique : Sauf dans les régions tropicales, le virus respiratoire syncytial (VRS) est plus fréquent en hiver, tandis que la varicelle est plus fréquente en été. Aux États-Unis, le rotavirus est plus fréquent dans le Sud-Ouest, de décembre à janvier, et dans le Nord-Est, d’avril à mai. L'herpès génital se propage dans tout le pays au printemps et en été, tandis que le tétanos doit attendre le milieu de l'été. La gonorrhée commence à causer des problèmes en été et en automne, et la coqueluche est plus fréquente de juin à octobre. En Chine, la syphilis est plus contagieuse en hiver et la fièvre typhoïde augmente en juillet. En Inde, l’hépatite C est plus répandue en hiver, tandis qu’en Égypte, en Chine et au Mexique, elle frappe au printemps et en été. La maladie du ver de Guinée et la fièvre de Lassa au Nigéria ainsi que l’hépatite A au Brésil sont clairement associées à la saison sèche. Le tableau suivant est basé sur les données des dossiers médicaux américains. La taille du cercle représente la proportion du nombre de personnes infectées par la maladie ce mois-ci par rapport au nombre annuel d’infections. Une grande partie des données du tableau sont des données historiques, car après l’apparition des vaccins, le nombre de personnes infectées par de nombreuses maladies est devenu très faible, voire nul. Le calendrier des épidémies Source | https://www.sciencemag.org/news/2020/03/why-do-dozens-diseases-wax-and-wane-seasons-and-will-covid-19 (L'image originale peut afficher des données détaillées) De nombreux facteurs sont à l’origine des épidémies saisonnières de maladies infectieuses, le plus simple et le plus intuitif étant les maladies propagées par les insectes. Par exemple, la maladie du sommeil africaine, le chikungunya, la dengue et la cécité des rivières deviennent tous fréquents pendant la saison des pluies, lorsque les moustiques prolifèrent. Cependant, pour d’autres maladies infectieuses, il peut être impossible de trouver un cycle, et encore moins d’en déterminer la cause. « Le plus étonnant, c’est que l’on peut trouver un virus qui est répandu chaque mois dans le même environnement et au même endroit », a déclaré Neal Nathanson, virologue à la retraite de l’Université de Pennsylvanie. Cela signifie que les activités humaines – comme le retour des élèves à l’école et leur confinement à la maison pendant l’hiver – ne sont pas la cause profonde de l’épidémie. C’est parce que la plupart des virus se transmettent entre les enfants. Si la saisonnalité de l’infection est entièrement affectée par le comportement humain, alors la plupart des maladies infectieuses devraient être répandues au cours des mêmes mois. Nathanson soupçonne que la capacité du virus à survivre en dehors du corps humain est un facteur plus important que l’activité humaine. Certains virus possèdent non seulement une capside qui enveloppe leur matériel génétique, mais également une enveloppe composée de lipides à l’extérieur. L’enveloppe facilite l’interaction entre le virus et les cellules hôtes, aidant le virus à échapper aux attaques du système immunitaire. Cependant, l’enveloppe présente également des inconvénients pour le virus : les virus dotés d’enveloppes sont plus fragiles et ont plus de mal à survivre pendant les étés chauds et secs. Un rapport publié dans Scientific Reports en 2018 a soutenu l’hypothèse de Nathanson. Dans 36 000 échantillons respiratoires collectés auprès de patients au cours des sept dernières années, le virologue Sandeep Ramalingam de l'Université d'Édimbourg au Royaume-Uni a collecté neuf virus, certains avec des enveloppes et d'autres sans. Après analyse, Ramalingam a découvert que les virus enveloppés avaient une saisonnalité assez définie. Comme le virus de la grippe, le virus respiratoire syncytial et le métapneumovirus humain possèdent des enveloppes, sont répandus en hiver et n’apparaissent pas plus de quatre mois par an. Le rhinovirus qui cause le rhume n'a pas d'enveloppe et, bien sûr, ne favorise pas l'hiver - les échantillons respiratoires montrent que le rhinovirus est actif 84,7 % des jours de l'année et devient répandu lorsque les élèves retournent à l'école après les vacances d'hiver et d'été. Un autre virus courant qui cause le rhume, les adénovirus, n’ont pas non plus d’enveloppe et sont actifs pendant plus de la moitié de l’année. L’équipe de Ramalingam a également étudié la relation entre la charge virale et les changements météorologiques quotidiens. Lorsque l’humidité relative ne change pas de plus de 25 % en 24 heures, la quantité de virus de la grippe et de virus respiratoire syncytial est la plus élevée ; lorsque l'humidité change radicalement, l'enveloppe lipidique devient plus fragile et la quantité de virus diminue. Le géophysicien du climat Jeffrey Shaman estime que c’est l’humidité absolue, et non l’humidité relative, qui est importante. Le premier fait référence à la teneur totale en vapeur d’eau par unité de volume d’air, et le second fait référence au degré auquel l’humidité de l’air se rapproche de la saturation. Ses recherches en collaboration avec l'épidémiologiste Marc Lipsitch de l'Université Harvard ont montré que la baisse de l'humidité absolue peut mieux expliquer pourquoi la saison de la grippe aux États-Unis continentaux tombe en hiver que l'humidité relative et la température - l'humidité absolue chute plus fortement en hiver parce que l'air froid contient moins de vapeur d'eau. Cependant, nous ne savons toujours pas pourquoi certains virus sont si sensibles à l’humidité absolue. La pression osmotique, le taux d’évaporation et la valeur du pH peuvent tous affecter la probabilité de survie de la capside virale, mais il n’existe pas encore de réponse quant à son mécanisme d’action. Le nouveau coronavirus a également une enveloppe. Deviendra-t-il plus vulnérable au printemps et en été lorsque l’humidité augmentera ? Malheureusement, le coronavirus SRAS et le coronavirus MERS ne nous ont laissé aucun indice. Le SRAS a éclaté violemment à la fin de l’année 2002, puis a disparu à l’été de l’année suivante. Le MERS est passé des chameaux aux humains et n’a provoqué que de petites épidémies dans les hôpitaux, mais ne s’est jamais propagé aussi largement que le nouveau coronavirus. La courte durée et la faible portée de transmission de ces deux virus ne suffisent pas à démontrer des cycles saisonniers. En revanche, les quatre coronavirus humains responsables du rhume sont plus révélateurs. Kate Templeton, biologiste moléculaire à l'Université d'Edimbourg, a étudié et résumé un total de 11 611 échantillons respiratoires de 2006 à 2009 et a découvert que trois d'entre eux pouvaient provoquer des épidémies hivernales typiques, tandis que leur présence était presque indétectable en été. Les trois coronavirus se comportent de manière très similaire à la grippe. Mais cela ne signifie pas que la même chose est vraie pour le coronavirus. Singapour compte désormais plus de 40 000 cas confirmés (il y avait moins de 200 cas en mars) ; Les États du sud-ouest des États-Unis, en particulier l’Arizona, souffrent désormais de graves épidémies de COVID-19. Tout cela montre que le nouveau coronavirus peut sans aucun doute se propager dans des environnements chauds et humides. Il existe actuellement deux conclusions opposées : premièrement, en examinant l’épidémie en Chine continentale, qui couvre 19 provinces, municipalités et régions autonomes, des régions froides et sèches aux régions chaudes, la transmissibilité du nouveau coronavirus n’a pas diminué. Deuxièmement, le nouveau coronavirus ne peut se propager de manière stable que dans les zones du monde où la température est comprise entre 5°C et 11°C et l’humidité relative entre 47% et 79%[2]. Les conclusions de ces deux études sont contradictoires. En résumé, il existe un équilibre entre les facteurs environnementaux et le système immunitaire de la population. D’autres coronavirus sont présents dans la société humaine depuis longtemps, et une partie de la population a développé une résistance, ce qui peut aider à prévenir la propagation de maladies infectieuses, en particulier lorsque l’environnement naturel n’est pas propice à la propagation du virus. Toutefois, cela ne s’applique pas au COVID-19. Martinez a déclaré que même si le nouveau coronavirus a un cycle saisonnier et même s'il devient moins actif au printemps et en été, tant qu'il y a suffisamment de personnes sensibles rassemblées, le nouveau coronavirus peut persister pendant une période de temps considérable. Ainsi, lorsque Trump a affirmé à plusieurs reprises que l’épidémie s’atténuerait d’ici avril (bien sûr, nous savons tous maintenant qu’il a été giflé), de nombreux chercheurs ont pensé que cette affirmation n’était pas fiable. Même si le coronavirus devient moins actif et que l’épidémie est réellement ralentie, cela ne suffira pas à arrêter la propagation du virus, a écrit Lipsitch sur son blog. Actuellement, la plupart des théories se concentrent sur la relation entre les agents pathogènes, l’environnement et le comportement humain. Par exemple, la grippe est plus fréquente en hiver, ce qui peut être dû à une faible humidité, à une température basse, à des foules plus concentrées, à des changements de régime alimentaire et à des changements dans les niveaux de vitamine D, etc. Mais l’épidémiologiste Scott Dowell estime que ces facteurs ne suffisent pas à expliquer la situation. Dans un article largement cité publié en 2001[3], il a proposé une « hypothèse de photopériode » non testée : la résistance du système immunitaire aux différentes maladies infectieuses varie selon les saisons, ce qui est lié à la quantité de lumière que reçoit le corps humain. L’hypothèse de Dowell a inspiré Martinez. Elle a demandé aux sujets de venir régulièrement à la clinique à quatre moments précis : l’équinoxe de printemps, le solstice d’été, l’équinoxe d’automne et le solstice d’hiver, pour évaluer l’état de leur système immunitaire et d’autres changements physiologiques au cours de la journée. Elle ne s’attendait pas à ce que le système immunitaire présente des caractéristiques temporelles simples : faible en hiver et fort en été, par exemple. Mais en comptant le nombre de cellules différentes du système immunitaire, en évaluant les métabolites et les cytokines dans le sang, en déchiffrant le microbiome fécal et en mesurant les niveaux d’hormones, Martinez espère identifier les saisons qui « recâblent » le système immunitaire, en d’autres termes, lorsque certaines cellules deviennent plus abondantes à certains endroits et d’autres deviennent moins abondantes, affectant ainsi la sensibilité d’une personne aux agents pathogènes. Les études sur les animaux soutiennent l’hypothèse selon laquelle le système immunitaire fluctue au gré des saisons. Barbara Hall, ornithologue à l'Université de Groningue aux Pays-Bas, a étudié les grives européennes. Ils ont prélevé des échantillons de sang des oiseaux plusieurs fois par an et ont constaté que le système immunitaire de ces grives était plus actif en été et plus affaibli et stable en automne. Cela peut être dû au fait que la migration d’automne est très gourmande en énergie. Randy Nelson, endocrinologue à l’Université de Virginie-Occidentale, estime que les hauts et les bas saisonniers du système immunitaire sont provoqués par la mélatonine. La mélatonine, sécrétée par la glande pinéale, régule non seulement le rythme circadien mais aussi le « calendrier biologique » saisonnier. À mesure que les nuits s’allongent, la glande pinéale sécrète davantage de mélatonine. « Les cellules disent : Oh, je vois un peu plus de mélatonine, et je sais que c'est une nuit d'hiver. » Nelson a mené des expériences sur des hamsters sibériens diurnes (notez que les souris ordinaires sont nocturnes) et a découvert que la régulation de la mélatonine ou la modification des schémas lumineux peuvent affecter la réponse immunitaire des hamsters, l'impact pouvant atteindre 40 %. Le système immunitaire humain semble également avoir un rythme circadien inné. En 2016, l’Université de Birmingham au Royaume-Uni a mené un test de vaccin contre la grippe sur 276 adultes, en sélectionnant au hasard la moitié d’entre eux pour recevoir le vaccin le matin et l’autre moitié l’après-midi. Les résultats ont montré que la réponse anticorps produite par ceux qui ont reçu le vaccin le matin était significativement plus forte[4]. Plus étonnant encore, il existe également des preuves que le système immunitaire humain change avec les saisons. En 2015, des chercheurs de l’Université de Cambridge ont collecté plus de 10 000 échantillons de sang et de tissus provenant d’Europe, des États-Unis, de Gambie et d’Australie, et ont découvert qu’environ 4 000 gènes liés au système immunitaire s’exprimaient différemment selon les saisons. Dans un groupe d’échantillons allemands, l’expression de près d’un quart des gènes immunitaires dans les globules blancs changeait avec les saisons. Certains gènes ne sont pas exprimés lorsque le corps humain se trouve dans l’hémisphère sud, mais ils sont activés lorsque le corps humain se déplace vers l’hémisphère nord, et vice versa[5]. Cependant, le premier auteur de l'étude, l'immunologiste Xaquin Castro Dopico, a également souligné dans l'article qu'on ne sait toujours pas comment ces changements généraux et à grande échelle dans le système immunitaire affectent la lutte de l'organisme contre les agents pathogènes. De plus, certains changements peuvent être le résultat d’une infection plutôt que la cause. Bien que l’équipe de recherche ait fait de son mieux pour exclure les échantillons de sujets atteints de maladies infectieuses aiguës, certains ont inévitablement été mélangés. De plus, les changements saisonniers du système immunitaire ne suffisent pas à expliquer les schémas saisonniers des maladies, qui sont beaucoup plus complexes et comportent davantage de variables. Comme l’a dit Nathanson : ces épidémies sont tout simplement désynchronisées. Il soupçonne que les changements saisonniers dans le système immunitaire ne suffisent pas à provoquer une désynchronisation aussi marquée. Les expériences de Martinez ont déjà recueilli des données et n’ont trouvé aucune preuve de saisonnalité dans le système immunitaire. Elle a cependant découvert qu’un sous-ensemble de globules blancs qui jouent un rôle central dans le système immunitaire réagissent de manière plus spectaculaire à certains moments de la journée. Cependant, Martinez est profondément préoccupé par le fait que la lumière artificielle pourrait perturber les rythmes circadiens dont l’évolution nous a dotés, ce qui aurait en fin de compte des effets imprévisibles sur la susceptibilité aux maladies. Dans son article de 2001, Dowell a suggéré que nous pourrions mieux comprendre les facteurs qui influencent la saisonnalité des maladies grâce à des « expériences de la nature ». Par exemple, les populations des hémisphères nord et sud se rassemblent et socialisent sur des bateaux de croisière, s’adaptant ainsi à des cycles saisonniers différents mais confrontées aux mêmes agents pathogènes. Dans le cas de l’épidémie du Diamond Princess, les chercheurs pourraient envisager d’analyser les taux d’infection des passagers de différentes régions pour voir s’ils sont les mêmes. Bien que la pandémie de COVID-19 soit actuellement une urgence mondiale et ait attiré le plus d’attention, il est tout aussi important d’étudier pourquoi diverses maladies infectieuses atteignent parfois un pic et parfois disparaissent tout au long de l’année. Comprendre ce problème peut nous fournir de nouvelles idées pour prévenir et traiter la nouvelle maladie à coronavirus. Comprendre ce que l’on appelle la « saisonnalité » peut également nous aider à surveiller les maladies et à déterminer le moment des vaccinations. « Si nous pouvions déterminer ce qui empêche la grippe de se propager en été, cela serait bien plus utile que n’importe quel vaccin contre la grippe », a déclaré Dowell. Références [1] Martinez ME (2018) Le calendrier des épidémies : cycles saisonniers des maladies infectieuses. PLoS Pathog 14(11) : e1007327. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1007327 [2] https://gvn.org/enhanced-model-for-monitoring-zones-of-increased-risk-of-covid-19-spread/ [3] Dowell SF (2001). Variation saisonnière de la sensibilité de l’hôte et cycles de certaines maladies infectieuses. Maladies infectieuses émergentes, 7(3), 369–374. https://doi.org/10.3201/eid0703.010301 [4] Long, JE, Drayson, MT, Taylor, AE, Toellner, KM, Lord, JM, et Phillips, AC (2016). La vaccination du matin améliore la réponse anticorps par rapport à la vaccination de l'après-midi : un essai randomisé en grappes. Vaccin, 34(24), 2679-2685. [5] Dopico, La principale source de référence de cet article : https://www.sciencemag.org/news/2020/03/why-do-dozens-diseases-wax-and-wane-seasons-and-will-covid-19 |
<<: Ne pas manger de coriandre est la dernière obstination de nombreux adultes
Recommander des articles
Symptômes de la stase du Qi et du sang
Du point de vue de la médecine traditionnelle chi...
Est-ce grave d'avoir une ombre sur la thyroïde ?
De nombreux amis soupçonneront qu’ils ont un canc...
Quelles sont les propriétés et caractéristiques des dattes grises ? Comment classer les dattes grises du Xinjiang
Les dattes grises et les dattes rouges sont deux ...
Gastrite superficielle et Helicobacter pylori
Il y a beaucoup de patients atteints de gastrite ...
Pourquoi la crème fouettée produit-elle de l’eau ?
La crème est un ingrédient indispensable dans la ...
Comment faire un ragoût de poisson avec du tofu ? Comment faire mijoter une tête de poisson avec du Chuanxiong et de l'Angelica dahurica ?
Le ragoût de poisson est très facile à préparer. ...
Que dois-je faire si des crottes de nez tombent dans mes yeux ?
La plupart des gens ont des crottes de nez dans l...
Traitement des tumeurs cérébrales postérieures
Le traitement des tumeurs cérébrales postérieures...
Ce que vous mangez chaque jour est plus nocif que fumer
Cet article a été révisé par Pa Li Ze, médecin-ch...
Quel est le but d’un grand lavement sans rétention ? La constipation peut-elle être traitée ?
Le principal objectif du lavement non rétentif à ...
Quelles sont les séquelles de la chirurgie de broyage des os
Afin de rendre leur visage plus délicat et plus b...
Transfert utile ! Que dois-je faire si j’ai de la toux et des douleurs après être devenu négatif ?
Si vous avez des questions sur le coronavirus Sur...
Fantasy Flying Machines : Une critique de l'histoire fascinante et des visuels
Machines volantes imaginaires - Kuuso no sora tob...
Comment conserver les pommes en hiver
Les fruits que nous voulons manger en hiver sont ...
Tachycardie sinusale avec arythmie, l'humeur est extrêmement importante
Les experts disent : la tachycardie sinusale caus...
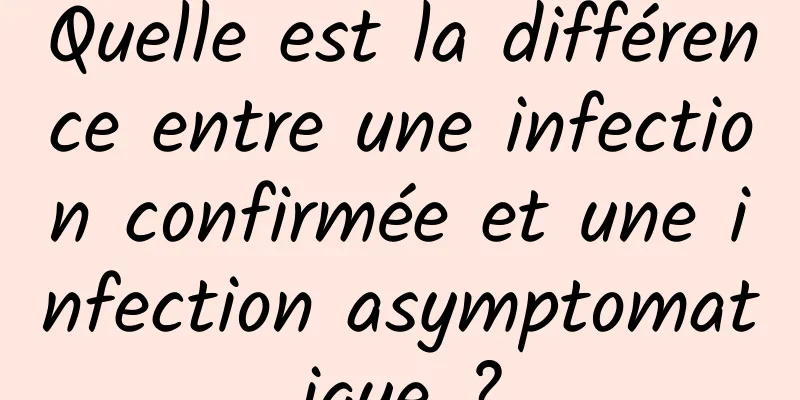
![[Terme solaire de l'eau de pluie : nourrir d'abord le foie] Lorsque l'eau de pluie arrive et que la brise printanière souffle, comment pouvons-nous réguler efficacement le qi du foie ?](/upload/images/67f16008dce37.webp)