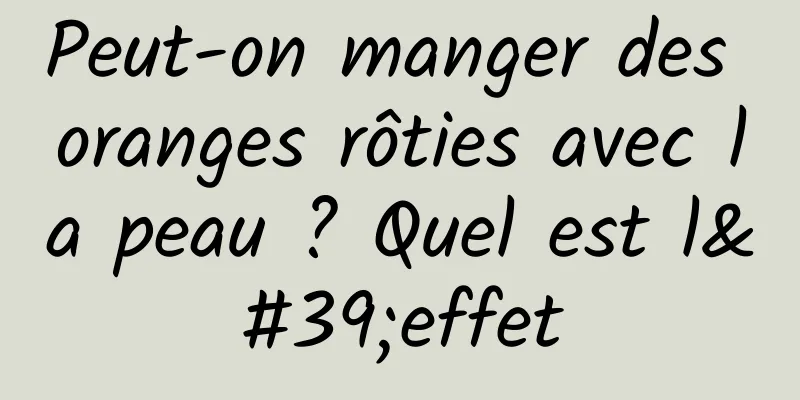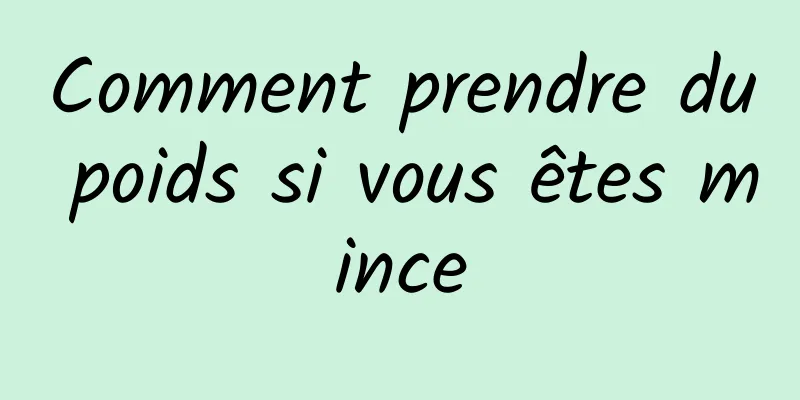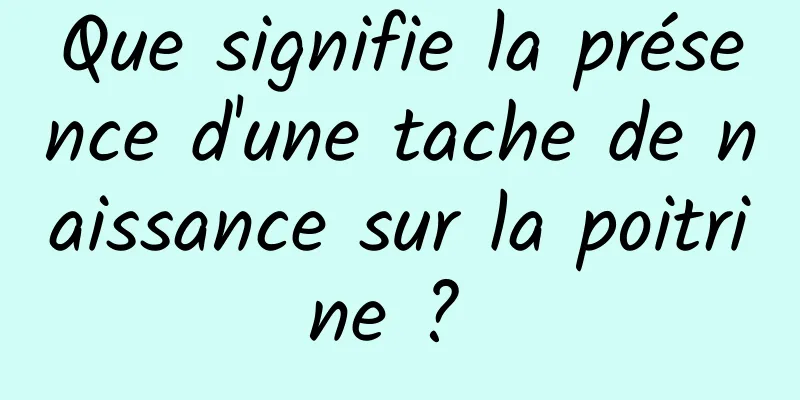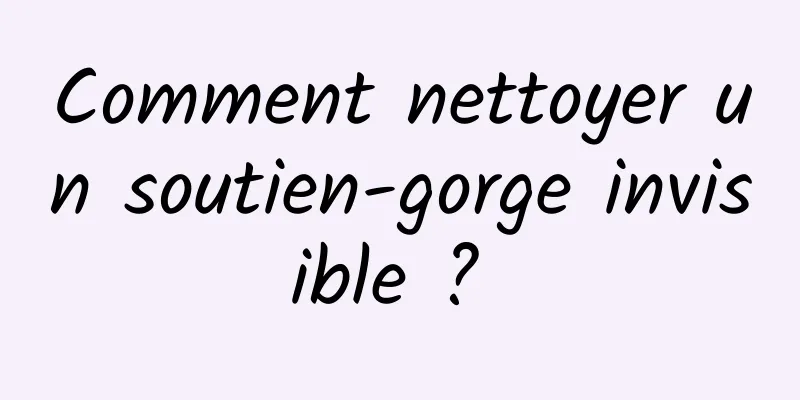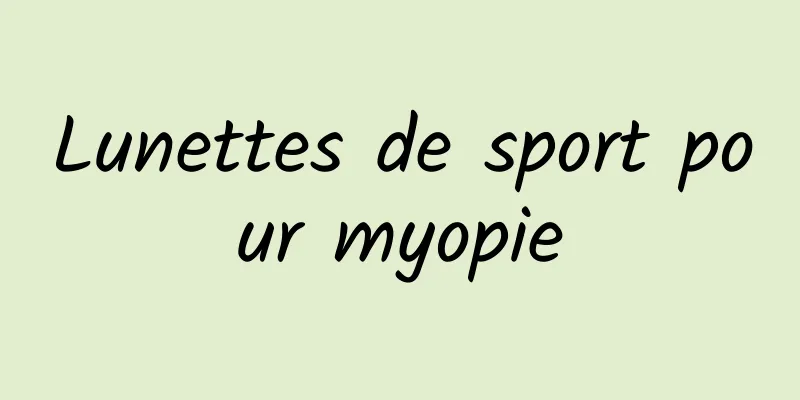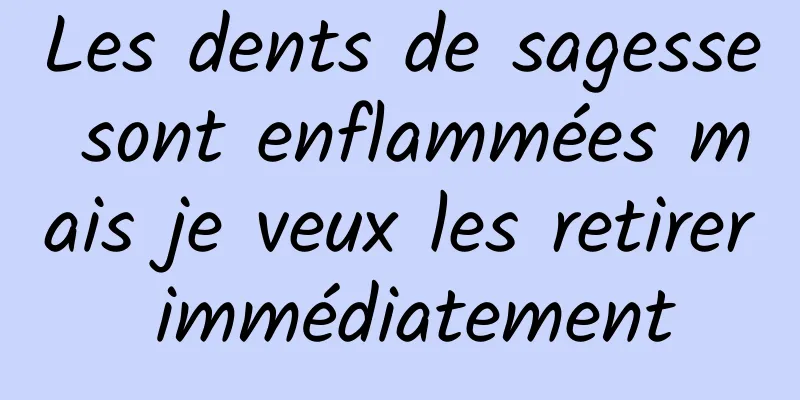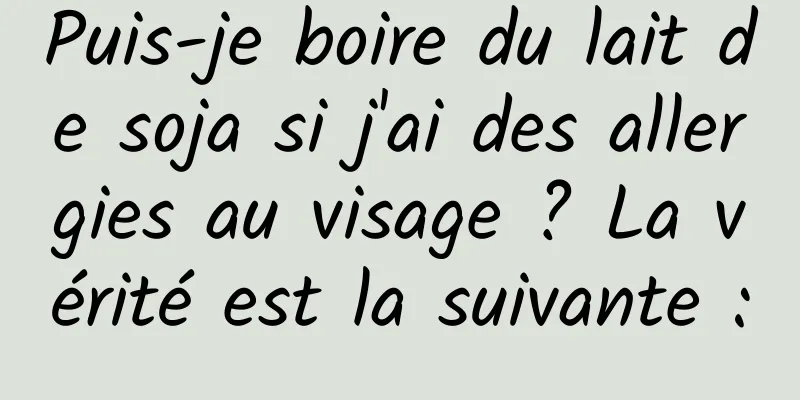Peux-tu encore bien uriner ? Tant de personnes ont une vessie hyperactive...
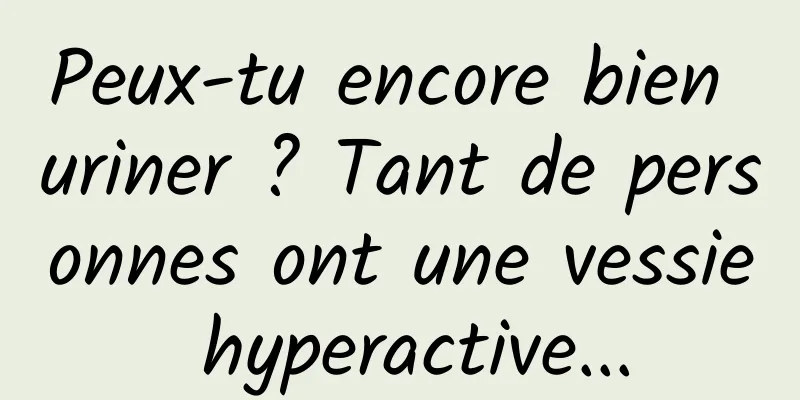
|
Presse Léviathan : On estime que de nombreuses personnes ont vécu des expériences similaires : lorsque vous êtes pressé de faire pipi, si quelque chose de plus urgent que l'urgence de faire pipi survient soudainement, votre cerveau se consacrera immédiatement à faire face à cette urgence - à ce moment-là, vous n'avez aucune envie de faire pipi, comme si l'urine dans votre vessie qui est sur le point d'exploser n'existait pas. Les gens s’intéressent depuis longtemps au mécanisme de contrôle et de rétroaction des signaux cerveau-vessie : pourquoi votre cerveau veut-il que vous alliez aux toilettes même si vous n’avez pas d’urine ? Qu’est-ce que la nycturie exactement ? Quelles sont les causes de l’incontinence urinaire ? Vous conduisez, les yeux fixés sur la route, lorsque vous ressentez soudain une vive douleur dans le bas-ventre. Ce grand verre de Coca que j’ai bu il y a une heure a déjà traversé mes reins et est entré dans ma vessie. Vous vous dites : « Il est temps de trouver une place pour vous garer » et vous commencez à chercher la rampe de sortie. Pour la plupart des gens, s’arrêter sur une aire de repos d’autoroute pour faire pipi est une expérience courante. Mais pour la neuroscientifique Rita Valentino, ce n’est pas si ordinaire. Elle étudie la façon dont le cerveau détecte, interprète et traite les signaux provenant de la vessie. Valentino était fasciné par la capacité du cerveau à capter les signaux sensoriels de la vessie, à les combiner avec les signaux de l'environnement extérieur (comme les images et les sons de la route), puis à utiliser ces informations pour agir (trouver un endroit sûr et approprié pour uriner). « Pour moi, c’est une illustration des choses merveilleuses que fait le cerveau », a-t-elle déclaré. Les scientifiques pensaient autrefois que notre vessie était contrôlée par un réflexe relativement simple : un « changement » entre le stockage de l’urine et sa libération. « Nous réalisons maintenant que c’est beaucoup plus compliqué que cela », a déclaré Valentino, désormais directeur de la division des neurosciences et du comportement à l’Institut national sur l’abus des drogues. Un réseau complexe de régions cérébrales impliquées dans des fonctions telles que la prise de décision, l'interaction sociale et la conscience des états internes du corps (également connue sous le nom d'interoception) est également impliqué dans ce processus. En plus d’être extrêmement complexe, le système est également extrêmement fragile. Les scientifiques estiment que plus d’un adulte sur dix souffre d’hyperactivité vésicale (HVV) — un groupe courant de symptômes qui comprend l’urgence urinaire (la sensation d’avoir besoin d’uriner même lorsque la vessie n’est pas pleine), la nycturie (visites fréquentes aux toilettes la nuit) et l’incontinence urinaire. © Getty Images Bien que les traitements existants puissent améliorer les symptômes chez certaines personnes, ils ne fonctionnent pas pour beaucoup, explique Martin Michel, pharmacologue à l'Université Johannes Gutenberg de Mayence en Allemagne, qui étudie les traitements des maladies de la vessie. Développer des médicaments efficaces est un tel défi que toutes les grandes sociétés pharmaceutiques ont abandonné leurs efforts. Cependant, un afflux récent de nouvelles recherches ouvre de nouveaux domaines pour de nouvelles hypothèses et thérapies. Alors que les traitements des troubles de la vessie se sont historiquement concentrés sur la vessie elle-même, Valentino a noté que de nouvelles recherches suggèrent que le cerveau est également une cible thérapeutique potentielle. Indira Mysorekar, microbiologiste au Baylor College of Medicine de Houston, explique que ces études visent à expliquer pourquoi certains groupes, comme les femmes ménopausées, sont plus susceptibles d'avoir des problèmes de vessie et que nous ne devrions pas simplement supposer que des symptômes tels que l'incontinence sont inévitables. « On nous dit souvent, surtout aux femmes, que ces problèmes font simplement partie du vieillissement, et même si c’est vrai dans une certaine mesure », a-t-elle déclaré, de nombreux problèmes courants sont évitables et peuvent être traités avec succès. « Nous n’avons pas à vivre avec la douleur ou l’inconfort », a-t-elle déclaré. Un équilibre délicat Au niveau le plus élémentaire, la vessie humaine est un sac extensible. Afin de remplir le volume de l'urine (la plupart des adultes en bonne santé en contiennent 400 à 500 millilitres, soit environ 2 tasses), elle doit subir l'expansion la plus extrême de tous les organes du corps humain, se dilatant environ six fois par rapport à son état vide. © wikipedia Pour réaliser cet étirement, la paroi musculaire lisse entourant la vessie, appelée muscle détrusor, doit se détendre. En même temps, le muscle sphincter entourant l'ouverture inférieure de la vessie (l'urètre) doit se contracter, un processus que les scientifiques appellent le « réflexe de garde ». Qu'elle soit remplie ou vide, la vessie passe plus de 95 % du temps en mode stockage, nous permettant de vaquer à nos activités quotidiennes sans fuite. À un moment donné, idéalement lorsque nous décidons qu’il est temps d’aller aux toilettes, la vessie passe du mode de stockage au mode de libération. Pour ce faire, le muscle détrusor doit se contracter avec force pour expulser l’urine, tandis que le muscle sphincter entourant l’urètre se relâche simultanément pour permettre à l’urine de s’écouler [1]. Ce ne sont pas seulement les neurones sensoriels (violet) qui détectent des sensations comme l’étirement, la pression, la douleur, etc. dans la vessie. D’autres types de cellules, comme les cellules parapluie qui forment la barrière urothéliale de l’urine, peuvent également détecter et réagir aux forces mécaniques, par exemple en libérant des molécules de signalisation chimique telles que l’adénosine triphosphate (ATP) lorsque l’organe se remplit d’urine. © E. Underwood/Knowable Depuis un siècle, les physiologistes étudient la manière dont le corps coordonne le passage entre le stockage et la libération. Dans les années 1920, un chirurgien nommé Frederick Barrington, travaillant à l'University College de Londres, a recherché le site responsable de ce changement dans le tronc cérébral, la partie la plus basse du cerveau connectée à la moelle épinière. Barrington a mené des expériences sur des chats sous sédatifs, en utilisant des aiguilles électriques pour endommager légèrement le pont, une partie du tronc cérébral qui gère des fonctions importantes telles que le sommeil et la respiration. Lorsque les chats ont repris conscience, Barrington a remarqué que certains montraient une envie d'uriner (en se grattant, en tournant en rond ou en s'accroupissant), mais étaient incapables d'uriner par eux-mêmes. Pendant ce temps, les chats présentant des lésions à différentes parties du pont semblaient perdre conscience de la miction, urinaient à des moments aléatoires et semblaient surpris lorsque cela se produisait. Apparemment, le pont est un centre de commande important pour la miction, indiquant à la vessie quand libérer l'urine. Au-delà du noyau de Barrington Les travaux de Barrington ont jeté les bases de notre compréhension actuelle des circuits neuronaux du contrôle de la vessie. Mais nous savons maintenant que le pont n’est pas le seul élément en cause. Lorsque la vessie se remplit d'urine, le muscle détrusor et les cellules sensibles à l'étirement de la paroi de la vessie envoient un signal de plénitude le long de la moelle épinière jusqu'à une partie du tronc cérébral appelée substance grise périaqueducale (PAG). Le signal est ensuite transmis à une zone appelée l'insula, qui agit comme une sorte de capteur : plus la vessie est pleine, plus les neurones de l'insula déclenchent de minuscules impulsions électriques appelées potentiels d'action. Ensuite, la zone du cerveau responsable de la planification et de la prise de décision – le cortex préfrontal – calcule s’il s’agit d’un moment socialement acceptable pour uriner. Si la réponse est oui, cela envoie un signal à la matière grise périaqueducale, qui à son tour envoie un signal de fin d'alerte à la partie du pont que Barrington a découverte dans ses expériences sur les chats, maintenant appelée noyau de Barrington. Ce signal revient à la vessie et voilà, la miction se produit. © Métro Au cours de la dernière décennie, des outils ultra-précis ont rendu beaucoup plus sophistiquée la cartographie des connexions et des interactions entre les différentes régions du cerveau. Valentino et son équipe ont utilisé une technique permettant de surveiller et d’analyser simultanément l’activité électrique des neurones dans plusieurs parties du cerveau. Lorsque la vessie atteint un certain niveau de remplissage, le locus coeruleus du tronc cérébral commence à se décharger à un rythme régulier. Cette vague d’activité se propage jusqu’au cortex externe du cerveau et place le cerveau dans un état plus éveillé et alerte pendant environ 30 secondes avant la miction. Valentino espère que des observations comme celles-ci pourraient éclairer les traitements pour des problèmes courants comme la nycturie et l’énurésie, et qu’elles pourraient également aider à expliquer certains phénomènes de base que la plupart des gens éprouvent. « Je pense que c’est l’une des principales raisons pour lesquelles vous devez vous réveiller pour faire pipi », explique Valentino. « C’est comme si le locus coeruleus disait : « Arrête ce que tu fais et concentre-toi sur ta miction. » Apprenez à le contrôler Il faut du temps pour développer le contrôle du moment et de l’endroit où nous urinons, comme peut en témoigner toute personne ayant appris à un jeune enfant à aller sur le pot. À la naissance, la miction n’est pas contrôlée par le cerveau, mais par un réflexe spinal qui se déclenche lorsque la vessie atteint une certaine capacité. Ce n'est qu'à partir de 3 ou 4 ans que les zones du cerveau responsables de fonctions telles que la conscience sociale et la prise de décision vont au-delà des réflexes, explique Hanneke Verstegen, neuroscientifique au Beth Israel Deaconess Medical Center de Boston et à la Harvard Medical School. Il nous est impossible d’observer comment ce processus se déroule dans le tronc cérébral d’un nourrisson humain. Mais Westergen et ses collègues étudient un processus similaire chez des souris de laboratoire, qui développent un contrôle volontaire de la miction en trois à cinq semaines environ. C'est à ce moment-là que les souris ont commencé à uriner dans des coins désignés, un comportement qui n'est pas sans rappeler celui des tout-petits propres, a-t-elle déclaré. Il est intéressant de noter que les réflexes spinaux automatiques plus primitifs que nous possédons lorsque nous sommes nourrissons ne disparaissent pas complètement : lorsqu’une lésion de la moelle épinière affecte les nerfs qui transportent les signaux entre la vessie et le cerveau, les réflexes peuvent réapparaître, entraînant souvent une incontinence ou d’autres affections nécessitant l’utilisation d’un cathéter. Il s'agit d'une représentation simplifiée de certaines des voies neuronales et des régions du cerveau qui permettent à la plupart des personnes en bonne santé de détecter quand leur vessie est pleine ou en train de se remplir, de prédire combien de temps elles peuvent attendre pour uriner et d'exécuter avec succès un plan pour « la retenir » ou « la verser ». Des perturbations à n’importe quel niveau de ce système complexe de communication neuronale bidirectionnelle peuvent entraîner des problèmes de vessie, comme ceux que connaissent des millions de personnes dans le monde. © knowablemagazine Une lésion de la moelle épinière n’est qu’une des nombreuses raisons pour lesquelles des problèmes de communication entre le cerveau et la vessie peuvent survenir. À mesure que le cerveau vieillit, les synapses qui transmettent les informations aux zones qui contrôlent la miction peuvent également perdre leur intégrité, provoquant un dysfonctionnement de la fonction normale de la vessie - un processus souvent accéléré dans les maladies de Parkinson et d'Alzheimer. Becky Clarkson, physicienne médicale à l'Université de Pittsburgh, et ses collègues utilisent des outils de neuroimagerie tels que l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) pour comprendre comment les mécanismes cérébraux qui contrôlent la miction se décomposent en observant quelles parties du cerveau sont actives en fonction des fluctuations des niveaux d'oxygène dans le sang.[2] « Nous essayons de déterminer quelles voies pourraient être altérées », a-t-elle déclaré. « Comment le cerveau contrôle-t-il normalement la vessie ? Et comment n'y parvient-il pas ? » Lorsque la vessie est vide ou partiellement pleine, elle est recouverte de rides (illustrées ici dans une coupe transversale artificiellement colorée de la paroi de la vessie d'une souris). Chez l’homme, ce tissu supplémentaire peut multiplier par cinq ou six la taille d’un organe. © AVEC L'AIMABLE AUTORISATION DU PATAPOUTIAN LAB / SCRIPPS RESEARCHER INSTITUTE, LA JOLLA, CA La plupart des participants à l’étude de Clarkson étaient des femmes de plus de 60 ans, le groupe démographique présentant les taux les plus élevés de vessie hyperactive. Environ 11 % de la population générale souffre d’hyperactivité vésicale, mais plus de 45 % des femmes ménopausées déclarent ressentir ce symptôme. Les scientifiques ne savent pas exactement ce qui cause l’hyperactivité vésicale ni pourquoi elle est si courante chez les femmes d’âge moyen et plus âgées. Certains évoquent des changements dans la vessie elle-même. L'une d'entre elles est Mysoreka, qui a découvert que pendant la ménopause, une prolifération de cellules immunitaires forme de minuscules bosses sur la paroi de la vessie d'une femme qui ressemblent à des ganglions lymphatiques. Ces lésions peuvent augmenter la sensibilité de la vessie même à de petites quantités d’E. coli (la bactérie responsable de la plupart des infections urinaires), entraînant des douleurs chroniques à la vessie ou une vessie hyperactive. Une autre cause majeure d’hyperactivité vésicale chez les hommes et les femmes est l’hyperactivité du détrusor, qui se caractérise par des contractions erratiques du muscle de la vessie qui envoient de faux signaux de plénitude au cerveau [3]. Les traitements existants visent tous à calmer ces contractions : la classe de médicaments la plus couramment utilisée est celle des antimuscariniques, qui bloquent l’activité de l’acétylcholine, une substance chimique de signalisation nerveuse qui déclenche les contractions du détrusor. Si les médicaments ne fonctionnent pas, les cliniciens recommandent souvent d’injecter de la toxine botulique dans le muscle détrusor afin qu’il ne se contracte pas excessivement. Parfois, ils tentent également de rétablir l’activité normale des nerfs spinaux qui contrôlent les muscles de la vessie en envoyant un courant électrique aux nerfs spinaux via un implant chirurgical ou des électrodes placées sur la peau. Le problème avec tous ces traitements de contrôle du détrusor est qu’ils peuvent avoir des effets secondaires indésirables, y compris, dans quelques cas, affecter la capacité à uriner, a déclaré Michel. « C'est une ligne très fine : si vous en faites trop, vous ne pourrez pas uriner ; si vous n'en faites pas assez, vous aurez des problèmes de stockage », a-t-il déclaré. Les antimuscariniques ont été associés à des symptômes de déclin cognitif, en particulier chez les personnes âgées, ce qui soulève des inquiétudes en matière de sécurité. De plus, toutes les personnes souffrant d’hyperactivité vésicale ne présentent pas un muscle détrusor hyperactif, ce qui incite certains scientifiques à se demander si le problème chez certains patients ne se situe pas ailleurs dans le corps, par exemple à l’intérieur du cerveau. Rentrez chez vous en toute sécurité Si vous êtes déjà rentré chez vous après une longue journée de travail et que, dès que vous avez déverrouillé la porte, vous avez ressenti une envie soudaine et irrésistible d'uriner, vous avez expérimenté ce que les scientifiques savent être un lien étroit entre le cerveau et la vessie. © ESTHER AARTS Ce type d’urgence urinaire, appelé incontinence par clé, n’a rien à voir avec le degré de remplissage de votre vessie. (Cela diffère également de l’incapacité à contrôler l’envie d’uriner lorsque nous éternuons, toussons ou sautons : ce problème courant est appelé incontinence d’effort, qui est généralement causée par la faiblesse des muscles du plancher pelvien.) Certains scientifiques pensent que l’urgence d’une vessie hyperactive peut être conditionnée, tout comme le physiologiste russe Ivan Pavlov a entraîné des chiens dans les années 1890 à associer la nourriture au son d’un métronome. Clarkson et son équipe émettent l’hypothèse que pour certaines personnes, ce conditionnement peut se former au fil des années d’attente avant de pouvoir rentrer chez elles pour utiliser leurs propres toilettes. Pour d’autres, cela peut être déclenché par diverses situations, comme le bruit de l’eau qui coule. Il est normal que ces sentiments intenses surviennent occasionnellement, mais s’ils surviennent trop souvent, les chercheurs pensent qu’ils pourraient être une source d’inquiétude. Clarkson et d’autres équipes de recherche ont découvert que les femmes souffrant d’hyperactivité vésicale ont tendance à avoir des schémas anormaux d’activité cérébrale. Dans une expérience menée dans le laboratoire de Clarkson, les participants étaient allongés à plat dans une IRMf tandis qu'un cathéter injectait du liquide dans leur vessie jusqu'à ce qu'ils disent qu'ils en avaient assez. Le technicien retire ensuite une partie du liquide et le réinsère, et le processus est répété plusieurs fois. En utilisant cette approche, Clarkson et son équipe ont construit un modèle de la façon dont le cerveau contrôle la vessie, impliquant des zones telles que l'insula, qui traite les signaux de plénitude de la vessie, et le cortex préfrontal, qui aide à déterminer quand et où il est approprié d'uriner. Deux autres zones, l'aire motrice supplémentaire (AMS) et le cortex cingulaire antérieur (ACC), semblent travailler ensemble pour détecter l'urgence d'uriner et exécuter les contractions des muscles du plancher pelvien qui nous aident à retenir notre urine jusqu'à ce que nous puissions trouver des toilettes. Chez certaines personnes souffrant d’hyperactivité vésicale, ces zones ont tendance à être plus actives, ce qui peut provoquer une sensation d’urgence accablante même lorsque leur vessie n’est que partiellement pleine. « Nous considérons cela presque comme une station d’urgence », a déclaré Clarkson. « Quand tu as la moindre envie de faire pipi, tu y vas. » Il y a quelques années, un collègue de Clarkson a remarqué que l'envie intense d'uriner qui se produit dans une vessie hyperactive est similaire à l'envie que ressentent les anciens fumeurs dans certaines situations, comme dans un bar où ils fumaient auparavant. Intrigué, Clarkson s'est associé à Cynthia Conklin, chercheuse en sevrage tabagique à l'Université de Pittsburgh, pour utiliser des méthodes issues de la recherche sur le tabagisme afin d'étudier comment les femmes souffrant d'hyperactivité vésicale réagissent aux déclencheurs personnels. On a montré aux femmes des photos d’endroits qui déclenchaient leur envie d’uriner, comme leur porte d’entrée ou l’entrée d’un supermarché. Comparé aux photos « sûres », le visionnage de ces déclencheurs a augmenté l’activité dans les zones du cerveau associées à l’attention, à la prise de décision et au contrôle de la vessie. Certaines thérapies comportementales semblent aider les femmes souffrant d’hyperactivité vésicale à réagir plus calmement aux déclencheurs urgents, a déclaré Clarkson. Par exemple, les données préliminaires de son équipe suggèrent que les techniques de pleine conscience telles que la méditation par balayage corporel peuvent encourager les participants à se détendre de la tête aux pieds et à réduire l’intensité de leur vessie. Ils ont également découvert qu’une forme non invasive de stimulation cérébrale appelée stimulation transcrânienne à courant continu (tDCS) pouvait soulager les sentiments d’urgence. © Tumblr Clarkson et son équipe ont également exploré les différences d’activité cérébrale entre les femmes qui ont répondu et celles qui n’ont pas répondu au traitement au Botox et à la thérapie des muscles du plancher pelvien, et ils étudient actuellement si la prise de médicaments pour la vessie couramment prescrits peut entraîner des changements dans le cerveau. De nombreuses femmes et hommes âgés qui cherchent un traitement pour une vessie hyperactive prennent déjà plusieurs médicaments anticholinergiques, y compris les médicaments pour la vessie les plus couramment utilisés, les antimuscariniques. Étant donné que la prise d’une trop grande quantité de ces médicaments peut entraîner des problèmes cognitifs, Clarkson espère augmenter les options de traitement non médicamenteuses. « Si nous pouvions aider les gens à arrêter de prendre des médicaments, ce serait formidable », a-t-elle déclaré. Causes de l'hyperactivité vésicale La plupart des chercheurs s'accordent à dire que le principal obstacle à la recherche de traitements plus efficaces contre l'hyperactivité vésicale est que le diagnostic est très vague : il ne s'agit pas d'une maladie unique, mais d'un ensemble de symptômes qui peuvent être causés par de nombreuses affections différentes, de la maladie de Parkinson aux lésions de la moelle épinière en passant par le diabète, ou aucune de ces affections. Mais ces cas sont souvent regroupés et évoqués comme s’il s’agissait de la même maladie, explique Aaron Mickle, neuroscientifique au Medical College of Wisconsin. Meeker étudie comment différentes conditions affectent la paroi de la vessie, l’urothélium — une couche de tissu mou et auto-renouvelable qui s’étire et s’aplatit pour s’adapter aux changements de capacité de la vessie. Bien que les scientifiques pensaient autrefois que l’urothélium était une barrière passive qui empêchait la paroi de la vessie de fuir, il est maintenant clair qu’il joue un rôle clé dans la signalisation du remplissage de la vessie. L’une des raisons pour lesquelles l’urothélium est si sensible est que bon nombre de ses cellules contiennent plusieurs types de canaux ioniques activés mécaniquement – des protéines qui se trouvent sur la membrane cellulaire et sont en fait des portes d’entrée dans la cellule. Kate Poole, physiologiste à l'Université de Nouvelle-Galles du Sud en Australie et auteur d'un article de 2022 sur les canaux ioniques activés mécaniquement chez les mammifères dans l'Annual Review of Physiology, explique que lorsque la membrane cellulaire est étirée, poussée ou déformée d'une autre manière, ces canaux s'ouvrent, permettant aux ions chargés positivement de circuler dans la cellule.[4] Les neurones sensoriels qui s’étendent jusqu’à l’urothélium contiennent ces canaux sensibles à la force ; lorsque l'afflux d'ions positifs dans ces nerfs atteint un certain seuil, ils communiquent directement avec les nerfs de la colonne vertébrale et du cerveau via des impulsions électriques. Curieusement, cependant, les cellules non neuronales de l’urothélium contiennent également une variété de canaux ioniques activés mécaniquement, ce qui suggère qu’elles peuvent également signaler le remplissage de la vessie. En 2023, Aaron Mikkel a stimulé sélectivement certaines cellules urothéliales non neuronales en utilisant l'optogénétique (activation ou désactivation à distance de cellules sélectionnées chez un animal à l'aide d'un faisceau laser). Cela a suffi à activer les neurones sensoriels et à déclencher les contractions de la vessie, une première pour un tel résultat. Mikkel espère développer à terme un système optogénétique sans fil qui pourrait surveiller et moduler en continu l’activité de types spécifiques de cellules de la vessie dans le corps humain. (Bien que l’optogénétique soit actuellement utilisée principalement sur des animaux de laboratoire, les chercheurs explorent son utilisation chez l’homme.) D’autres groupes de recherche étudient les canaux sensibles à la force dans les cellules de la vessie comme cibles médicamenteuses, ainsi que d’autres canaux qui répondent à divers produits chimiques et hormones de signalisation nerveuse. Ces canaux comprennent un groupe de protéines en forme de spirale détectant la force, appelées canaux piézoélectriques, qui jouent un rôle important dans la détection de la vessie. En 2020, une étude publiée dans la revue Nature[5] a montré que les personnes atteintes d'une mutation rare qui affecte un canal appelé Piezo2 ont du mal à détecter une vessie pleine, en plus d'autres défauts graves comme des difficultés à marcher. Certaines personnes doivent uriner selon un horaire fixe ou appuyer manuellement sur leur vessie pour la vider. L'un des nombreux canaux protéiques de détection de force présents dans la vessie, le canal Piezo2 en forme d'hélice à trois branches se trouve sur la membrane cellulaire. Il s'ouvre en réponse à des forces mécaniques telles que la tension et la pression. Récemment, des chercheurs ont découvert que les humains et les rats porteurs de mutations génétiques affectant la fonction Piezo2 ont des problèmes de miction. Ces déficiences comprennent une capacité réduite à détecter quand la vessie est pleine ou déborde. © GOULTARD59 / WIKIMEDIA COMMONS Certains scientifiques espèrent cibler les canaux Piezo2 pour traiter diverses maladies de la vessie. Selon Poole, l'un des avantages du ciblage de ces canaux est qu'ils sont « intrinsèquement médicamenteux », ce qui signifie que les chercheurs peuvent souvent trouver de petites molécules capables de les activer ou de les désactiver même s'ils répondent normalement à une stimulation mécanique. Mais il y a un inconvénient : comme d’autres canaux ioniques que les chercheurs ont essayé de cibler dans la vessie, les canaux Piezo2 se trouvent dans tout le corps, y compris dans les poumons, les articulations et le cœur. Par conséquent, tout médicament qui affecte les voies urinaires peut également affecter d’autres parties du corps, ce qui soulève des problèmes de sécurité. Michel souligne qu'un médicament qui agit sur un autre type de canal ionique dans la vessie (ces canaux permettent aux ions potassium de pénétrer dans les cellules) a déjà été testé dans des essais cliniques, mais l'essai a dû être arrêté parce qu'il a été découvert que le médicament causait des problèmes de foie. Actuellement, du moins en théorie, il existe un moyen de surmonter cet obstacle : les thérapies géniques qui ciblent spécifiquement les tissus de la vessie, comme elles sont déjà disponibles, soit injectées directement dans le muscle détrusor, soit par un cathéter dans l'urètre. En 2023, des scientifiques ont publié des données préliminaires mais encourageantes issues d’un essai portant sur 67 patients utilisant la thérapie génique pour le canal potassique de la vessie. De gauche à droite : Vessie normale lorsqu'elle est vide ; Vessie normale lorsqu’elle est pleine (sensation d’envie d’uriner lorsque la vessie est pleine) ; Vessie hyperactive (envie d’uriner même lorsque la vessie est presque vide). © AARE Urocare Bien que les scientifiques qui étudient la vessie et les voies urinaires aient traditionnellement travaillé séparément de ceux qui étudient la moelle épinière et le cerveau, ces domaines longtemps séparés commencent à collaborer pour assembler davantage de pièces du puzzle cerveau-vessie. Par exemple, Meikle s’est récemment associé à un laboratoire de neuroimagerie qui l’aidera à observer la réaction du cerveau de la souris à la stimulation optogénétique de ses cellules urothéliales. « Dans le passé, nous n’avons jamais prêté attention au cerveau », a déclaré Valentino. Mais elle a déclaré que la nouvelle recherche « nous fait réfléchir davantage à ces autres cibles ». Références : [1]www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev.pharmtox.41.1.691[2]onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/nau.24559 [2]www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-pharmtox-010617-052615 [4]www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev-physiol-060721-100935 [5]www.nature.com/articles/s41586-020-2830-7 Par Emily Underwood Traduit par tim Relecture/tamiya2 Article original/www.smithsonianmag.com/science-nature/how-do-we-know-when-to-pee-180984448/ Cet article est basé sur la licence Creative Commons (BY-NC) et est publié par Tim sur Leviathan L'article ne reflète que les opinions de l'auteur et ne représente pas nécessairement la position de Leviathan |
<<: Conférence sur les connaissances scientifiques populaires sur la prévention de la brucellose
>>: Hein? Pourquoi les pommes de terre sont-elles désormais en « expansion »...
Recommander des articles
Quels sont les effets de la pommade Binghuangfule ?
Dans la vie moderne, la technologie médicale se d...
Comment conserver les poivrons frais
Si vous ne faites pas attention à la conservation...
Quelles sont les utilisations magiques du beurre
Le beurre est un aliment riche en nutriments. Il ...
Et que pensez-vous de W Motors ? Avis sur W Motors et informations sur le site Web
Qu'est-ce que W Motors ? W Motors est le premi...
Quelles sont les valeurs normales de l’acide biliaire ? Quelle est la signification ?
La vésicule biliaire est un organe auxiliaire dig...
J'ai récemment eu des nausées et j'ai eu envie de vomir et j'ai peur d'être enceinte, mais je n'ai pas encore acheté de bandelettes de test. Comment puis-je vérifier si je suis enceinte sans utiliser de bandelettes de test ?
Vous pouvez déterminer la grossesse sans utiliser...
Quels sont les bienfaits de tremper vos pieds dans du vinaigre blanc
Il existe de nombreux bienfaits à tremper les pie...
Les étapes correctes pour l'auto-examen des seins
Les seins des femmes sont également un aspect imp...
Quelques conseils pour se débarrasser des pellicules
Bien que l'apparition de pellicules n'aff...
Comment soulager l'irritabilité
De nos jours, les gens subissent une pression rel...
Que pensez-vous de Norwegian Air Express ? Avis et informations sur le site Web de Norwegian Air Express
Qu'est-ce que le site Web de Norwegian Air Exp...
Quelles sont les causes de l'excès de graisse dorsale ?
De nombreuses personnes constatent qu'elles o...
Combien de temps peut-on vivre avec une ischémie myocardique
Le cœur est un organe très important du corps hum...