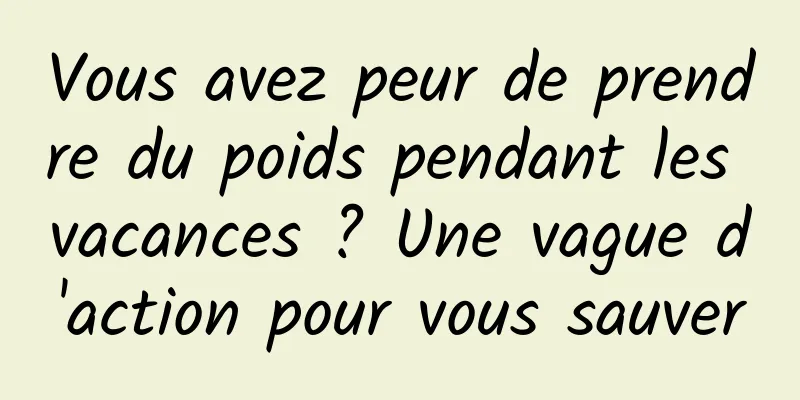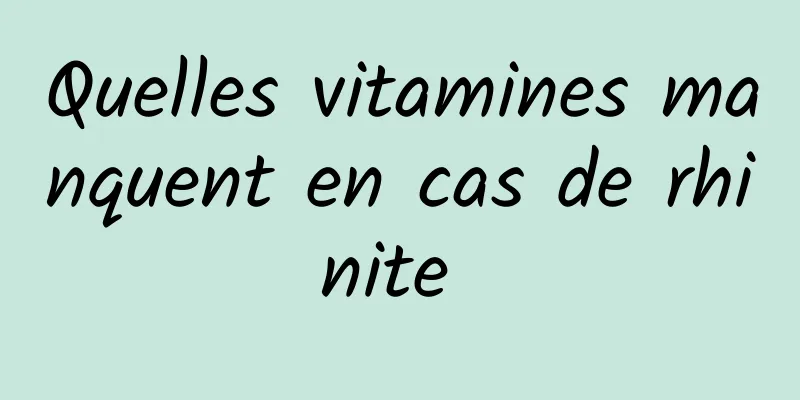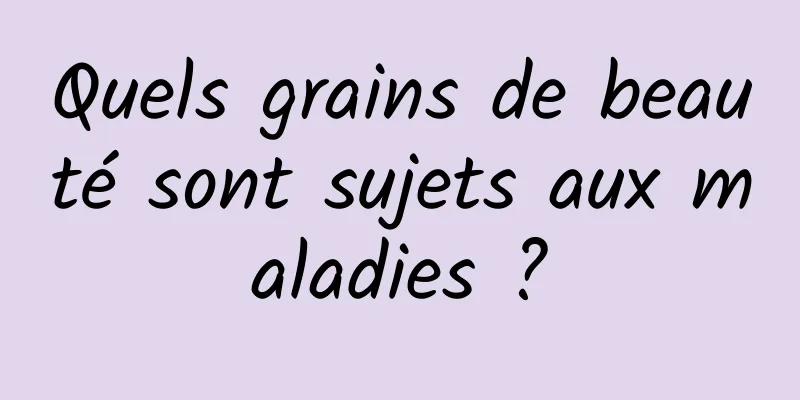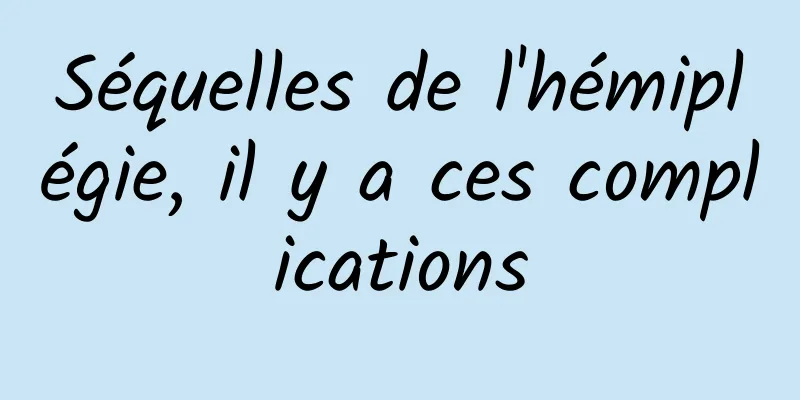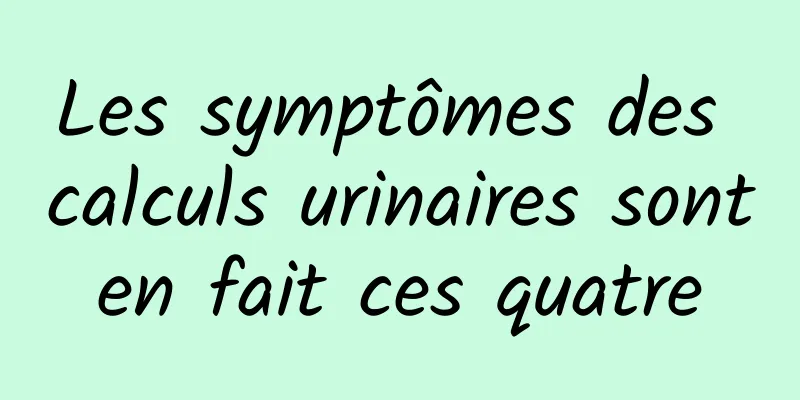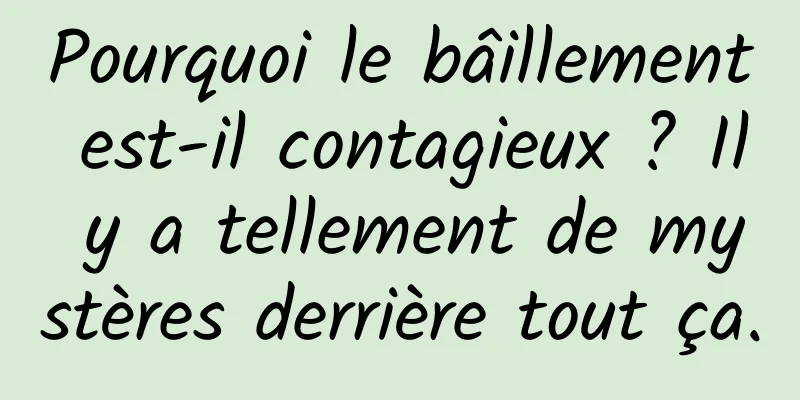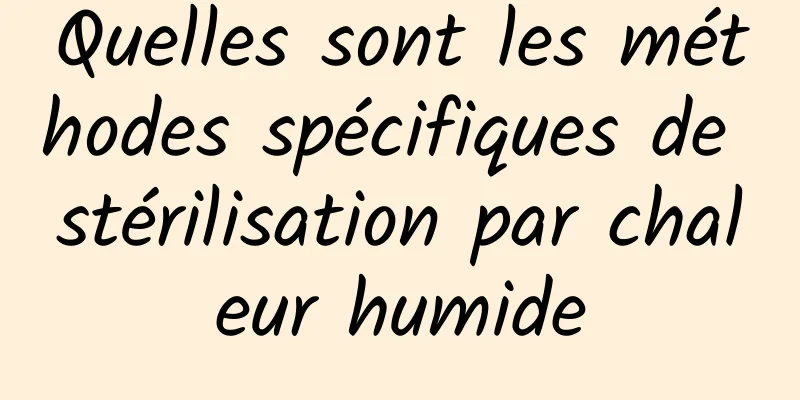Que « fait pousser » la vaccination ?
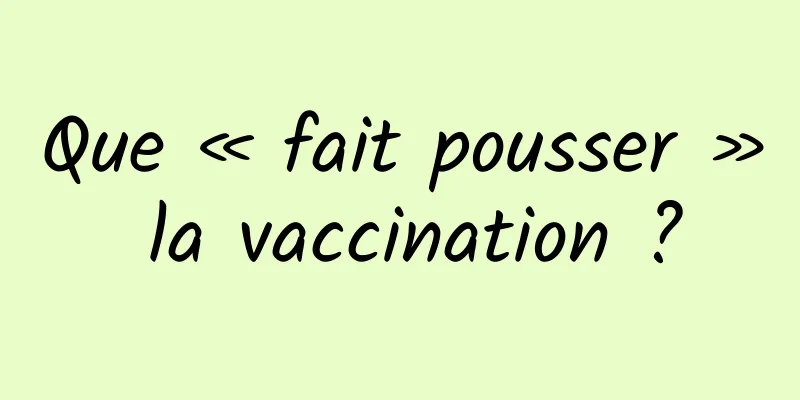
|
Auteur : Chen Dianjie, Cinquième centre médical, Hôpital général de l'APL Réviseur : Zhang Jieli, infirmière en chef adjointe, cinquième centre médical, hôpital général de l'APL Zhang Xin, médecin-chef adjoint, cinquième centre médical, hôpital général de l'APL En tant que moyen le plus efficace de prévenir les maladies infectieuses, comment fonctionne la vaccination ? Que « plante » exactement le minuscule vaccin dans notre corps ? La réponse est un petit nombre de certains agents pathogènes, qui sont des micro-organismes qui provoquent des maladies chez les humains ou les animaux. La vaccination implique-t-elle l’injection dans le corps de quelque chose qui peut provoquer une maladie ? ! Ne vous inquiétez pas, car les micro-organismes pathogènes contenus dans le vaccin sont spécialement traités. Les vaccins peuvent être divisés dans les catégories suivantes en fonction de leur composition : Vaccins inactivés : Une fois les micro-organismes pathogènes inactivés, seule l’immunogénicité (la capacité à induire une immunité) est conservée sans pathogénicité, comme le vaccin inactivé contre la polio et le vaccin inactivé contre le nouveau coronavirus ; Vaccins vivants atténués : vaccins qui ont subi un traitement spécial pour réduire la toxicité des agents pathogènes, tels que les vaccins vivants atténués contre la rougeole et les vaccins vivants atténués contre la rubéole ; Vaccin sous-unitaire : seule la structure immunogène spéciale du pathogène est extraite pour fabriquer le vaccin correspondant, tel que le vaccin recombinant contre le nouveau coronavirus ; Vaccins génétiquement modifiés : vaccins fabriqués en utilisant la technologie de recombinaison de l’ADN pour implanter du matériel génétique dans des micro-organismes pathogènes, les exprimer pleinement et les purifier ; Autres vaccins : notamment le vaccin à ARNm contre la COVID-19, le vaccin polypeptidique, etc. L’immunisation est le processus d’administration de divers vaccins dans le corps humain en utilisant différentes méthodes et voies. Les voies d’administration courantes comprennent les égratignures cutanées, les injections intradermiques, les injections sous-cutanées, les injections intramusculaires, l’administration orale et l’inhalation par nébulisation. Une fois le vaccin entré dans le corps humain, le système immunitaire produira des anticorps spécifiques contre lui. De plus, le mécanisme immunitaire du corps humain peut « se souvenir » de ces agents pathogènes, de sorte que lorsque de véritables micro-organismes pathogènes attaquent, ces anticorps peuvent produire un effet protecteur. La vaccination peut être divisée en trois types : la vaccination de routine, la vaccination d’urgence et la vaccination post-exposition. Vaccination de routine Cette forme est adoptée dans la plupart des régions de notre pays. Il s’agit également de la forme de travail de vaccination la plus couramment utilisée et la plus importante, c’est-à-dire de réaliser des vaccinations de routine sur les personnes qui doivent être vaccinées dans une zone de service fixe selon les procédures de vaccination prescrites par les autorités étatiques ou locales à une certaine période. Vaccination d'urgence Dans les zones ou unités où une maladie infectieuse s'est déclarée, une vaccination d'urgence est effectuée dans un court laps de temps pour les personnes susceptibles d'être exposées (c'est-à-dire les contacts étroits) ou les personnes entrant dans la zone épidémique en provenance de zones non épidémiques. Les vaccins pouvant être utilisés pour la vaccination d’urgence doivent pouvoir produire une immunité rapidement après la vaccination et ne doivent pas être dangereux pour les personnes pendant la période d’incubation après la vaccination. Par exemple, la période d’incubation de la rougeole est généralement de 7 à 14 jours et les anticorps peuvent être produits environ 7 jours après la vaccination. Par conséquent, la vaccination des personnes sensibles pendant une épidémie peut contrôler la propagation de l’épidémie ou y mettre fin. Vaccination post-exposition La vaccination post-exposition est la vaccination des personnes qui ont déjà été exposées. Par exemple, se faire vacciner contre la rage après avoir été mordu par un chat ou un chien, se faire vacciner contre l’hépatite B après avoir été piqué par une aiguille utilisée par un patient atteint d’hépatite B, etc. Rappel chaleureux : Veuillez garder vos animaux de compagnie de manière civilisée et veillez à ne pas blesser les autres ou vous-même ! Afin d'obtenir de meilleurs effets préventifs, ce type de vaccination peut être utilisé simultanément avec des préparations d'immunisation passive (immunoglobulines spécifiques). Plus la vaccination est effectuée tôt après l’exposition, meilleur est l’effet. En règle générale, la première vaccination doit être effectuée dans les 24 heures suivant l’exposition. Figure 1 (image protégée par le droit d'auteur de la galerie, reproduction non autorisée) Bien que la vaccination puisse réduire considérablement l’incidence des maladies qu’elle prévient, elle ne peut pas garantir à 100 % que vous ne contracterez pas la maladie pour les raisons suivantes. Certaines maladies ont de nombreux agents pathogènes différents ou sont sujettes à mutation Si le vaccin ne peut pas couvrir tous les agents pathogènes ou si l’agent pathogène mute, le vaccin d’origine perdra son efficacité. Par exemple, le vaccin actuel contre la maladie mains-pieds-bouche ne cible que la maladie mains-pieds-bouche causée par l’EV71 (entérovirus 71). Cependant, il existe plus de 20 types d’entérovirus qui provoquent la maladie mains-pieds-bouche. En cas d’infection par d’autres types d’entérovirus, le vaccin perdra son effet préventif. Figure 2 (image protégée par le droit d'auteur de la galerie, reproduction non autorisée) Après la vaccination, le corps n’a pas eu le temps de produire des anticorps Après la vaccination, le corps humain ne produit pas immédiatement d’anticorps. Au lieu de cela, il faut un processus qui prend généralement 1 à 2 semaines. Si vous entrez en contact avec des agents pathogènes pendant cette période, il existe toujours un risque d’infection. La vaccination a échoué, l’immunité a échoué Presque aucun vaccin ne peut atteindre un taux de protection de 100 %. Le taux de protection de la plupart des vaccins se situe entre 80 % et 95 %. De plus, 5 à 20 % des personnes ne sont pas vaccinées et ne parviennent pas à produire des anticorps et peuvent néanmoins tomber malades. Par exemple, les anticorps de certaines personnes restent négatifs après avoir reçu le vaccin contre le virus de l’hépatite B et ne peuvent pas fournir de protection. La cause spécifique de l’échec immunitaire n’est pas encore claire et peut être liée à la constitution individuelle. |
>>: Je démange, je gratte, donc j'existe - les secrets scientifiques des démangeaisons
Recommander des articles
Quelle est la cause de l'inflammation anale ? De quelle maladie peut-il s'agir ?
L'anus est plus sensible aux infections. Si l...
Comment nettoyer le tartre d'un distributeur d'eau
La consommation régulière d'eau contenant du ...
Que diriez-vous de 7-Up ? Avis et informations sur le site Web de 7Up
Quel est le site Web de 7Up ? 7.Up est une célèbre...
Calories des noyaux d'arachide
Les cacahuètes contiennent également une certaine...
Quelles sont les méthodes pour éliminer le tartre des aquariums
De nombreux amis aiment élever des poissons à la ...
Comment utiliser la suspension sèche d'oseltamivir, un médicament anti-grippal ? Pharmacien pour vous aider
L'oseltamivir est l'un des médicaments ef...
Son! Euphonium Extra Edition : L'attrait et l'évaluation de la série Euphonium en tant qu'OVA
Retentir! Euphonium Extra Edition - Hibike Euphon...
Quels sont les dangers des nouilles ramen pour le corps humain
Il existe aujourd'hui de nombreux restaurants...
Que pensez-vous de Zhaohuastein Real Estate ? Avis sur Zhaohuastein Real Estate et informations sur le site Web
Quel est le site Web de Zhaohuastein Real Estate ?...
L'intoxication au monoxyde de carbone est-elle douloureuse ? Les symptômes sont les suivants :
En parlant d'intoxication au monoxyde de carb...
L'attrait et les critiques de la saison 1 de Kaibutsu-kun : Creuser plus profondément dans le monde des monstres
« Kaibutsu-kun » Saison 1 : Retour sur les classi...
Et que diriez-vous du village folklorique coréen ? Avis et informations sur le site Web du Korean Folk Village
Qu'est-ce que le site Web du Korean Folk Villa...
De combien de calories avez-vous besoin par jour ?
De nos jours, de nombreuses personnes suivent un ...
Quelle est la marque des chaussures de sport de Zhuge Dali dans Love Apartment 5 ? Combien coûtent les mêmes chaussures de sport que celles de Zhuge Dali ?
Love Apartment 5 vient d'atteindre sa finale....
Nettoyage des chaussures de gommage
Les chaussures mates sont également un type de ch...