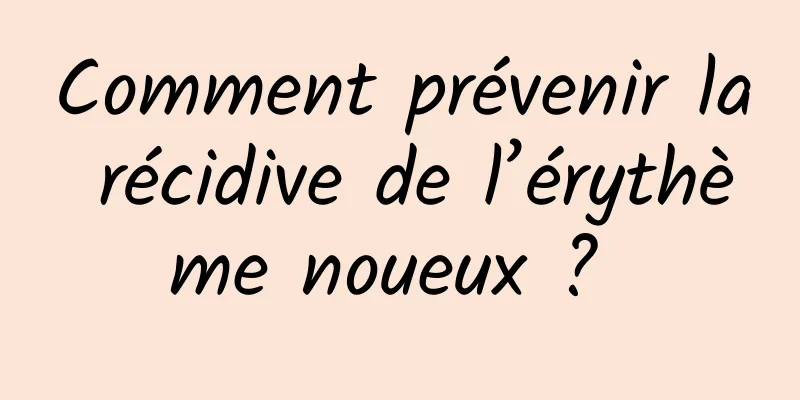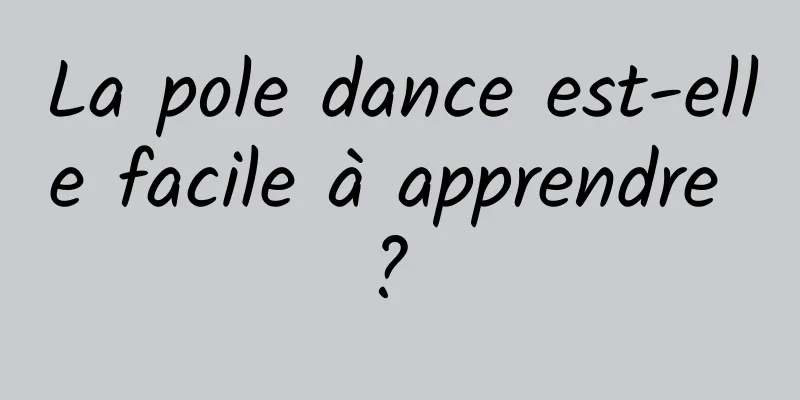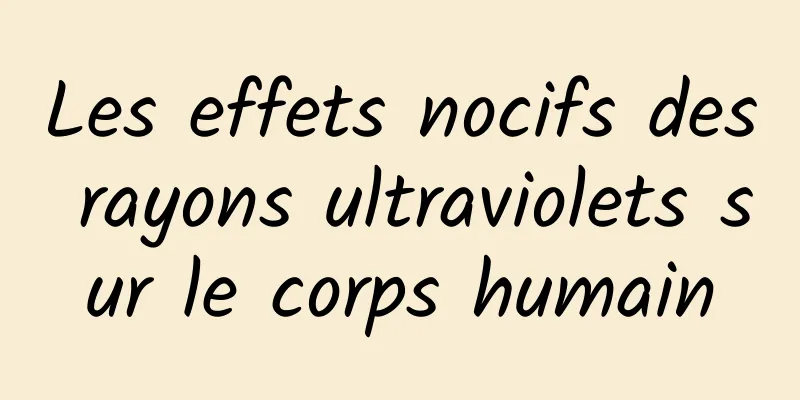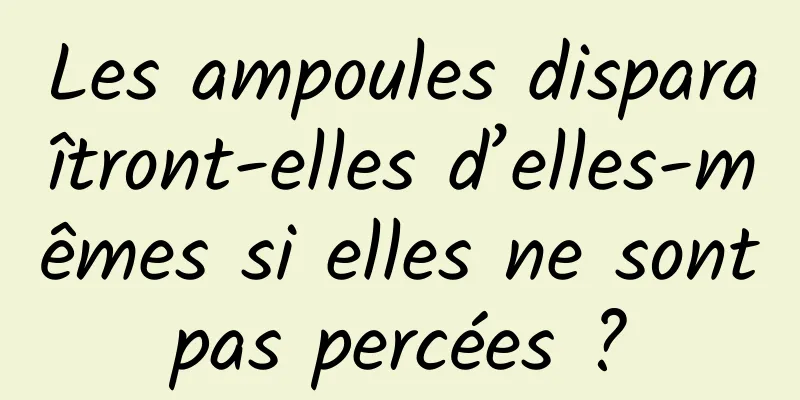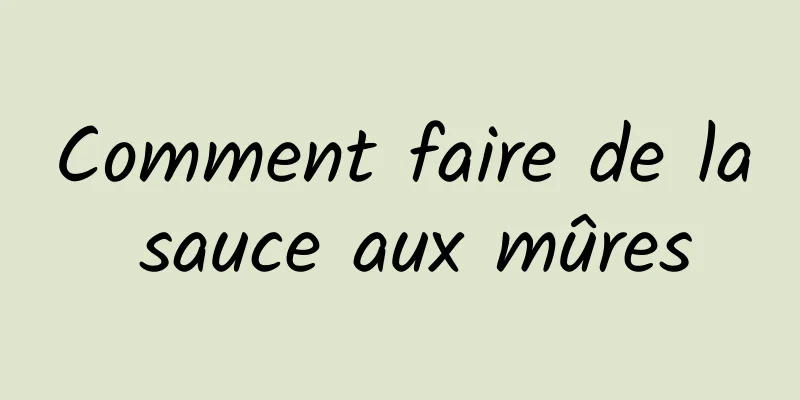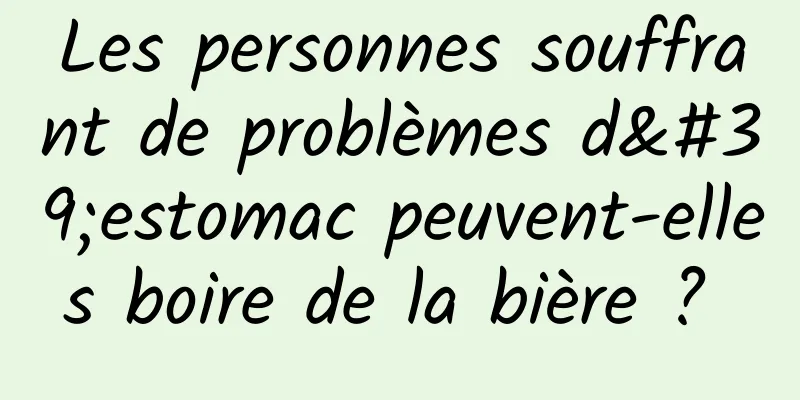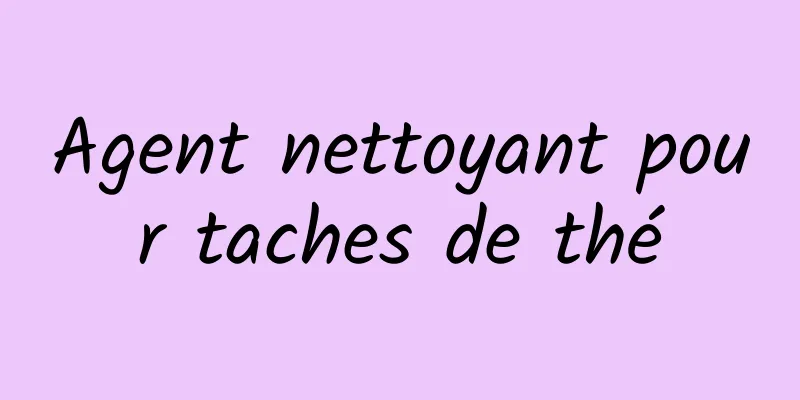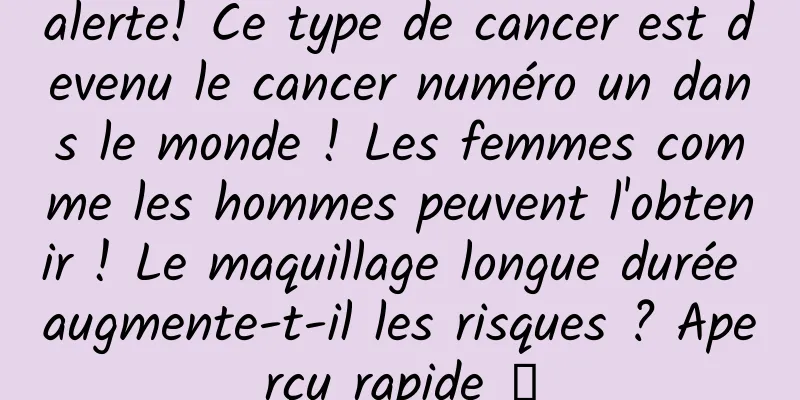Les armes secrètes et les conseils de culture des moustiques - Journée mondiale des moustiques
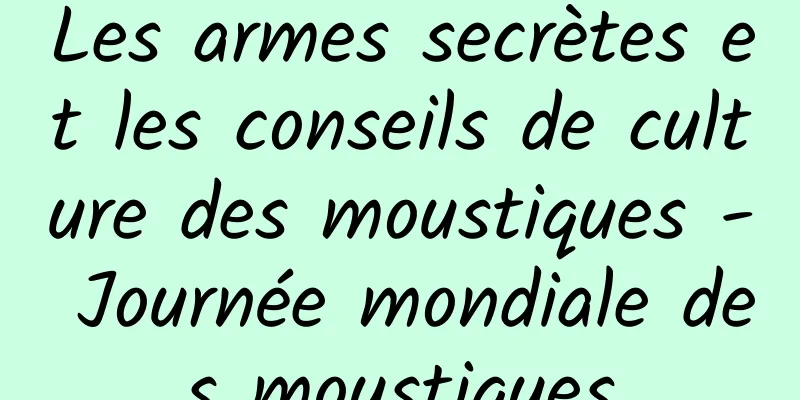
|
Le 20 août est la « Journée mondiale contre les moustiques ». Il ne s’agit pas ici de célébrer les moustiques. La principale raison de l’instauration de cette journée commémorative est de sensibiliser la population aux maladies infectieuses transmises par les moustiques, comme le paludisme. Les moustiques peuvent être porteurs de nombreux agents pathogènes dangereux, que l’on peut appeler leurs « armes secrètes ». Alors comment les transmettent-ils aux humains ? Ces dernières années, les scientifiques ont déployé de grands efforts pour comprendre l’efficacité vectorielle des moustiques et ont découvert de nombreux « secrets de culture » des moustiques. Rédigé par Chen Lu (Département des sciences médicales fondamentales, École de médecine, Université Tsinghua) , Liu Jianying (Institut des maladies infectieuses, Laboratoire de la baie de Shenzhen) , Cheng Gong (Département des sciences médicales fondamentales, École de médecine, Université Tsinghua) Les moustiques, insectes suceurs de sang courants, ont toujours été considérés comme une nuisance en été, mais les menaces pour la santé qui se cachent derrière eux dépassent de loin la cognition des gens. Les moustiques sont porteurs de nombreuses maladies importantes, et il n’est pas exagéré de les appeler « les ailes de la mort ». Les maladies transmises par les moustiques sont des maladies qui se propagent par les piqûres de moustiques. Parmi eux, le paludisme, la dengue, la fièvre jaune, la maladie à virus Zika, etc. sont des exemples typiques que les gens connaissent bien. Le nombre de décès et de maladies causés par ces maladies chaque année reste élevé, ce qui constitue une grave menace pour la sécurité de la santé publique mondiale. Afin de sensibiliser aux maladies infectieuses transmises par les moustiques, telles que le paludisme, le 20 août de chaque année est désigné comme la Journée mondiale du moustique. Aujourd’hui, voyons comment les moustiques sont devenus les « ennemis à vie » des humains. Paludisme : la plus ancienne maladie transmise par les moustiques Le paludisme est sans aucun doute la maladie transmise par les moustiques la plus mortelle pour l’homme. Dans de nombreux pays où le paludisme est répandu, il constitue la principale cause de maladie et de décès. Ses symptômes typiques sont des frissons récurrents, de la fatigue, des vomissements et des maux de tête. Si elle n’est pas traitée rapidement, la maladie peut évoluer vers une jaunisse, une splénomégalie, une anémie, une épilepsie et même la mort. Le taux de mortalité mondial du paludisme est de 0,3 à 2,2 %, tandis que le taux de mortalité du paludisme grave peut atteindre 30 %. L’ampleur et la profondeur de l’impact du paludisme sont devenues un problème de santé mondial. On estime à 200 millions le nombre de cas de paludisme chaque année, entraînant des centaines de milliers de décès[1] . Plus choquant encore, les historiens spéculent que le paludisme pourrait avoir causé la mort d’environ 6 milliards de personnes depuis le début de l’histoire de l’humanité [2]. Le paludisme est l’une des maladies les plus anciennes de l’histoire de l’humanité. Des documents anciens montrent que le paludisme a ravagé les principales civilisations, de la Chine à la Mésopotamie, de l’Égypte à l’Inde. Déjà dans la Grèce antique, on remarquait que les personnes vivant dans des zones marécageuses souffraient souvent de fièvre et d’une rate hypertrophiée. À cette époque, les gens pensaient généralement que cela était dû à l'inhalation du « miasme » produit dans les marais. Le mot paludisme « malaria » vient de « mala » (mauvais) + « aria » (air). Ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle que les scientifiques ont commencé à mieux comprendre la maladie. En 1880, le Dr Charles Louis Alphonse Laveran découvre un organisme très particulier dans le sang des patients atteints de paludisme : le Plasmodium (Figure 1). Il a observé que l’organisme était non seulement capable de se déplacer, mais également de se reproduire au sein de son hôte, provoquant finalement l’apparition du paludisme. Depuis lors, l’humanité a commencé la lutte scientifique contre le paludisme. Figure 1. Illustration du Plasmodium falciparum par Alphonse Laveran[3]. Source de l'image : Référence [3] Le mécanisme de transmission des parasites du paludisme a autrefois intrigué les scientifiques. Bien que l’on sache que les moustiques transmettent le parasite de la filariose, les transmetteurs spécifiques du parasite du paludisme restent un mystère. Ronald Ross, un médecin militaire en poste en Inde, a examiné des milliers de moustiques dans une zone infectée par le paludisme, mais n'a trouvé aucune trace du parasite Plasmodium. Cependant, lorsqu'il a essayé de donner le sang de patients atteints de paludisme à différentes espèces de moustiques, il a trouvé des sporozoïtes de Plasmodium dans une espèce de moustique Anopheles. En 1899, Ross a utilisé avec succès des moustiques Anopheles infectés par Plasmodium vivax pour infecter son fils étudiant en médecine et un volontaire, confirmant ainsi que les moustiques Anopheles étaient les vecteurs du paludisme[4]. Il a plus tard appelé le jour où il a découvert les spores de Plasmodium, le 20 août 1897, « Jour du moustique ». Cette journée est désormais célébrée comme la « Journée mondiale du moustique » et les gens se souviendront toujours de la contribution de Ross. On a également découvert que le paludisme ne pouvait être transmis que par les moustiques, et ce n’est qu’en 1957 que le cycle de vie du parasite Plasmodium dans le corps humain a été entièrement compris. Lorsqu'un moustique anophèle infecté par Plasmodium pique un humain, les sporozoïtes de Plasmodium présents dans ses glandes salivaires pénètrent dans le corps humain avec la salive. Les sporozoïtes se déplacent ensuite rapidement via la circulation sanguine vers le foie, infectent les hépatocytes, mûrissent et se multiplient à cet endroit. Cette étape est considérée comme la période d’incubation et il n’y a pas de symptômes cliniques. Une fois que le parasite du paludisme a terminé sa multiplication et sa réplication, un grand nombre de mérozoïtes sont libérés des hépatocytes infectés et envahissent les globules rouges. À ce moment-là, la personne infectée commencera à développer des symptômes cliniques et pourra même mourir[5]. Les deux principaux médicaments antipaludiques actuellement utilisés sont dérivés de deux plantes importantes : l’artémisinine de la plante Artemisia annua et la quinine de la plante Cinchona. La quinine et l’artémisinine sont aujourd’hui les médicaments antipaludiques les plus efficaces. À ce stade, l’histoire de l’exploration humaine du Plasmodium est enfin pratiquement terminée. Depuis la création du prix Nobel il y a plus de 120 ans, la recherche sur le paludisme a remporté quatre prix : en 1902, il a été décerné à Ronald Ross pour avoir confirmé que les moustiques Anopheles sont le vecteur du paludisme et pour avoir clarifié l'histoire du développement du Plasmodium ; en 1907, il fut décerné à Alphonse Laveran pour la découverte du Plasmodium dans les cellules sanguines ; en 1965, il a été décerné à Robert Burns Woodward pour la première synthèse artificielle de la quinine ; et en 2015, il a été décerné à Tu Youyou pour avoir isolé un nouveau médicament antipaludique : l'artémisinine. Dans la longue histoire de la lutte humaine contre le paludisme, ils ont joué un rôle marquant dans l’histoire de la médecine. La fièvre jaune : la plus ancienne maladie virale transmise par les moustiques Outre les parasites, les virus sont également des facteurs clés dans la propagation des maladies transmises par les moustiques. Le virus de la fièvre jaune a été le premier virus dont la transmission par les moustiques a été confirmée. Les données historiques montrent qu'il y a eu des enregistrements d'épidémies de fièvre jaune au Mexique dès 1648. Au cours des 200 années suivantes, la fièvre jaune est restée l'une des maladies infectieuses les plus mortelles et les plus redoutées, causant des pertes massives en Afrique et dans les Amériques.[6] L’infection par le virus de la fièvre jaune peut se présenter sous différentes formes cliniques, telles qu’une maladie autolimitée avec fièvre, douleurs musculaires, maux de tête, nausées et vomissements, et d’autres symptômes similaires à ceux d’une grippe légère ; dans la plupart des cas, les symptômes disparaissent après 3 à 4 jours. Cependant, un petit nombre de patients entreront dans une deuxième phase, plus toxique, dans les 24 heures, au cours de laquelle ils pourront présenter une forte fièvre récurrente, des saignements, une jaunisse, des urines foncées, une insuffisance hépatique et rénale, etc. La moitié des patients récurrents décèdent dans les 7 à 10 jours [7] (Figure 2). Figure 2. Les quatre stades cliniques de la fièvre jaune tels que décrits au XIXe siècle. Crédit image : Etienne Pariset et André Mazet. 1820. Quatre illustrations montrant la progression de la fièvre jaune. Avant le 19e siècle, les gens n’étaient pas certains de la cause et du mode de transmission de la fièvre jaune. Ce n'est qu'en 1881 que le médecin cubain Carlos Juan Finlay a proposé « l'hypothèse du moustique », basée sur l'épidémiologie, selon laquelle les moustiques pourraient propager la fièvre jaune, ce qui a jeté les bases des recherches scientifiques ultérieures sur la fièvre jaune. En 1901, Walter Reed a mené une étude utilisant des piqûres de moustiques sur des volontaires humains et a confirmé que les moustiques Aedes étaient le principal vecteur de la fièvre jaune. Les mesures d’intervention ultérieures contre les moustiques mises en œuvre à Cuba ont permis de contrôler l’incidence de la fièvre jaune. De plus, Reed a observé que la fièvre jaune était causée par des substances présentes dans le sang du patient qui pouvaient passer à travers des pores extrêmement petits, indiquant que l'agent pathogène de la fièvre jaune était beaucoup plus petit que les bactéries. Ce n’est cependant qu’en 1927 que le virus de la fièvre jaune a été isolé, devenant ainsi le premier virus humain isolé de l’histoire[8] . Plus tard, Max Theiler a découvert que la toxicité du virus de la fièvre jaune diminuait progressivement après plusieurs passages chez l'animal. Après des années d’expériences, Theil a finalement isolé une souche atténuée appelée 17D. Le 17D a une très faible virulence, mais il est capable d’induire une réponse immunitaire protectrice. Sur cette base, Theil a développé un vaccin contre la fièvre jaune qui confère une immunité jusqu'à 30 à 35 ans après la vaccination et est considéré comme l'un des vaccins les plus efficaces jamais développés .[9] Max Theil a également remporté le prix Nobel de 1951 pour cela. La dengue : une maladie potentiellement mortelle sous les tropiques La dengue est une maladie virale tropicale aiguë causée par le virus de la dengue, dont il existe quatre sérotypes. Elle se transmet principalement par les piqûres d’Aedes aegypti et d’Aedes albopictus. La maladie est largement répandue dans les régions tropicales et subtropicales. Des épidémies de dengue ont été signalées dans le Guangdong, le Fujian, le Yunnan et à Taiwan, dans mon pays. La plupart des personnes infectées par le virus de la dengue sont asymptomatiques, tandis que l'infection symptomatique se présente souvent sous forme de symptômes grippaux, tels qu'une forte fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et articulaires, des éruptions cutanées, etc. Dans les cas graves, elle peut entraîner des saignements, un choc et même la mort[10]. En 2019, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classé la dengue parmi les dix principales maladies potentiellement menaçantes. À l’échelle mondiale, environ 3,5 milliards de personnes risquent d’être infectées par le virus de la dengue. On estime que les cas de dengue ont augmenté de 600 % entre 1999 et 2019 [11] . La prévalence de la dengue continuera de croître en raison de la mobilité de la population mondiale, du changement climatique et de l’expansion continue de l’urbanisation. En juillet 2023, l’OMS a averti que le nombre d’infections à la dengue dans le monde pourrait atteindre un niveau record cette année, car le réchauffement climatique facilite la croissance des moustiques et la propagation des maladies transmises par les moustiques. Encéphalite japonaise : la menace invisible de l'Asie Contrairement au virus de la dengue, le virus de l’encéphalite japonaise (JEV) est généralement transmis par les moustiques Culex, et le cycle naturel du virus implique plusieurs hôtes vertébrés. Les porcs et les oiseaux aquatiques sont considérés comme les deux hôtes les plus importants pour l’amplification du JEV. Bien qu’ils soient généralement asymptomatiques après l’infection, ils peuvent développer une virémie élevée suffisante pour transmettre le virus aux moustiques. Les humains et les chevaux sont considérés comme des hôtes accidentels du JEV et ne sont pas des sources importantes d’infection par le JEV pour les moustiques. Après une infection par le JEV, les humains ne présentent qu'une virémie de faible intensité et transitoire, mais moins de 1 % des personnes infectées présenteront des symptômes d'encéphalite mortelle[12] . Le virus de l’encéphalite japonaise est principalement répandu en Asie, notamment en Chine, en Corée du Sud, au Japon et en Thaïlande, et constitue la principale cause d’encéphalite virale dans ces pays. Le JEV peut provoquer une maladie neurologique grave. Les symptômes au stade aigu de l’encéphalite peuvent inclure une raideur de la nuque, une hémiplégie, des convulsions et une forte fièvre. Il s’agit d’une maladie très grave et le taux de mortalité des patients atteints d’encéphalite peut atteindre 30 %. 30 à 50 % des patients survivants peuvent souffrir de handicaps intellectuels, comportementaux ou neurologiques permanents, tels que la surdité, la paralysie et l’incapacité de parler [13]. La maladie à virus Zika : une nouvelle menace pour la santé publique Le virus Zika a été isolé à l’origine chez un macaque sentinelle dans la forêt de Zika en Ouganda en 1947. Avant 2007, le virus Zika circulait discrètement dans de nombreuses régions d’Afrique et d’Asie sans provoquer de maladie grave ni d’épidémies à grande échelle. La plupart des personnes infectées par le virus Zika présentent des symptômes relativement légers qui peuvent inclure de la fièvre, des douleurs articulaires, des éruptions cutanées et une conjonctivite. Cependant, en 2015-2016, le virus Zika a attiré une attention mondiale généralisée. Rien qu’en 2015, le Brésil a signalé des millions de cas d’infection par le virus Zika. Bien que l’infection par le virus Zika soit rarement directement mortelle, elle peut provoquer le syndrome de Guillain-Barré, une maladie immunitaire rare. Si la personne infectée est une femme enceinte, le virus peut également provoquer une microcéphalie congénitale chez le fœtus et provoquer une fausse couche[14, 15]. Recherche sur le mécanisme de transmission des virus transmis par les moustiques Tout le monde sait que les moustiques transmettent des agents pathogènes aux animaux lorsqu’ils sucent le sang, mais comment fonctionnent les virus chez les moustiques ? Dans le domaine des maladies transmises par les moustiques, ce numéro se concentre principalement sur l'étude de la compétence vectorielle des moustiques, c'est-à-dire la capacité des moustiques à acquérir, maintenir et transmettre des virus transmis par les insectes. Tout d’abord, nous devons comprendre que seules certaines espèces de moustiques femelles ont besoin de sucer du sang pour se nourrir pendant le cycle d’éclosion des œufs, tandis que la plupart des moustiques se nourrissent de nectar et de sève des plantes. Des études ont montré qu’après que les moustiques ont sucé le sang contenant le virus, celui-ci pénètre dans l’intestin moyen et établit une réplication stable dans les cellules épithéliales de l’intestin moyen du moustique ; le virus est ensuite libéré dans l'hémolymphe du moustique et se propage aux tissus systémiques du moustique, tels que les corps adipeux, les cellules de l'hémolymphe, les muscles, les glandes salivaires et les tissus nerveux ; le virus s'accumule ensuite dans les glandes salivaires et, lors du prochain processus de succion du sang, l'agent pathogène pénètre dans l'hôte suivant avec les anticoagulants et les allergènes présents dans la salive (Figure 3). La salive des moustiques a été identifiée comme facilitant la transmission des virus transmis par les moustiques aux hôtes et a été impliquée dans le développement des maladies associées. Figure 3. Processus par lequel les moustiques sont infectés et propagent le virus. Source de l'image : Snodgrass, Robert Evans. 1959. « La vie anatomique du moustique. » Collections diverses du Smithsonian, 139, (8), 1–87. De toute évidence, les moustiques ne peuvent acquérir le virus et continuer à le propager que lorsqu’ils se nourrissent de personnes infectées. Alors pourquoi les moustiques peuvent-ils trouver si facilement des personnes infectées ? L’odeur corporelle humaine est un facteur clé dans la régulation du comportement des moustiques. Le virus de la dengue et le virus Zika peuvent réguler les micro-organismes cutanés des personnes infectées et remodeler leur odeur, affectant ainsi la perception olfactive des moustiques, permettant aux moustiques de localiser efficacement les personnes infectées et de sucer le sang contenant le virus[16]. Des études récentes ont montré que des composants présents dans le sang de l’hôte (tels que les ions fer [17] et la protéine virale non structurale sécrétée NS1 [18] ) peuvent réguler l’acquisition du virus par les moustiques. En plus des composants sanguins de l’hôte, les symbiotes intestinaux des moustiques jouent également un rôle important dans l’acquisition du virus. Il existe une flore microbienne intestinale riche et nombreuse dans l'intestin du moustique. Des études ont montré qu'il existe un type de Serratia marcescens dans les intestins des moustiques Aedes qui peut aider les virus à infecter les intestins du moustique, augmentant considérablement la sensibilité des moustiques Aedes aux virus transmis par les moustiques [19] . Dans une étude récente, des chercheurs ont découvert qu’une protéine salivaire peut considérablement améliorer l’infection des cellules immunitaires des mammifères par le virus Zika et le virus de la dengue, prouvant qu’il s’agit d’un facteur clé qui favorise la transmission des virus transmis par les moustiques [20]. Ces études révèlent non seulement les interactions entre les hôtes, les moustiques vecteurs et les virus, mais fournissent également de nouvelles cibles d’intervention et des idées pour la prévention et le contrôle des virus importants transmis par les moustiques. Ces dernières années, les progrès réalisés dans le domaine des infections virales transmises par les moustiques et de leur transmission ont été passionnants, et un grand nombre d’études ont révélé les relations complexes entre les hôtes, les moustiques vecteurs et les virus. Bien que la compréhension des chercheurs sur les interactions entre les moustiques, les virus et les hôtes s’élargit rapidement, il existe encore de nombreux mystères déroutants qui doivent être étudiés en profondeur, comme la façon dont les moustiques tolèrent la réplication virale sans produire de réactions pathologiques graves ; pourquoi différents virus préfèrent différentes espèces de moustiques pour la transmission ; et comment le contexte génétique et les différences environnementales affectent l’efficacité vectorielle des moustiques. Après des centaines de millions d’années d’évolution, les moustiques ont toujours accompagné l’évolution de l’humanité. Il est prévisible qu’ils continueront d’affecter notre survie. Par conséquent, la manière de réduire efficacement la menace que représentent les moustiques pour les humains et de coexister pacifiquement avec eux seront des sujets importants que nous continuerons d’explorer à l’avenir. Nous devons explorer davantage les mécanismes d’interaction entre les moustiques et les agents pathogènes afin de développer des stratégies de contrôle et de prévention plus efficaces. En outre, le renforcement de l’éducation en matière de santé publique et la sensibilisation de la population à la transmission des virus transmis par les moustiques sont également essentiels à la prévention. Les scientifiques, les médecins et la communauté ont tous un rôle important à jouer pour relever ces défis. La collaboration et l’innovation seront essentielles pour résoudre ces problèmes. En travaillant ensemble, nous pouvons espérer établir une coexistence plus harmonieuse avec les moustiques tout en protégeant la santé humaine. Références [1] Organisation, WH (2022). Rapport mondial sur le paludisme 2022 (Organisation mondiale de la santé). [2] Whitfield, J. (2002). Portrait d'un tueur en série. Nature 3. [3] Bruce-Chwatt, LJ (1981). La découverte d'Alphonse Laveran il y a 100 ans et la lutte mondiale contre le paludisme aujourd'hui. Journal de la Société royale de médecine 74, 531-536. [4] Cox, FE (2010). Histoire de la découverte des parasites du paludisme et de leurs vecteurs. Parasites et vecteurs 3, 1-9. [5] Varo, R., Chaccour, C. et Bassat, Q. (2020). Mise à jour sur le paludisme. Medicina Clínica (édition anglaise) 155, 395-402. [6] Barrett, AD, et Higgs, S. (2007). La fièvre jaune : une maladie qui n’a pas encore été vaincue. Année. Rév. Entomol. 52, 209-229. [7] Douam, F., et Ploss, A. (2018). Virus de la fièvre jaune : des lacunes dans les connaissances entravent la lutte contre un vieil ennemi. Tendances en microbiologie 26, 913-928. [8] Staples, JE, et Monath, TP (2008). Fièvre jaune : 100 ans de découverte. Jama 300, 960-962. [9] Monath, TP (2005). Vaccin contre la fièvre jaune. Revue d'experts des vaccins 4, 553-574. [10] Pierson, TC, et Diamond, MS (2020). La menace persistante des flavivirus émergents. Nature microbiologie 5, 796-812. [11] Organisation, WH (2022). Réunion virtuelle du Groupe consultatif technique régional pour la dengue et d'autres maladies à arbovirus, New Delhi, Inde, 4-6 octobre 2021. Organisation mondiale de la santé. Bureau régional pour l'Asie du Sud-Est. [12] Misra, Royaume-Uni, et Kalita, J. (2010). Présentation : encéphalite japonaise. Progrès en neurobiologie 91, 108-120. [13] Campbell, GL, Hills, SL, Fischer, M., Jacobson, JA, Hoke, CH, Hombach, JM, Marfin, AA, Solomon, T., Tsai, TF, et Tsu, VD (2011). Estimation de l’incidence mondiale de l’encéphalite japonaise : une revue systématique. Bulletin de l'Organisation mondiale de la santé 89, 766-774. [14] Mlakar, J., Korva, M., Tul, N., Popović, M., Poljšak-Prijatelj, M., Mraz, J., Kolenc, M., Resman Rus, K., Vesnaver Vipotnik, T. et Fabjan Vodušek, V. (2016). Virus Zika associé à une microcéphalie. Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre 374, 951-958. [15] Musso, D., Ko, AI, et Baud, D. (2019). Infection par le virus Zika – après la pandémie. Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre 381, 1444-1457. [16] Zhang, H., Zhu, Y., Liu, Z., Peng, Y., Peng, W., Tong, L., Wang, J., Liu, Q., Wang, P., et Cheng, G. (2022). Un composé volatil provenant du microbiote cutané des hôtes infectés par le flavivirus favorise l’attractivité des moustiques. Cellule 185, 2510-2522. e2516. [17] Zhu, Y., Tong, L., Nie, K., Wiwatanaratanabutr, I., Sun, P., Li, Q., Yu, X., Wu, P., Wu, T. et Yu, C. (2019). Le fer sérique de l’hôte module l’acquisition du virus de la dengue par les moustiques. Nature Microbiologie 4, 2405-2415. [18] Liu, J., Liu, Y., Nie, K., Du, S., Qiu, J., Pang, X., Wang, P. et Cheng, G. (2016). La protéine NS1 du flavivirus dans les sérums d'hôtes infectés améliore l'acquisition virale par les moustiques. Nat Microbiol 1, 16087. 10.1038/nmicrobiol.2016.87. [19] Wu, P., Sun, P., Nie, K., Zhu, Y., Shi, M., Xiao, C., Liu, H., Liu, Q., Zhao, T., et Chen, X. (2019). Une bactérie commensale intestinale favorise la permissivité des moustiques envers les arbovirus. Hôte cellulaire et microbe 25, 101-112. e105. [20] Sun, P., Nie, K., Zhu, Y., Liu, Y., Wu, P., Liu, Z., Du, S., Fan, H., Chen, C.-H., et Zhang, R. (2020). Une protéine salivaire de moustique favorise la transmission du flavivirus par activation de l'autophagie. Nature communications 11, 260. Cet article est soutenu par le projet de vulgarisation scientifique « Chine Ciel étoilé ». Produit par : Association chinoise pour la science et la technologie, Département de vulgarisation scientifique Producteur : China Science and Technology Press Co., Ltd., Beijing Zhongke Xinghe Culture Media Co., Ltd. Conseils spéciaux 1. Accédez à la « Colonne en vedette » en bas du menu du compte public WeChat « Fanpu » pour lire une série d'articles de vulgarisation scientifique sur différents sujets. 2. « Fanpu » offre la fonction de recherche d'articles par mois. Suivez le compte officiel et répondez avec l'année à quatre chiffres + le mois, comme « 1903 », pour obtenir l'index des articles de mars 2019, et ainsi de suite. Déclaration de droits d'auteur : Les particuliers sont invités à transmettre cet article, mais aucun média ou organisation n'est autorisé à le réimprimer ou à en extraire des extraits sans autorisation. Pour obtenir une autorisation de réimpression, veuillez contacter les coulisses du compte public WeChat « Fanpu ». |
<<: Les avantages et les inconvénients du « riz des Blancs »
>>: Mission 23 secondes | Hommage à tous les médecins chinois
Recommander des articles
L'attrait et les critiques de Lupin III PARTIE 6 : Creuser plus profondément dans une nouvelle aventure
Lupin, troisième partie 6 : critique et détails a...
Quels sont les avantages de revenir en arrière
Le roulage du dos peut améliorer efficacement la ...
Après avoir mangé de la fondue chinoise pendant une semaine, le gars a eu un orgelet. Les experts nous le rappellent : le tonique hivernal doit être modéré
Un homme de 25 ans a mangé du hotpot épicé pendan...
Quels sont les bienfaits du trempage des pieds
Le bain de pieds est un très bon moyen de rester ...
Peut-on utiliser des étoiles de mer séchées pour les faire tremper dans du vin ?
Bien sûr, les étoiles de mer séchées peuvent être...
Quelle maladie me fait mal aux oreilles quand je mords quelque chose ?
@ De nombreux amis ressentent soudainement une gên...
Outre le fait qu’il s’agit d’un simple exercice de remise en forme, quels sont les autres bienfaits de la marche ?
Maintenant que la qualité de vie s’améliore const...
Quelle forme de visage convient à un petit nez retroussé
Le petit nez retroussé est une forme de nez très ...
Comment déboucher les follicules pileux obstrués du cuir chevelu ? Voici les méthodes efficaces pour vous apprendre
Les conséquences des follicules pileux obstrués s...
Quels sont les traitements de la maladie de Parkinson ?
La maladie de Parkinson (MP) est une maladie neur...
Vous souhaitez traiter une rhinite allergique ? Écoutez ce que dit le directeur de l'hôpital de Tongren !
« Science populaire des cotons-tiges » Hôpital To...
Pourquoi y a-t-il une douleur sous les côtes droites lors de la pression ?
La douleur dans les côtes droites est également u...
Quels sont les effets secondaires des tampons
Les tampons sont maintenant progressivement utili...
Quand ajouter du sel pour faire frire du céleri ? Quand ajouter du sel pour faire frire du céleri ?
Nous savons tous que le céleri est un légume cour...