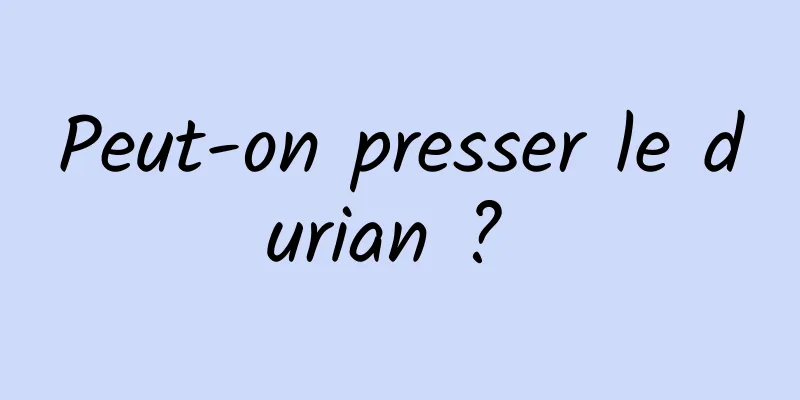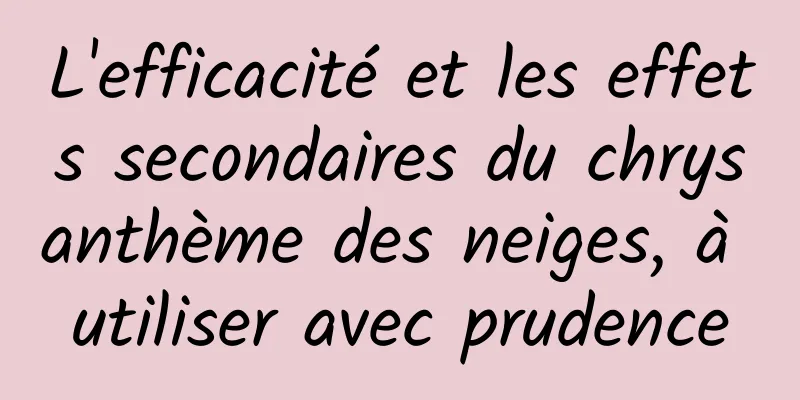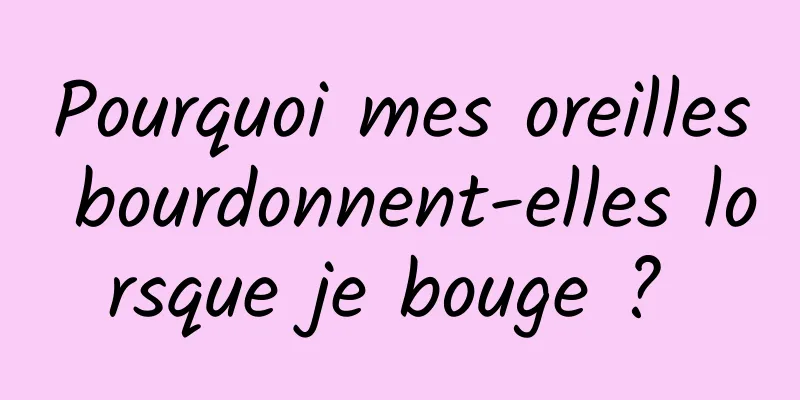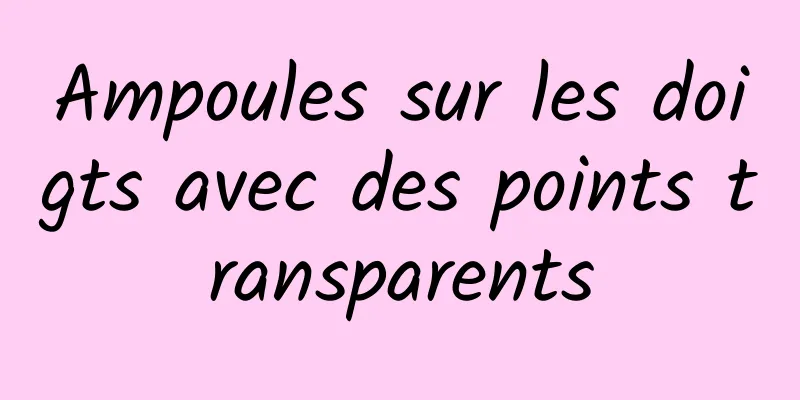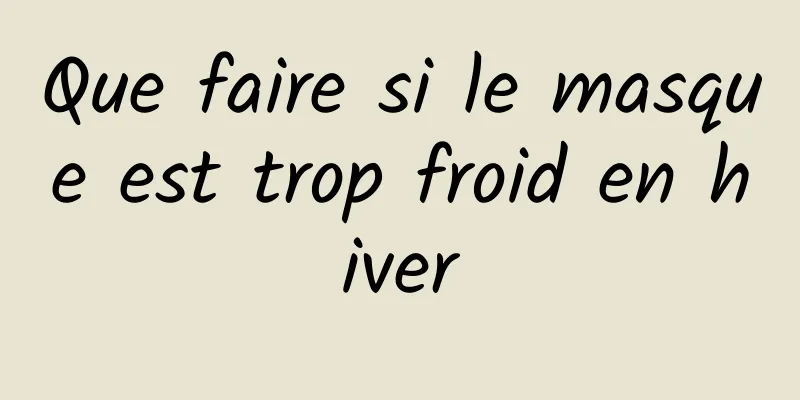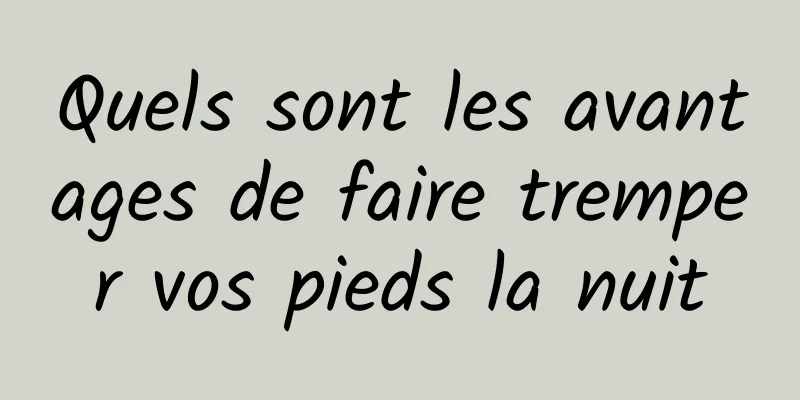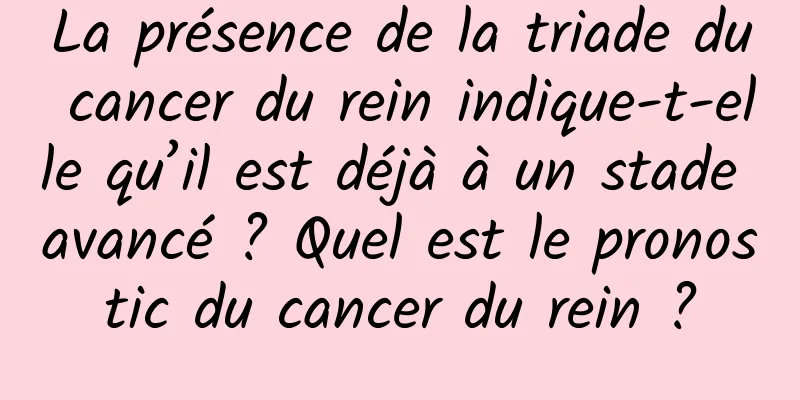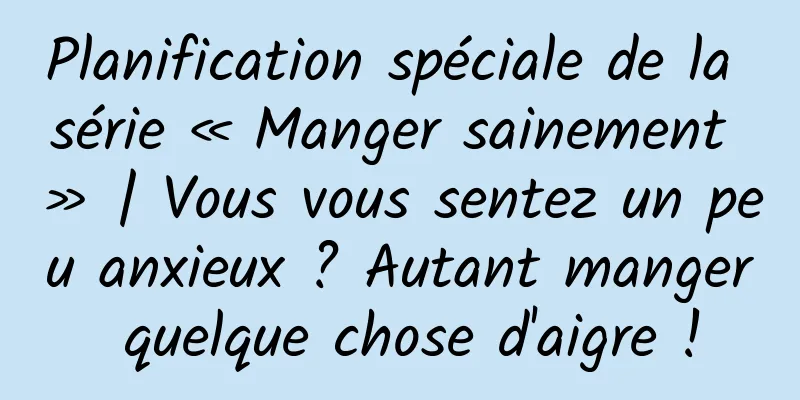Le confort existentiel de l'athéisme
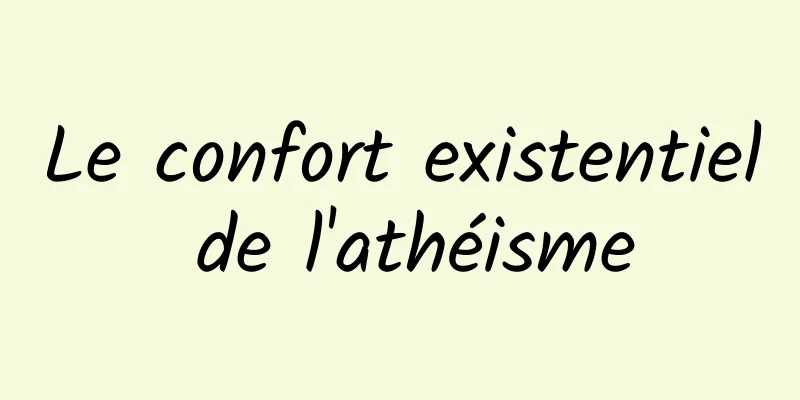
|
Presse Léviathan : Même si je crois actuellement que le corps et la conscience disparaîtront après la mort - en particulier, le corps humain est composé d'environ 99 % d'atomes d'hydrogène, de carbone, d'azote et d'oxygène, ce qui constitue votre relation profonde avec l'univers - dans ce sens, après que le « je » se désintègre et soit dispersé dans l'univers sous forme d'atomes, il semble qu'il y ait encore une sorte d'« existence ». Cependant, le confort apporté par cette existence semble insuffisant. Cela semble n’être qu’une rhétorique compensatoire lorsque nous sommes confrontés à la mort inévitable. C'est exactement comme la phrase de cet article, qui semble contradictoire, mais qui révèle le vrai sens : Ce n'est pas vrai, mais j'y crois. Le mois dernier, Greg Epstein, un athée, a pris ses fonctions de nouvel aumônier en chef de l'Université Harvard. Le New York Times a rapporté qu'Epstein, un pasteur humaniste, a été choisi à l'unanimité pour « coordonner les activités de plus de 40 pasteurs qui dirigent des groupes chrétiens, juifs, bouddhistes et autres groupes religieux sur le campus ». L’article a généré des centaines de commentaires, dont la plupart étaient favorables. Certains se sont demandés si un athée pouvait être un « vrai » prêtre, tandis que d’autres ont déclaré qu’il serait sage de nommer un humaniste qui conserverait un rôle neutre dans l’administration. (www.nytimes.com/2021/08/26/us/harvard-chaplain-greg-epstein.html) Greg Epstein. © Cody O'Loughlin/The New York Times Cependant, malgré leurs différences, les deux réponses partagent l’hypothèse discutable selon laquelle les humanistes ne croient pas en Dieu ou aux dieux, que leurs croyances ne sont pas fondées sur l’autorité religieuse et ne sont pas réellement des croyances. En revanche, les étudiants de Harvard interrogés ont exprimé leur admiration pour la capacité d’Epstein à soutenir une véritable quête de sens sans être entravés par la croyance en Dieu. « C’est une chose remarquable de pouvoir trouver des valeurs et des rituels sans compter sur le pouvoir des dieux », a déclaré AJ Kumar, ancien président du groupe humaniste de l’Université Harvard. Mais est-il vraiment possible de trouver un sens (une valeur et un but) sans dieux (êtres surnaturels et métaphysiques) ? Les critiques ont soutenu que les croyances humanistes manquent de sens et ne constituent pas une source humaniste de valeur et de sens. Ce point de vue est-il correct ? D’une certaine manière, c’est quelque chose que les philosophes et les théologiens doivent prendre en considération. [Epstein lui-même a écrit un livre intitulé Bon sans Dieu]. Mais c’est aussi une question d’esprit humain. En termes psychologiques, les gens peuvent-ils bénéficier des croyances religieuses traditionnelles grâce au naturalisme ? (Nous appelons cela le « chemin humaniste » sans Dieu vers le sens). En d’autres termes, les gens peuvent-ils « croire » en Dieu sans croire en l’existence d’éléments surnaturels et en bénéficier quand même ? (Nous appelons cela le « chemin théodique » sans Dieu vers le sens). Les gens peuvent facilement construire des explications « naturelles » qui offrent un certain niveau de confort existentiel. Un participant a déclaré : « Les étoiles sont nées et la vie a commencé. Quelqu'un a dit : “Nous sommes l'univers et nous vivons notre propre expérience.” C'est un sentiment magnifique et précieux. » © Psychology Today Les recherches en psychologie et en sciences cognitives de la religion nous fournissent des réponses de référence, mais elles ne sont pas totalement cohérentes. Par exemple, il existe des preuves que la croyance en la science peut apporter certains des avantages de la croyance religieuse, mais il existe également des preuves que certaines doctrines scientifiques, comme la théorie de l’évolution, sont largement considérées comme une menace pour les valeurs humaines. Il existe des preuves que les gens utilisent des termes différents pour décrire leurs croyances religieuses et pour décrire leurs autres croyances (par exemple, les gens « croient » en Dieu mais « pensent » que les atomes existent, etc.). Mais il existe également des preuves que les croyances religieuses et scientifiques reflètent les mêmes mécanismes psychologiques. Dans une série d’études à paraître dans le Journal of Experimental Psychology: General, Telli Davoodi et moi proposons une nouvelle façon d’aborder ces questions : la psychologie de la curiosité existentielle. Dans trois études, nous avons demandé aux participants de réfléchir à des questions existentielles qui suscitent généralement une variété de réponses religieuses et non religieuses : comment l’univers est-il né ? Pourquoi y a-t-il de la douleur dans le monde ? Que se passe-t-il après notre mort ? Les réponses à ces questions varient considérablement, certaines apportent du réconfort, d’autres provoquent de l’anxiété ; certains réfléchissent au sens, d’autres désespèrent les gens ; certains fournissent des preuves, d’autres ne sont que des conjectures. Nous nous sommes intéressés aux caractéristiques de ces réponses religieuses ou non religieuses, notamment à la capacité des participants à apporter un réconfort existentiel sans invoquer Dieu ou une divinité. La valeur et le sens, du moins lorsqu’il s’agit de satisfaire l’anxiété existentielle, peuvent être indépendants de la métaphysique surnaturelle et de la divinité. Dans une étude, 494 personnes aux États-Unis se sont inscrites en ligne et ont été invitées à donner leur meilleure réponse à l’une de ces questions existentielles. Il est important de noter que nous avons demandé à certains de nos participants de donner des réponses basées sur la logique et les preuves, tandis que d’autres étaient libres de donner des réponses basées sur leurs propres sentiments. À titre de base de comparaison, nous avons demandé à un troisième groupe de donner des réponses claires et grammaticalement correctes qui exigeaient un équilibre neutre entre les preuves et la paix intérieure. Le premier résultat significatif a été que lorsqu’on leur a demandé de répondre en se basant sur la logique et les preuves, les participants étaient moins susceptibles de donner une explication religieuse : environ 34 % du troisième groupe ont donné une explication religieuse, contre 23 % du premier groupe. En revanche, 53 % du troisième groupe ont donné une explication scientifique, tandis que 71 % du premier groupe l’ont fait. Mais le résultat le plus frappant était que les participants à qui l’on demandait de donner une explication existentielle basée sur leur confort et leur paix intérieure étaient plus susceptibles de donner une explication explicitement religieuse ou théologique, avec 34 % du troisième groupe le faisant contre plus de 56 % du deuxième groupe. Cependant, si les participants n’avaient pas de croyances religieuses explicites, ils étaient également capables de construire facilement des explications « naturelles » (par opposition à « surnaturelles ») qui leur procuraient également du réconfort. En fait, la proportion d’explications naturelles qui apportent un réconfort existentiel est d’environ 36 %, et la proportion d’explications surnaturelles est d’environ 42 %, ce qui n’est pas très différent. Alors, quelles sont ces explications ? Lorsqu'on demande ce qui se passe après notre mort, une explication religieuse est que nous serons réunis avec nos proches : « nos âmes iront là où nos proches nous accueilleront, et nous aurons alors de belles retrouvailles. » Et l'explication naturelle est que nous deviendrons des souvenirs, ou que nous serons transformés en une autre forme - « nous resterons toujours dans le cœur de ceux qui nous ont aimés et de ceux que nous avons quittés ». « Les molécules de notre corps… s’organiseront en de nouvelles formes. » Lorsqu’on les interroge sur les origines de l’univers, les explications religieuses peuvent faire appel à notre objectif dans le dessein de Dieu : « soyez assurés, vous avez une place dans l’univers de Dieu, et tout se déroulera comme prévu ». Une explication naturelle pourrait se lamenter sur notre place dans l'univers : « Nous faisons partie du fluide qui existait avant le Big Bang, et nous avons la chance d'observer la phase la plus intéressante de l'univers. Les étoiles sont nées et la vie a commencé. Quelqu'un a dit un jour : « Nous sommes l'univers, et nous faisons l'expérience de nous-mêmes. » Ce sentiment est beau et mérite d'être chéri. Ainsi, si les appels aux croyances religieuses traditionnelles peuvent apporter un réconfort existentiel, pour de nombreux participants, la foi dans la nature ou l’humanisme peut faire le même effet. C’est là l’avantage d’un chemin humaniste vers le sens sans Dieu. La valeur et le sens, du moins lorsqu’il s’agit de satisfaire l’anxiété existentielle, peuvent être indépendants de la métaphysique surnaturelle et de la divinité. Mais il y a un problème. Ce n’est pas parce que les gens peuvent trouver des sources naturelles de réconfort existentiel qu’elles fonctionnent de la même manière que les sources religieuses et surnaturelles. Nous avons également demandé aux participants d’évaluer dans quelle mesure leurs explications étaient capables de générer des émotions positives et d’éliminer les émotions négatives. Les résultats montrent que les explications naturelles sont bien moins efficaces que les explications surnaturelles à cet égard. Vivre dans les souvenirs des autres n’est pas aussi bon que la vie éternelle, du moins en termes de confort émotionnel. Bien sûr, le confort émotionnel n’est qu’un aspect d’un système de croyances précieux et significatif. Pour examiner comment les interprétations religieuses et non religieuses de l’existentialisme différaient plus largement, les participants qui ont donné des réponses différentes ont également pris part à une étude distincte dans laquelle on leur a demandé d’évaluer les interprétations qu’ils ont reçues sur d’autres dimensions. Il ne s’agit donc pas seulement du point de vue du confort émotionnel, mais aussi du point de vue de la valeur sociale (cette explication favorise-t-elle les relations interpersonnelles ?), de la valeur morale (rend-elle le monde plus moral ?) et de l’importance de l’identité (est-ce que cela vous donne le sentiment d’être tel que vous êtes ?). Est-il vraiment possible de trouver un sens à sa vie sans Dieu ? Par exemple, dans une étude portant sur 501 participants, chaque participant a reçu une explication scientifique ou religieuse pour l’une des trois questions existentielles énumérées ci-dessus. D’une manière générale, les explications scientifiques semblent davantage fondées sur la logique et les preuves, et plus objectives. En revanche, les explications religieuses ont mieux réussi à favoriser le confort émotionnel, le soutien social, la moralité et la connaissance de soi. Une fois de plus, les résultats suggèrent que lorsqu’il s’agit de telles sources de sens (non épistémologiques), les explications religieuses semblent avoir le dessus. © Financial Times Une étude finale portant sur 652 personnes a réaffirmé ces résultats, mais est allée plus loin en mesurant dans quelle mesure les participants croyaient que chaque explication scientifique ou religieuse était vraie. Cela nous amène à nous demander : pour qu’une explication soit considérée comme réconfortante et moralement valable, doit-elle être jugée vraie ? Un philosophe italien aurait dit à propos d’une superstition locale : « Ce n’est pas vrai, mais j’y crois. » Cette affirmation est frappante parce qu’elle semble paradoxale (croire en quelque chose n’est-ce pas la même chose que croire en sa vérité ?), mais elle résonne aussi parce que nous en comprenons tous le sens dans une certaine mesure. Cette déclaration illustre également la possibilité d’une voie théodiste vers le sens sans Dieu : les explications religieuses peuvent-elles fournir un sens (la valeur de la foi) sans exiger la croyance en sa vérité ? Nos données fournissent une réponse, mais elle est un peu subtile. Pour les explications religieuses et scientifiques, la valeur perçue d’une explication existentielle est étroitement liée à la croyance en la vérité de cette explication. Les participants qui voyaient la valeur émotionnelle, morale et personnelle des explications religieuses étaient également enclins à croire que ces explications étaient vraies. Pour que les explications religieuses puissent voir la bonté, il faut Dieu (ou des dieux, une vie après la mort ou une autre forme de métaphysique surnaturelle). Tant qu’il n’y a pas de mensonge dans la foi, cela suffit peut-être. Il existe cependant une énorme différence entre les domaines de la science et de la religion. Même parmi les explications qui correspondaient à la réalité perçue, les explications religieuses étaient mieux notées en termes de sources de signification non épistémologiques. Plus précisément, les participants ont trouvé les explications religieuses bénéfiques sur le plan émotionnel, moral et personnel, à condition qu’ils croient en leur vérité dans une certaine mesure. En revanche, les explications scientifiques doivent être fortement identifiées pour être considérées comme ayant ces effets. Alors, qu’est-ce que cela nous apprend sur la recherche de sens sans Dieu ? Au début de l’article, j’ai proposé deux voies vers le sens sans Dieu : l’une est la voie humaniste, qui trouve le sens de la foi sans croire au surnaturel. L’une d’elles est la voie théologique, dans laquelle le sens vient du fait de « croire » à la valeur des affirmations surnaturelles plutôt que de « croire » à leur vérité. Nous avons quelques preuves en faveur de la voie humaniste : d’un côté, les gens peuvent satisfaire leur curiosité existentielle par des méthodes naturelles et obtenir ainsi de nombreuses choses associées à la foi religieuse : la paix intérieure, le confort émotionnel et d’autres formes de sens et de valeur. D’un autre côté, les gens doivent faire davantage de travail psychologique pour atteindre cet objectif – les croyances humanistes n’ont pas nécessairement le même impact psychologique que les croyances chrétiennes plus familières dans l’exemple ci-dessus. Nous disposons de toutes sortes de preuves en faveur de la voie théologique : l’attribution d’une valeur aux affirmations religieuses tend à être associée à la croyance en leur vérité, et donc à la foi en Dieu, aux dieux ou à d’autres éléments surnaturels. Mais les gens peuvent percevoir les avantages de la croyance religieuse avec un niveau de reconnaissance modéré. Le point de vue du philosophe italien est que la croyance sans croyance en la réalité peut être psychologiquement possible, au moins conditionnellement : peut-être suffit-il que la croyance ne soit pas fausse. Bien sûr, la recherche de sens comprend bien plus que nos simples réponses psychologiques aux interprétations existentielles. De plus, cet article s’adresse principalement aux chrétiens et aux Américains. Quant aux interprétations et aux croyants des autres religions, ils peuvent ne pas être les mêmes que ce qui est observé dans cet article. Toutes les petites études prétendant avoir fait des découvertes sur le sens ou la religion doivent se méfier de cela et ne doivent pas généraliser. En même temps, je crois que ces résultats aident à comprendre le soutien et l’opposition du public à l’idée qu’un athée devienne une autorité religieuse. Les croyances humanistes peuvent donner un sens existentiel, mais cela demande un certain effort. Références 1. Goldberg, E. Le nouvel aumônier en chef à Harvard ? Un athée. Le New York Times (2021). 2. Lombrozo, T. La science peut-elle offrir les avantages de la religion ? Revue de Boston (2013). 3. Brem, SK, Ranney, M., & Schindel, J. Conséquences perçues de l'évolution : les étudiants perçoivent un impact personnel et social négatif dans la théorie de l'évolution. Éducation scientifique 87, 181-206 (2003). 4. Heiphetz, L., Landers, CL, & Van Leeuwen, N. Penser signifie-t-il la même chose que croire ? Aperçus linguistiques sur la cognition religieuse. Psychologie de la religion et de la spiritualité 13, 287-297 (2021).5. Croire, ce n'est pas penser : une découverte interculturelle. Open Mind (à paraître).6. Shtulman, A. Similitudes épistémiques entre les croyances scientifiques et surnaturelles des étudiants. Journal de psychologie de l'éducation 105, 199-212 (2013). Par Tania Lombrozo Traduit par Rachel Relecture/boomchacha Article original/nautil.us/issue/106/intelligent-life/existential-comfort-without-god Cet article est basé sur la licence Creative Commons (BY-NC) et est publié par Rachel sur Leviathan L'article ne reflète que les opinions de l'auteur et ne représente pas nécessairement la position de Leviathan |
Recommander des articles
L'attrait et les critiques de « Basquash ! » : Un nouveau type d'anime né de la fusion du basket-ball et des robots
Basquash ! - Les origines de la légende et son at...
Comment utiliser une pompe à perfusion IV ?
Avec le développement rapide de la science modern...
Quelle est la relation entre l'héroïne d'Itaewon Class et Jang Dae-hee ? La raison pour laquelle l'héroïne d'Itaewon Class est entrée dans la famille de Jang dans l'épisode 8
"Itaewon Class" a été mis à jour pour l...
Procédure pour retirer le nom d'une personne d'un certificat de propriété Que dois-je faire si le prix de la maison que je viens d'acheter baisse ?
Les prix des nouvelles propriétés seront différen...
Akatonbo : Réévaluer l'émotion de Minna no Uta
« Akatonbo » - Retour sur les célèbres chansons d...
Quel type de prothèses dentaires dois-je installer ?
De nombreuses personnes n'ont pas pris soin d...
La saignée et les ventouses sont-elles nocives pour le corps ?
La saignée et la ventouse sont également une form...
Quelle est la raison de la présence de mites dans la maison
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles d...
Jack Ma : Utiliser une mentalité de débutant pour construire un réseau dorsal intelligent avec un accès 24 heures sur 24
Le projet CSN, qui a fait l'objet de vives di...
Y aura-t-il des cicatrices après une opération d'orgelet ?
L'orgelet peut laisser des cicatrices après l...
Que peut guérir le gombo ?
Le gombo est originaire d'Afrique et est égal...
Au début de l’année scolaire, les parents comprennent-ils la santé mentale de leurs enfants ?
La rentrée scolaire est une période importante d’...
Pourquoi les élèves du primaire devraient-ils promouvoir la culture traditionnelle chinoise ? Pourquoi les élèves du primaire devraient-ils apprendre les sciences ?
Les élèves du primaire désignent les élèves qui é...
Et le marathon de Boston ? Avis sur le marathon de Boston et informations sur le site Web
Qu'est-ce que le site Web du marathon de Bosto...
Mes ovaires vont-ils grossir pendant la grossesse ?
Une fois qu'une femme tombe enceinte, son cor...