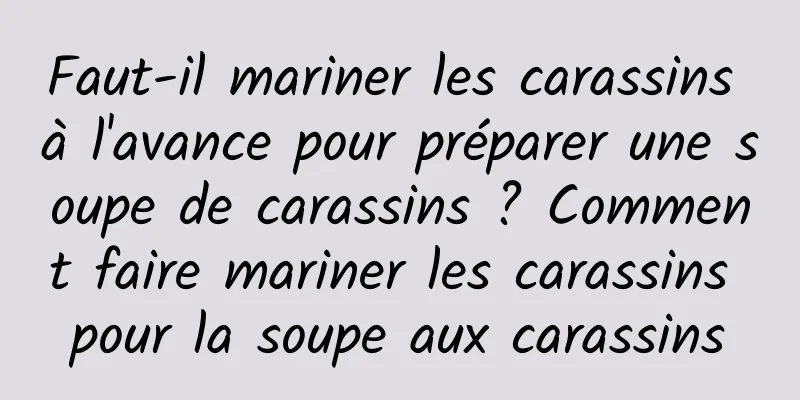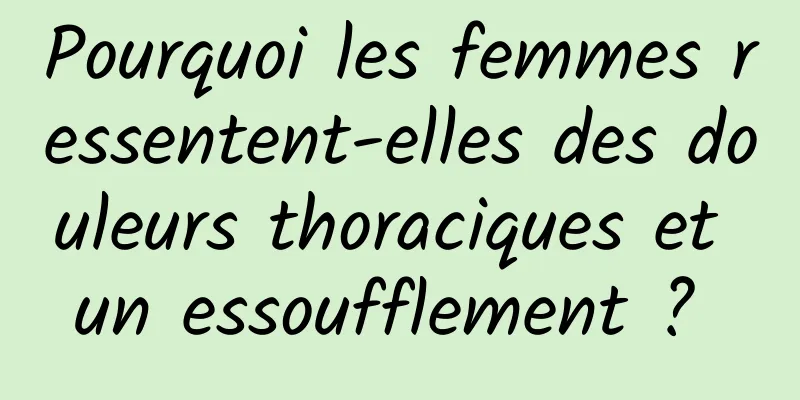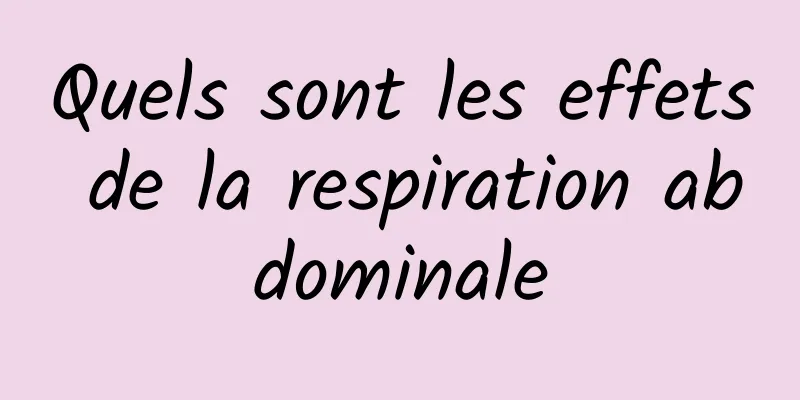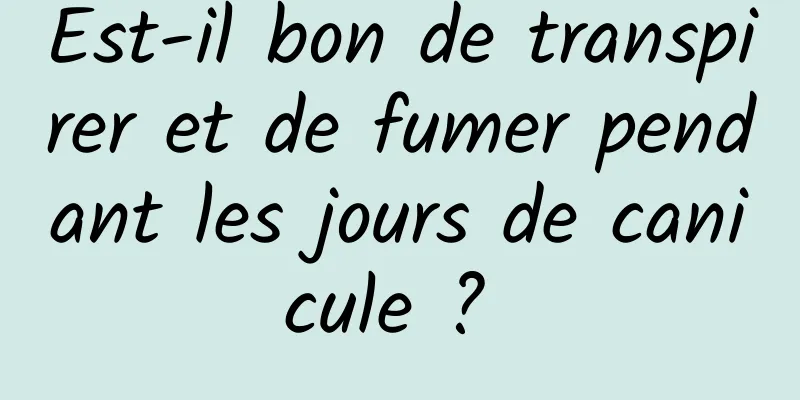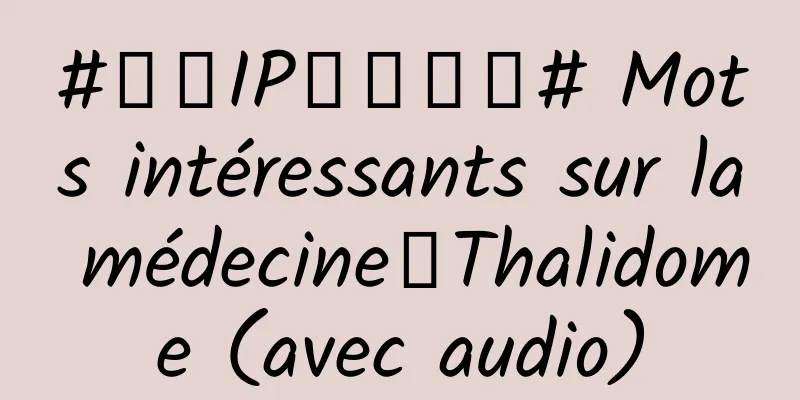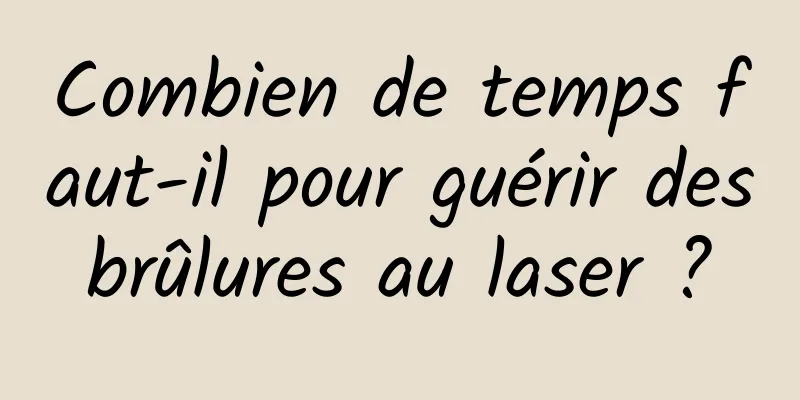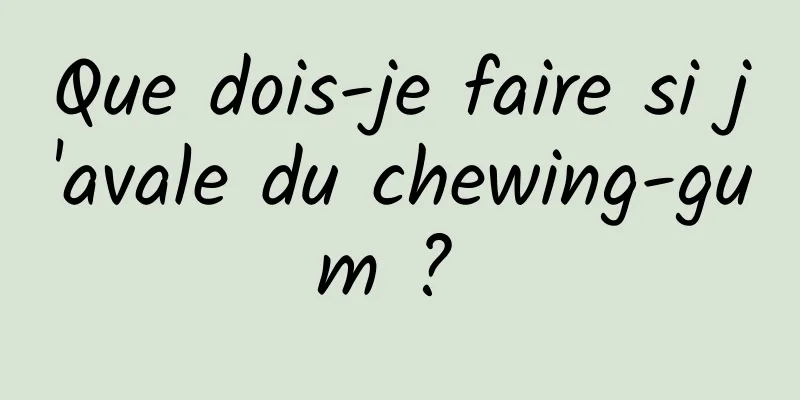À quoi pensent les gens face à la peur et à la pauvreté ?
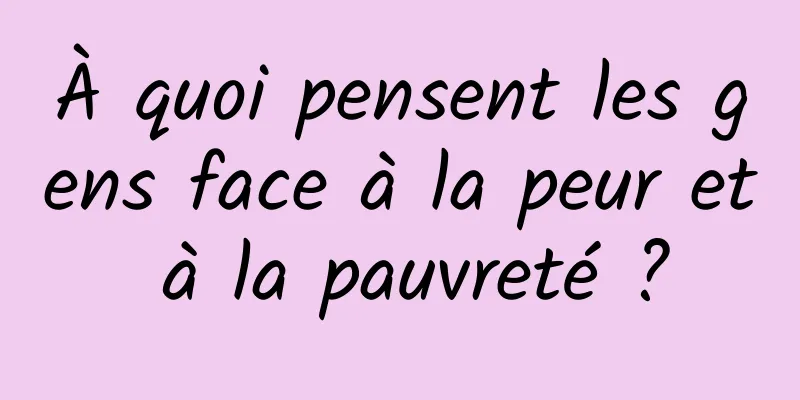
|
Auteurs : Tao Rui, Liu Huan, Wei Zihan, Li Minghui (Institut de psychologie, Académie chinoise des sciences) L'article provient du compte officiel de l'Académie des sciences (ID : kexuedayuan) Note de l'auteur Nous pensons généralement que les sentiments subjectifs des gens sont linéairement liés aux changements de l’environnement objectif. Être à l’abri de la peur et être à l’abri du besoin sont deux libertés fondamentales liées à des changements de circonstances objectives. Cependant, les deux effets contre-intuitifs examinés dans cet article suggèrent qu’il existe des mécanismes psychologiques complexes derrière la façon dont les gens font face aux changements environnementaux et poursuivent ces deux libertés : la correspondance entre l’environnement objectif et les sentiments subjectifs peut être non linéaire. Le premier effet contre-intuitif est l’effet « œil psychologique du typhon », c’est-à-dire que plus vous êtes proche d’un risque élevé, plus vous devenez psychologiquement calme. Le deuxième effet contre-intuitif est l’effet de « dislocation urbaine », c’est-à-dire que, bien que le niveau de vie objectif des résidents urbains se situe entre celui des zones urbaines et celui des zones rurales, leur niveau subjectif d’attachement résidentiel n’est pas compris entre celui des zones urbaines et celui des zones rurales (inférieur à celui-ci). La liberté de vivre à l’abri de la peur et la liberté de vivre à l’abri du besoin sont deux des « libertés humaines fondamentales » proposées par Franklin Roosevelt (1941) (Figure 1). La Déclaration du Millénaire des Nations Unies (2009) a également clairement indiqué que l’objectif de développement de la communauté internationale est d’aider l’humanité à se libérer de la peur et de la pauvreté. Alors pourquoi ces deux libertés sont-elles incluses parmi les « quatre libertés fondamentales » ? Qu’est-ce qui nous pousse si désespérément à lutter pour être libérés de la peur et du besoin ? Figure 1 L'image de gauche montre un relief des Quatre Libertés, situé au Mémorial Franklin Delano Roosevelt à Washington, DC ; la photo de droite montre Franklin Delano Roosevelt, le 32e président des États-Unis. Image de Wikipédia : https://en.wikipedia.org/wiki/Four_Freedoms Changements environnementaux → changements psychologiques Si vous y réfléchissez bien, son origine est étroitement liée à l’évolution de l’environnement. L’environnement objectif dans lequel nous vivons est en constante évolution, soit en s’aggravant, soit en s’améliorant. D’un côté, les catastrophes naturelles (telles que les tremblements de terre, les typhons, les inondations et les tsunamis) détruisent notre environnement objectif, c’est-à-dire que le ciel envoie la peur aux êtres humains, alors nous cherchons à nous libérer de la peur ; D’autre part, pour éviter la pauvreté, les humains transforment artificiellement la nature pour améliorer l’environnement objectif. Le processus d’industrialisation et d’urbanisation a toujours été un moyen pour l’humanité d’échapper à la pauvreté et d’avancer vers la prospérité (figure 2). Face aux changements environnementaux, les gens doivent mobiliser les ressources de leur corps et faire des jugements et des réponses adaptatives afin de survivre. C’est ce qu’on appelle « l’esprit naît de l’environnement » et « l’esprit change avec l’environnement ». Plus précisément, dans le contexte des « catastrophes naturelles » et de la « transformation de la nature », cela signifie : être libéré de la peur et de la pauvreté. Figure 2 Différents changements environnementaux auxquels les humains peuvent être confrontés : les tsunamis et les tremblements de terre sont associés à la libération de la peur ; L’urbanisation et l’industrialisation sont associées à la libération de la pauvreté. Toutes les images proviennent de Baidu. Face aux défis et aux changements environnementaux, les humains ont développé de nombreux mécanismes d’adaptation et de réaction en conséquence. Lorsque nous sommes dans une situation dangereuse, nous ressentons de la peur ; Quand nous sommes dans une belle situation, nous ressentons de la joie. Le bon sens veut que les sentiments subjectifs devraient changer linéairement avec les changements de l’environnement objectif, c’est-à-dire : plus l’environnement est dangereux (objectif), plus les gens devraient avoir peur (subjectif) ; Plus l'environnement est bon (objectif), plus les gens devraient être heureux (subjectif). Cependant, après avoir collecté des données auprès de dizaines de milliers de sujets sur plusieurs années, l'équipe de recherche de Li Shu à l'Institut de psychologie de l'Académie chinoise des sciences a découvert deux effets contre-intuitifs, révélant que la relation changeante entre les sentiments subjectifs et l'environnement objectif n'est pas nécessairement linéaire. Effet contre-intuitif 1 : « L’œil psychologique du typhon » La peur est une réponse humaine naturelle à divers dangers environnementaux (Soyk, 2011). La communauté universitaire utilise souvent le terme « effet d’entraînement » (Slovic, 1987) pour décrire nos réactions psychologiques face à de graves catastrophes naturelles telles que des tremblements de terre, des typhons et des inondations. Tout comme des ondulations qui se propagent vers l’extérieur, l’impact des rencontres malheureuses s’affaiblira progressivement avec le temps et la distance. Cependant, dans la vie réelle, la relation entre le danger objectif et la peur subjective n’est pas la même. En mai 2008, un tremblement de terre de magnitude 8,0 a frappé Wenchuan. Li Shu et d’autres ont mené une enquête à grande échelle auprès des résidents des zones non sinistrées (542 personnes à Pékin, au Fujian et au Hunan) et des zones sinistrées (1 720 personnes au Sichuan et au Gansu). L’enquête a révélé de manière surprenante que plus les habitants étaient proches de l’épicentre, plus ils étaient calmes. Autrement dit, à mesure que la gravité de la catastrophe dans leur zone augmentait (de non affectée, légèrement affectée, modérément affectée à gravement affectée), les résidents ont estimé que la demande de médecins et de psychologues dans la zone sinistrée, la possibilité d’une maladie infectieuse à grande échelle dans la zone sinistrée et le nombre de mesures d’évitement des tremblements de terre qui devaient être prises ont tous diminué (Figure 3 ; Li et al., 2009). Figure 3 Relation entre le degré de préoccupation concernant les questions de sécurité et de santé après le tremblement de terre et le niveau de dommages causés à la résidence Le chercheur Li Shu a nommé cet effet « l’effet œil de typhon psychologique » (figure 4), c’est-à-dire que, dans la dimension temporelle, plus la période à haut risque est proche, plus l’esprit est calme ; dans la dimension spatiale, plus on est proche de la zone à haut risque, plus l'esprit est calme. Figure 4 Œil de typhon : Étant donné que la ville natale du chercheur Li Shu, Fujian, est sujette aux typhons, il a intentionnellement nommé cet effet « l’œil de typhon psychologique ». L'image provient de Baidu. (Note de l'éditeur : La zone circulaire d'un diamètre d'environ 10 kilomètres à partir du centre du typhon est généralement appelée « l'œil du typhon » en météorologie. L'air qui s'y trouve tourne à peine et le vent est relativement faible.) Deux variantes Variante 1 : La version relationnelle de l’effet « œil psychologique du typhon » : Quatre et onze mois après le tremblement de terre de Wenchuan, Li Shu et ses collègues ont mené deux études de suivi sur 4 178 résidents de la zone sinistrée (Sichuan et Gansu) et 1 038 résidents des zones non sinistrées (Pékin et Fujian). Ces deux études de suivi ont révélé que l’effet « œil de typhon psychologique » était toujours fort un an après le tremblement de terre de Wenchuan. Dans le même temps, ils ont également découvert une variante de l'effet « œil psychologique du typhon » - la version relationnelle de l'effet « œil psychologique du typhon », c'est-à-dire que plus la parenté avec les victimes qui ont subi des pertes matérielles est étroite, ou plus la parenté avec les victimes qui ont subi des blessures corporelles est étroite, moins les résidents sont préoccupés par leur santé et leur sécurité. Variation 2 : L'effet « Œil psychologique du typhon » de l'implication : Zheng Rui et al. (2015) ont mené une enquête auprès des ménages auprès des résidents vivant dans une zone minière de plomb et de zinc dans le comté de Fenghuang, Xiangxi (217 villageois de la zone minière). Cette étude a examiné la relation entre l’implication et la perception du risque minier par les villageois. Parmi eux, l'implication minière est divisée en quatre catégories selon les différents degrés de participation des villageois locaux à l'exploitation minière, du plus élevé au plus faible : les propriétaires de mines (villageois dont les propres terres peuvent produire du minerai), les mineurs (villageois travaillant dans de petites mines), les familles de propriétaires de mines et de mineurs, et les villageois qui ne participent pas à l'exploitation minière. Il va de soi que plus les personnes sont impliquées dans des événements à risque, plus leur niveau de conscience des risques doit être élevé. Cependant, les résultats de l'enquête montrent que, des propriétaires de mines aux villageois qui ne sont pas impliqués dans l'exploitation minière, le niveau de conscience du risque augmente progressivement, montrant un effet évident de « l'œil psychologique du typhon ». Les chercheurs appellent cela la version d’implication de l’effet « œil psychologique du typhon », c’est-à-dire que plus le degré d’implication dans les événements à risque est élevé, plus le niveau de conscience du risque est faible (figure 5). Figure 5 Niveau moyen de sensibilisation aux risques des villageois du comté de Fenghuang (les scores les plus élevés représentent des niveaux de sensibilisation aux risques plus élevés) Impact social L’effet « œil psychologique du typhon » montre que la peur subjective n’augmente pas de façon monotone avec l’augmentation du danger objectif. La découverte de l'effet « œil de typhon psychologique » a également attiré l'attention de personnes de tous horizons : Noah Gray (2010), rédacteur en chef de Nature, estime que ce résultat « est très important pour les décideurs politiques, car il les aide à mieux formuler des politiques pour répondre aux risques de santé publique. Car il nous aide à mieux comprendre qui souffre de la catastrophe. » Le Washington Post a réalisé un rapport approfondi sur la recherche concernant l’effet de « l’œil psychologique du typhon » sur les risques de pollution environnementale intitulé « Le grand paradoxe de la perception humaine des risques environnementaux ». Le rapport estime que la découverte de l’effet « œil psychologique du typhon » démontre pleinement que la simple présentation de données et de résultats statistiques au public ne peut pas modifier sa cognition psychologique, et que les décideurs politiques devraient communiquer et interagir davantage avec le public lorsqu’ils résolvent des problèmes environnementaux (Harvey, 2015). Effet contre-intuitif 2 : « Dislocation urbaine » Depuis la réforme et l’ouverture, la Chine a connu une croissance économique considérable et une urbanisation rapide. À la fin de 2014, le taux d’urbanisation de la Chine avait atteint 54,77 %, dépassant la moyenne mondiale de 53 % (Bureau national des statistiques, 2013). Nous semblons avoir des raisons de penser que la croissance économique rapide et l’urbanisation rapide amélioreront considérablement le sentiment subjectif de bien-être des résidents. Toutefois, les chercheurs ont constaté que dans certains pays développés, notamment les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Italie et les Pays-Bas, les niveaux moyens de bien-être subjectif sont restés pratiquement inchangés alors que le revenu national par habitant a continué d’augmenter au cours de la dernière décennie (par exemple, Blanchflower et Oswald, 2004 ; Easterlin et Sawangfa, 2010). Ces résultats impliquent que les perceptions subjectives ne varient pas linéairement avec les niveaux d’urbanisation. Cette relation non linéaire existe-t-elle également dans les pays en développement comme la Chine ? Wang et al. (2015) ont mené une enquête auprès des ménages d’août à septembre 2007 sur des résidents (un total de 3 716 personnes) dans trois types de régions (rurales, urbaines et urbaines) à différents stades d’urbanisation à travers le pays. Les chercheurs ont examiné les opinions subjectives des gens sur leur lieu de résidence au moyen de mesures directes et indirectes. L'indicateur subjectif directement mesuré est l'environnement social auto-évalué, c'est-à-dire si les résidents estiment que leur lieu de résidence dispose d'un environnement social harmonieux et beau. L'indicateur subjectif indirect (attachement au lieu) a été mesuré par un test projectif (Li, 2016), qui ne demande pas directement aux résidents leurs attitudes envers leur lieu de résidence, mais leur demande de faire des choix sur des questions qui sont d'une grande importance pour eux, notamment en leur demandant s'ils sont prêts à choisir un local comme partenaire de vie, s'ils sont prêts à renaître dans la région locale dans la prochaine vie, s'ils veulent que leurs enfants maîtrisent le dialecte local et s'ils ont des réactions émotionnelles aux étrangers qui insultent les locaux (Wang et al., 2015). Les personnes ayant un fort attachement résidentiel sont plus disposées à choisir des locaux comme partenaires, à être des locaux dans la prochaine vie, à faire maîtriser le dialecte local à leurs enfants et à montrer de fortes réactions émotionnelles aux propos insultants des étrangers à l’égard des locaux. Selon des indicateurs objectifs (tels que le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans, le taux d’analphabétisme des adultes et le revenu mensuel moyen des ménages, etc.), la qualité de vie des habitants montre une tendance à la hausse des zones rurales vers les zones urbaines à mesure que le niveau d’urbanisation augmente. Logiquement parlant, le niveau d’attachement résidentiel des résidents devrait également montrer une tendance similaire, c’est-à-dire que le niveau d’attachement résidentiel des résidents urbains devrait se situer entre celui des résidents ruraux et urbains. Cependant, les résultats montrent que les niveaux d’attachement résidentiel des résidents urbains et les scores d’auto-évaluation de l’environnement social sont inférieurs à ceux des résidents ruraux et urbains (Figure 6 ; Wang et al., 2015). Figure 6 « Attachement à la résidence » moyen des résidents ruraux, urbains et urbains (plus le score est élevé, plus ils sont attachés à la région) Étant donné cette nature « illogique », Wang et al. (2015) ont appelé cette relation en forme de V « l’effet de dislocation de la ville ». L’effet de « dislocation urbaine » décrit les changements asynchrones dans la perception subjective et l’environnement objectif au cours du processus d’urbanisation. Bien que l’effet de « dislocation urbaine » soit inattendu, il reste raisonnable. Une histoire similaire est racontée dans les fables d'Ésope : la souris des champs enviait la souris des villes pour ses délicieux gâteaux et sa bière, alors elle s'installa en ville. Cependant, après avoir expérimenté de première main l'énorme différence entre la ville et la campagne, la souris de la campagne a pensé qu'au lieu de vivre en ville avec tension et anxiété et de profiter d'une nourriture délicieuse, il serait préférable de retourner à la campagne et de vivre une vie paisible. Tout comme les souris rurales, les gens semblent montrer un « complexe pastoral » similaire lorsqu’ils sont confrontés aux villes (Wang et al., 2015). Les deux effets contre-intuitifs mentionnés ci-dessus suggèrent que la relation entre les sentiments subjectifs et les changements dans l’environnement objectif peut ne pas être linéaire ; Il existe des mécanismes psychologiques complexes derrière la réponse des gens aux changements environnementaux et leur lutte pour se libérer de la peur et de la pauvreté. Plus les humains considèrent la « liberté de la peur et du besoin » comme une liberté fondamentale, plus les psychologues ont la responsabilité de distinguer le mécanisme de défense psychologique de la « liberté de la peur » et le mécanisme d’ajustement psychologique de la « liberté du besoin ». Comme ces mécanismes sont encore inconnus, l’humanité continuera à rechercher la liberté. Références : [1]Li, S., Rao, LL., Bai, [2]Li, S., Rao, LL., Bai, [3]Wang, F., Li, S., Bai, XW., Ren, XP., Rao, LL., Li, JZ., ... [4]Wei, ZH, Tao, R., Liu, H. et Li, S. (2017). « Libéré de la peur et du besoin » et notre réponse psychologique aux changements environnementaux. Journal de psychologie du Pacifique, 11. |
<<: En colère et déprimé ! Qui est le coupable derrière tout ça ?
Recommander des articles
Que puis-je manger après l’accouchement pour faire grossir mes seins ?
Pour les femmes, c'est une chose tellement he...
Comment rendre les lèvres plus fines
La seule façon de résoudre le problème des lèvres...
Quel est l'effet des points d'acupuncture sur la spondylose cervicale ?
La spondylose cervicale est une maladie courante ...
Est-il bon de manger de l'avocat en faisant de l'exercice ?
Les amis qui aiment le fitness choisiront des ali...
Comment éplucher le durian
Les personnes qui aiment manger du durian savent ...
À quoi ressemble la Bibliothèque nationale et universitaire d’Islande ? Avis et informations sur le site Web de la Bibliothèque nationale et universitaire d'Islande
Quel est le site Web de la Bibliothèque nationale ...
Les préservatifs peuvent-ils retarder l'éjaculation ?
Les préservatifs sont une mesure contraceptive tr...
Le strabisme est-il facile à guérir ?
Le strabisme peut être corrigé et traité par cert...
Call of the Wilderness: Roar Back - Une critique approfondie d'une histoire touchante d'aventure et d'amitié
L'attrait et l'évaluation de « Call of th...
À quoi doivent faire attention les patients atteints du virus de l’hépatite B (HBsAg) ?
En plus de suivre les instructions du médecin, le...
Et que pensez-vous du Pisa Football Club ? Avis et informations sur le site Web du Pisa Football Club
Quel est le site Web du Pisa Football Club ? L'...
Quelle est la véritable identité du protagoniste masculin de Penglaijian ? Quelle est la fin du protagoniste masculin dans Penglaijian ?
Le drame fantastique « Penglaijian » avec Ji Xiao...
Puis-je prendre un bain avec les haricots d'eau ?
La varicelle est une maladie de peau relativement...
Connaissez-vous les avantages et les inconvénients des somnifères, qui ne peuvent pas être utilisés comme « partenaire de sommeil » ?
« Rester éveillé tard et dormir le moins possible...
Comment résoudre le problème de l'acné causé par les troubles endocriniens masculins ?
Il est très fréquent que les hommes souffrent de ...