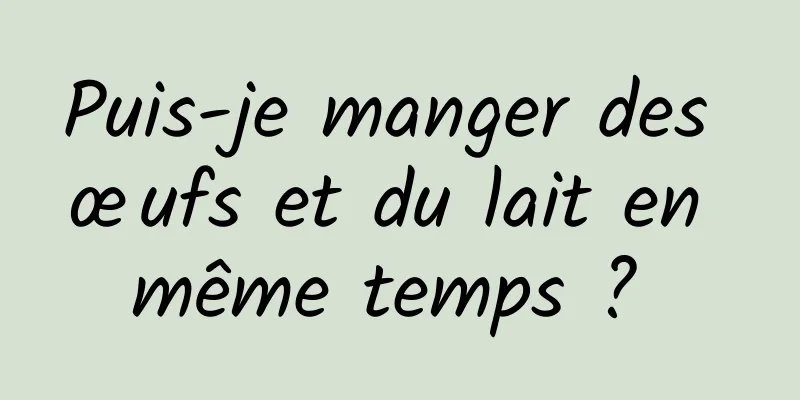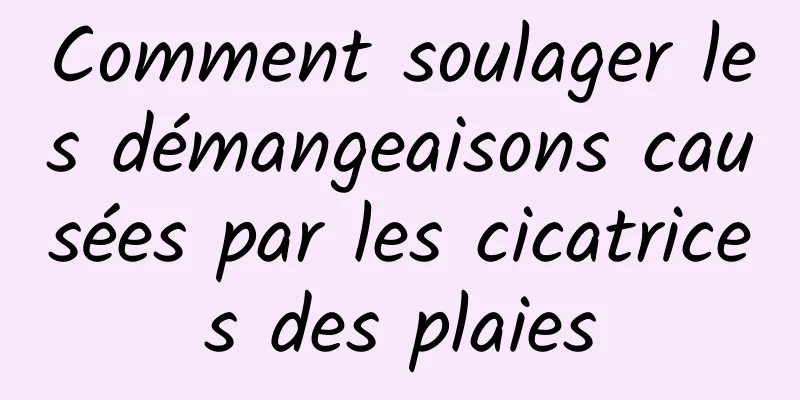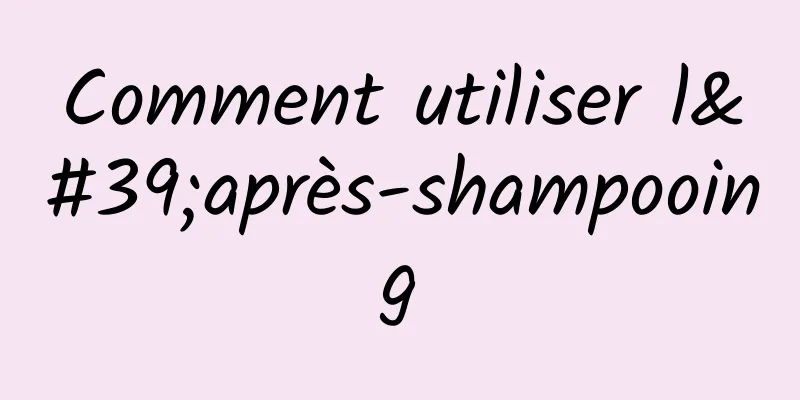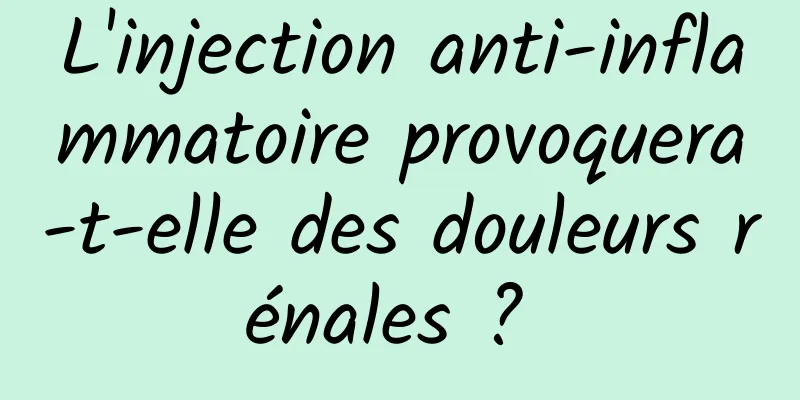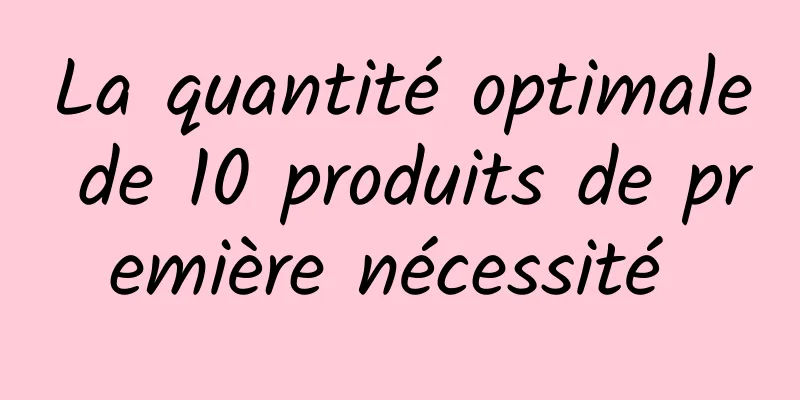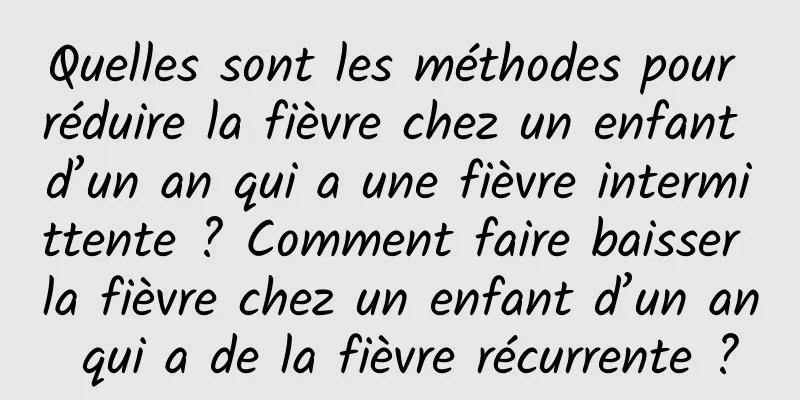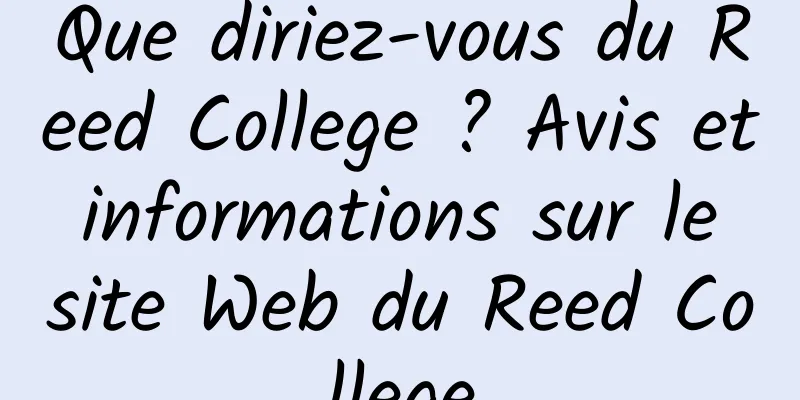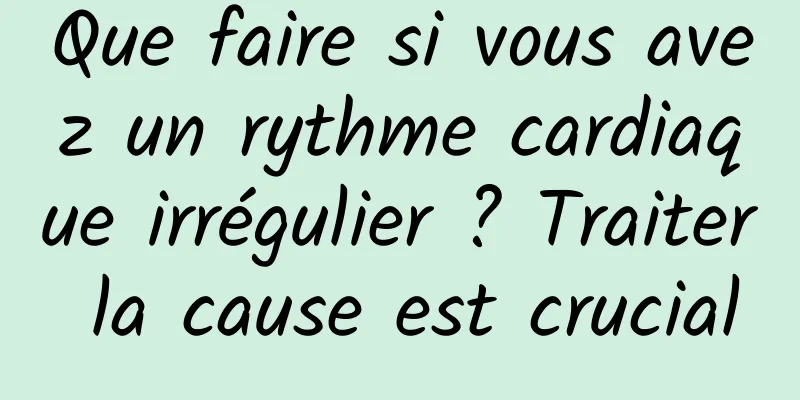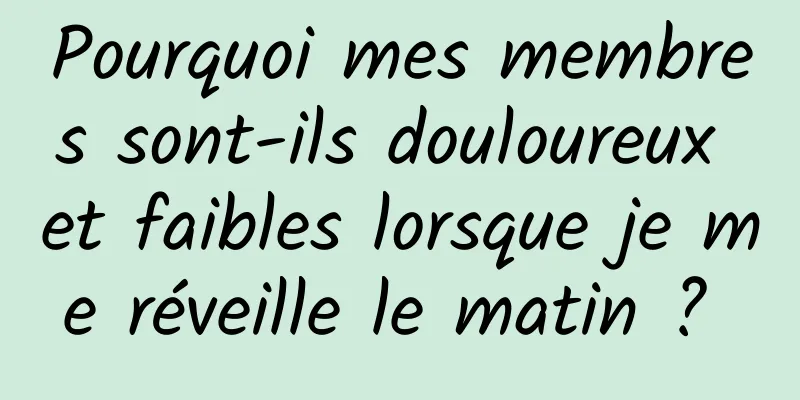Hommes et poulets : devrions-nous être des nihilistes moraux ?
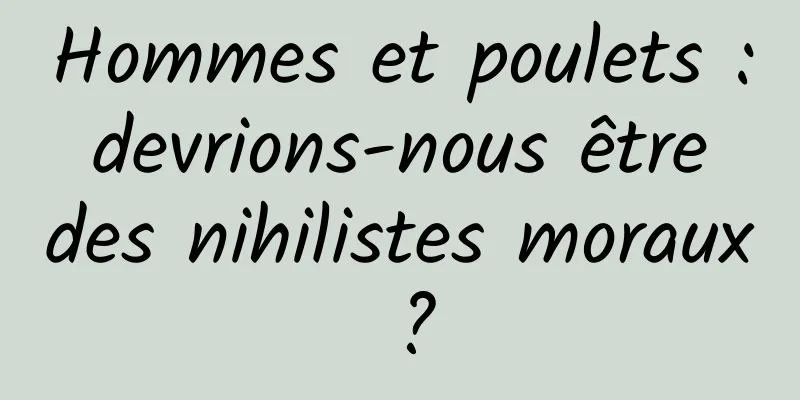
|
Presse Léviathan : Le sens moral de l’homme est lié à de nombreux facteurs, parmi lesquels le « dégoût » est une réponse émotionnelle relativement unique. D’un point de vue évolutionniste, l’émergence du dégoût nous permet de rester à l’écart de certaines maladies (vous pouvez imaginer votre première réaction lorsque vous voyez des patients atteints de variole, de syphilis, etc.), tout en garantissant que nous ne sommes pas exclus de groupes relativement dominants dans la culture sociale. Le cas hypothétique au début de l’article est bien sûr un peu extrême, mais il s’est bel et bien produit dans la réalité (du moins, vous en avez entendu parler dans les nouvelles et les rumeurs), et je crois que la première réaction de beaucoup de gens est le dégoût et le dégoût. Maintenant, supposons que cet homme ait des relations sexuelles avec un autre homme, votre dégoût serait-il atténué ? Supposons maintenant que cet homme ait une relation avec un robot à intelligence artificielle, comment réagirait votre sens moral ? À mon avis, le silence moral se produit de temps à autre, mais ce que l'on appelle le bien et le mal sont également fluides - nous pouvons le voir dans l'attitude des gens envers l'homosexualité et les robots sexuels aujourd'hui (même s'ils ne comprennent pas, ils peuvent le tolérer). En d’autres termes, notre sentiment de dégoût est également construit dans un sens, mais la question est de savoir si la diversité inhérente à la moralité humaine peut être conciliée avec le résultat final ? Un homme va au supermarché une fois par semaine pour acheter du poulet. Mais avant de cuire le poulet, il a eu des relations sexuelles avec lui, puis l'a cuit et mangé. Personne n’est au courant de ce comportement étrange, sauf vous. Personne n’a été blessé par le comportement inhabituel de cet homme avec le poulet mort. Pensez-vous que cet homme a commis une erreur morale ? Jonathan Haidt (1963-). © New Statesman Dans son livre The Righteous Mind, le psychologue moral Jonathan Haidt cherche à trouver les fondements moraux des êtres humains. Il veut nous convaincre que la morale est un concept vaste et riche. En proposant aux lecteurs une expérience de pensée au début du livre, Haidt nous invite à considérer comment les émotions et les intuitions sous-tendent le raisonnement moral. Dans les deux chapitres suivants, Haidt explique ce qu’il appelle les principes de la psychologie morale : 1. L’intuition vient en premier, suivie du raisonnement stratégique ; 2. La moralité ne se limite pas à la notion de préjudice et d’équité. À travers plusieurs expériences sociales, Haidt et ses collègues ont montré que la plupart de nos jugements moraux sont basés sur nos réactions émotionnelles immédiates aux événements. La plupart d’entre nous seraient instantanément dégoûtés par l’idée d’un homme étrange ayant des relations sexuelles avec un poulet mort. Haidt soutient que nous trouverons des moyens de rationaliser notre aversion pour le comportement (généralement en recherchant les raisons pour lesquelles il cause du tort). Il appelle cela « la réinvention après coup ». Le premier principe de Haidt vise à remettre en question la tradition intellectuelle bien ancrée du « rationalisme ». La vision traditionnelle est que les questions de moralité et de ce qui est bien et mal peuvent être résolues par un raisonnement et une argumentation rigoureux. Haidt cherche à souligner le rôle des émotions et des intuitions dans la philosophie morale. Comme si cela ne suffisait pas, Haidt poursuit en énonçant son deuxième principe : la moralité n’est pas simplement une question de préjudice ou d’équité. En effet, quiconque a étudié la philosophie morale occidentale aura remarqué que les gens prennent très au sérieux les questions de préjudice et d’équité. En fait, certaines des premières théories éthiques que nous introduisons dans la philosophie morale sont l’utilitarisme (qui concerne principalement le préjudice) et la déontologie (qui concerne principalement l’équité). Certains pourraient être surpris lorsque Haidt affirme avec audace que la moralité est bien plus que ces deux concepts. Il propose au moins quatre fondements à notre « sens moral ». Il soutient que nous avons des émotions morales (par exemple, le dégoût, la répulsion, le désir) en réponse à ces sujets, similaires à celles du préjudice et de l’équité. Les quatre autres fondements/thèmes qu’il introduit sont la « loyauté », « l’autorité », la « sainteté » et la « liberté ». Ces sujets supplémentaires ajoutent à notre complexité morale et expliquent pourquoi certains jugements moraux sont si difficiles à accepter. Il est important de noter que ces thèmes aident à expliquer pourquoi nous avons tant de mal à rationaliser nos jugements moraux. Par exemple, le fondement de la « sainteté » explique pourquoi nous sommes instantanément dégoûtés par l’homme qui a des relations sexuelles avec un poulet. Mais parce que nous manquons d’un système moral adéquat pour rationaliser notre dégoût pour un tel comportement, nous nous trouvons, selon les termes de Haidt, dans un état d’aphonie morale. En effet, il est beaucoup plus facile de trouver des raisons pour expliquer pourquoi il est moralement mal de battre un poulet avec un bâton que d’expliquer pourquoi il est également moralement mal de jouer avec un poulet mort. Psychologie morale et relativisme ? Les arguments les plus intéressants de Haidt se trouvent peut-être dans les chapitres suivants, où il explique pourquoi différents groupes ont des engagements moraux radicaux. Parce que la moralité ne se résume pas à la notion de préjudice et d’équité, Haidt soutient que chaque personne a des degrés variables d’engagement envers différents fondements moraux. Il explique que les conservateurs se soucient davantage de « loyauté », de « sainteté » et d’« autorité » que de « bienveillance » et d’« équité ». Les conservateurs sont plus susceptibles de condamner l’acte d’avoir des relations sexuelles avec un poulet mort que les libéraux (même si les deux seraient dégoûtés par cet acte). La thèse de Haidt est ce que les philosophes moraux appellent « le relativisme moral descriptif ». C’est-à-dire que l’expérience montre que des différences morales existent dans chaque société. Haidt ne se considère jamais comme un relativiste. Au mieux, il se qualifie de pluraliste (une personne qui croit que les valeurs sont multiformes). Mais pour ceux qui croient que la science (ou la méthode scientifique) peut nous enseigner la morale, comme Sam Harris, Richard Dawkins ou même Haidt, on ne peut s’empêcher de se poser une question importante : La science peut-elle nous dire ce qu’une personne devrait et ne devrait pas faire ? Haidt admet que la psychologie morale ne peut nous renseigner que sur la structure psychologique du raisonnement moral. La psychologie ne peut nous dire que comment les humains perçoivent et conceptualisent la moralité, et non ce qui est bien ou mal. Jusqu’à présent, la psychologie morale nous explique pourquoi nous avons une aversion innée, intuitive et immédiate pour certains comportements. Il explique également comment nous développons le raisonnement moral (souvent en « recadrant les choses après coup » pour rationaliser notre aversion innée pour les choses). Mais cela ne nous dit pas si ces actions sont réellement mauvaises. Si nous poussons cette proposition plus loin, nous serons enclins à croire au relativisme moral métaéthique. L’idée est que « la vérité ou la fausseté des jugements moraux ou de leurs raisons ne sont pas absolues ou universelles, mais relatives aux traditions, aux croyances ou aux pratiques d’un groupe ». (plato.stanford.edu/entries/moral-relativism/) En effet, dans le livre de Haidt, il décrit ses propres aventures en Inde, où il a fait l'expérience directe d'une série de codes moraux auxquels les Indiens adhéraient et qui lui étaient étrangers. Il a également découvert certaines pratiques que les Indiens trouvaient moralement répréhensibles mais qui étaient acceptables pour les Américains. L’une d’elles consiste à appeler les parents par leur prénom, ce qui est généralement tabou dans la plupart des sociétés asiatiques. Encore une fois, Haidt ne se qualifie jamais de relativiste moral et ne soutient pas que la psychologie morale est une théorie morale relative. Cependant, il est facile de penser de cette façon. Si les jugements moraux sont largement fondés sur nos intuitions, et que nous acquérons ces intuitions de la société, alors nous pouvons dire que les jugements moraux découlent en grande partie des valeurs sociales dont nous héritons. Maintenant, la première réaction de chacun serait : comment savoir qui a raison et qui a tort ? Discuter des possibilités La psychologie morale actuelle manque d’une prétention cohérente et cohérente à une éthique normative. Il ne nous dit pas ce que nous devrions ou ne devrions pas faire. Le livre de Haidt nous enseigne la diversité inhérente à la constitution morale et, en ce sens, il doit être hautement loué. Il explique pourquoi nous nous désapprouvons instinctivement les uns les autres et pourquoi il est difficile pour les personnes qui se désapprouvent les unes les autres d’avoir une conversation. Haidt nous encourage à modérer notre intuition et à écouter avec compassion ceux qui ne sont pas d’accord avec nous. Même s’il n’est pas optimiste quant à la possibilité de parvenir à un quelconque accord, il le considère néanmoins comme une base suffisante pour développer un dialogue important et significatif. Mais pour que la psychologie morale ait son mot à dire dans l’éthique normative, elle devrait au moins nous informer des développements psychologiques nécessaires que nous devrions adopter. Si nos jugements moraux découlent de notre psychologie, alors la psychologie morale peut facilement dire quelles intuitions, émotions et attitudes guident nos jugements moraux. L’inceste a toujours été un thème dans la mythologie grecque antique. Sur la photo : Vénus et Mars, Botticelli. © The National GalleryPar exemple, si nous avons une aversion naturelle pour l’inceste, cette aversion devrait-elle justifier à juste titre notre condamnation morale (si nous condamnons l’inceste), ou devrions-nous considérer cette aversion comme une simple attitude (répulsion) sans égard à la moralité ? Même avec une compréhension globale de la psychologie humaine à ce jour, je doute encore que la science ou la psychologie morale puissent nous dire ce qui est moralement bien et mal. Notre meilleure chance est peut-être encore de chercher des réponses en dehors du domaine des sciences naturelles. Par Wei Xiang Traduit par Leeway Relecture/Yord Article original/theapeiron.co.uk/should-we-be-moral-nihilists-690c467b2137 Cet article est basé sur la licence Creative Commons (BY-NC) et est publié par Leeway sur Leviathan L'article ne reflète que les opinions de l'auteur et ne représente pas nécessairement la position de Leviathan |
<<: Où se cachent habituellement les escargots ? Qu'est-ce que les escargots aiment manger ?
Recommander des articles
Oubli chez les personnes âgées et maladie d'Alzheimer
Qu'est-ce que l'amnésie sénile ? Le décli...
Quelles précautions faut-il prendre lors de l’extraction d’une dent ?
La santé bucco-dentaire est un problème qui préoc...
Que pensez-vous de Xizhong.com ? Avis sur Xizhong.com et informations sur le site Web
Qu'est-ce que Xizhong.com ? China Greece Web e...
« Katri, la fille de la ferme » : une analyse approfondie de l'histoire touchante et de l'attrait de ses personnages
Katri, la fille de la ferme - Une histoire émouva...
Et Calvin Klein ? Avis sur Kevin Klein et informations sur le site Web
Quel est le site Web de Kevin Klein ? Calvin Klein...
Comment prévenir la pneumonie à Mycoplasma chez les enfants ?
Comment prévenir la pneumonie à Mycoplasma chez l...
Comment se forment les muscles du mollet
Des muscles du mollet trop épais affecteront la b...
Le vent froid me donne mal à la tête
En été, quand il fait chaud, les gens ont tendanc...
【Science populaire】Soins à domicile pour les enfants fiévreux
Les enfants sont particulièrement sujets à la fiè...
« La règle des quatre heures de sommeil » ? Est-il vraiment fiable d’apprendre à dormir comme des animaux ?
« Tourner autour du pavillon rouge, abaisser la b...
Comment utiliser le lait pur périmé (les nutriments restants peuvent être absorbés par les plantes)
...
Et MSN ? Avis sur MSN et informations sur le site Web
Qu'est-ce que MSN ? MSN (Microsoft Service Net...
Quelles sont les différences entre les symptômes du vent-chaleur-froid et du vent-froid-froid ?
Il existe plusieurs types de rhumes. Les plus cou...
Boire du « liquide magique » avant un test physique peut-il réellement améliorer votre condition physique ?
Les médias m'ont récemment interviewé : j'...
Comment stériliser les biberons en verre
Les bouteilles de lait sont principalement utilis...