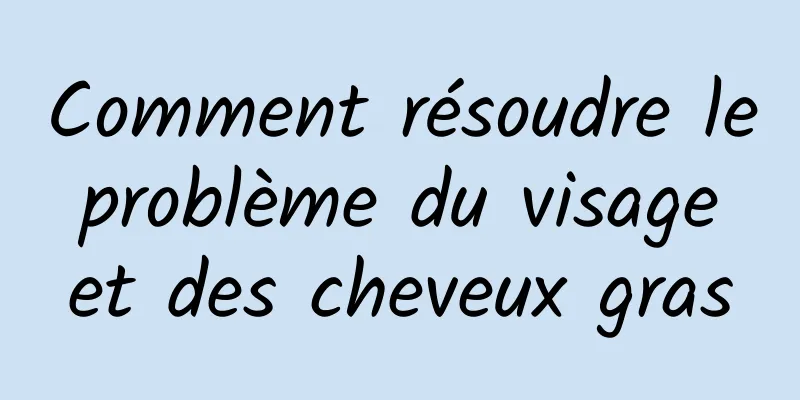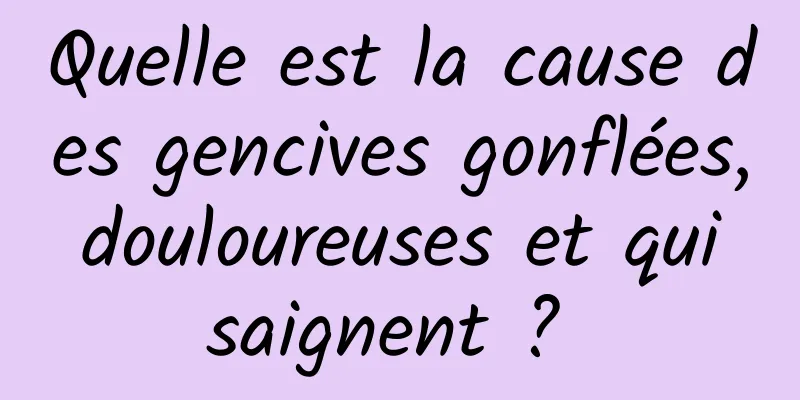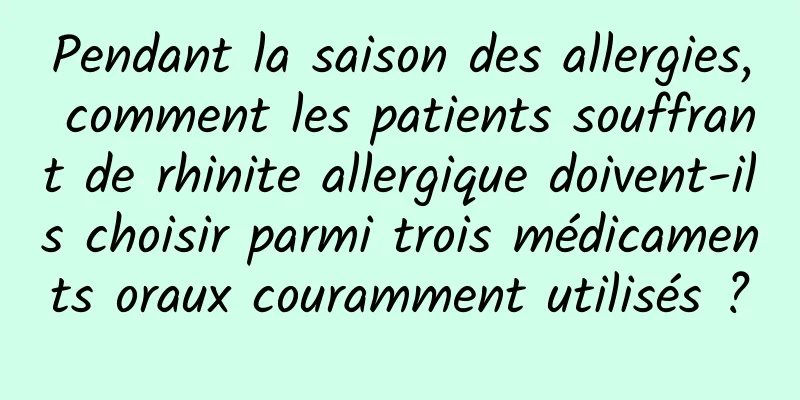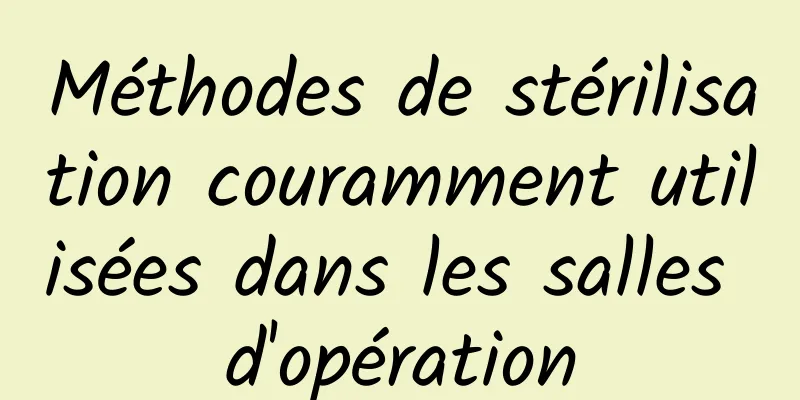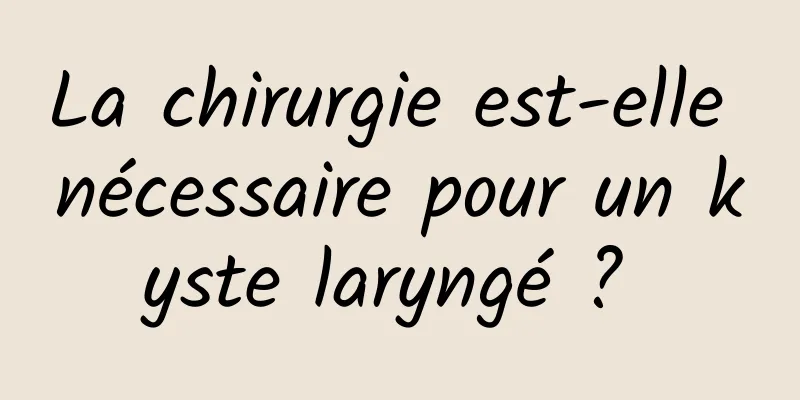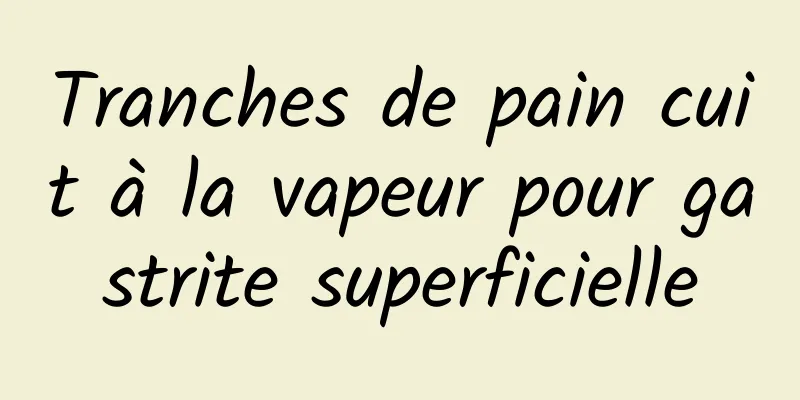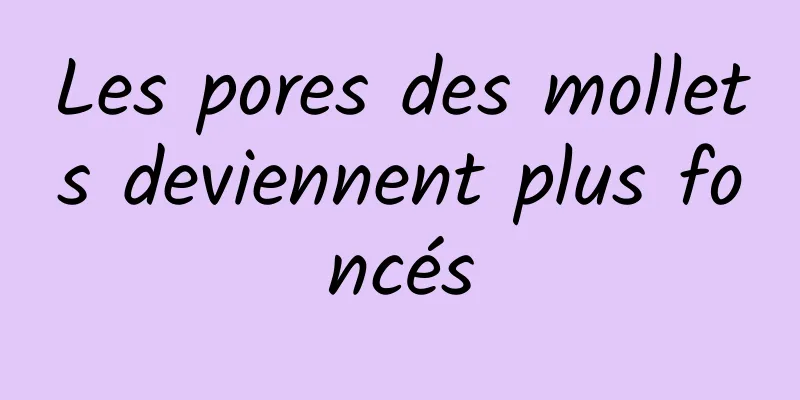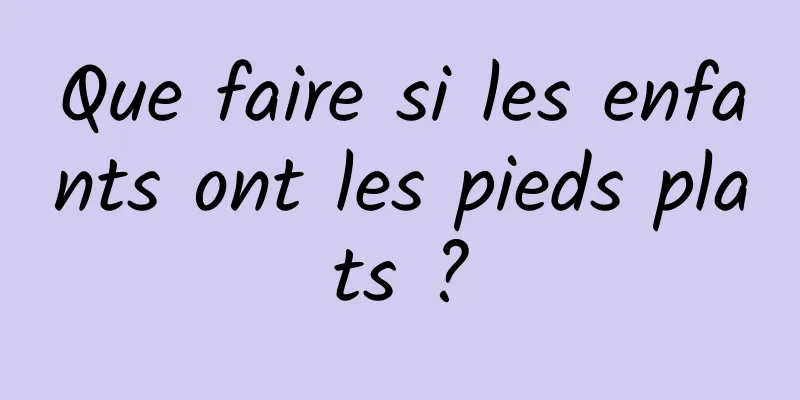Les moustiques se réveillent au printemps et en été, attention à l'encéphalite japonaise
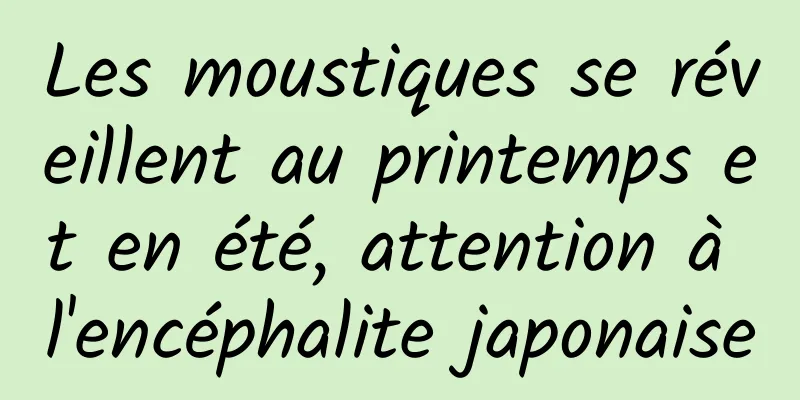
|
Les moustiques se réveillent au printemps et en été, attention à l'encéphalite japonaise Récemment, deux cas d’encéphalite japonaise ont été signalés dans la province de Taiwan, dans mon pays, et une personne est décédée. Après avoir entendu cette annonce, de nombreuses personnes se poseront des questions : comment se fait-il qu’une nouvelle encéphalite japonaise soit apparue ? En fait, si vous changez le terme, il deviendra plus familier. L'encéphalite japonaise est un autre nom pour la méningite épidémique B, abrégée en virus de l'encéphalite japonaise. Elle a été isolée pour la première fois par des chercheurs japonais en 1935 et est connue internationalement sous le nom d'encéphalite japonaise. Alors, à quoi ressemble le virus de l’encéphalite japonaise ? Le virus de l'encéphalite japonaise fait partie du genre Flavivirus de la famille des Flaviviridae. Les particules virales sont sphériques, avec un diamètre de 45 à 50 nm. La nucléocapside est icosaédrique et possède une enveloppe contenant des pointes de glycoprotéines. L'acide nucléique viral est un ARN simple brin positif et la longueur totale du génome est d'environ 11 kp. Les trois protéines structurelles codées par le génome viral sont la protéine de capside (protéine C), la protéine pré-membranaire (protéine prM) et la protéine d'enveloppe (protéine E). La protéine C est une protéine basique riche en arginine et en lysine, et joue un rôle important dans la réplication virale, la régulation de la transcription, l'assemblage et la libération. La protéine prM n’est présente que sur l’enveloppe des particules virales immatures. La protéine E est une protéine glycosylée intégrée dans l'enveloppe virale et est étroitement liée à l'adsorption, à la pénétration et à la pathogénicité du virus. L'antigénicité du virus de l'encéphalite japonaise est stable, avec un seul sérotype. Aucune variation antigénique évidente n’a été trouvée entre les isolats provenant de la même région et d’années différentes, et il n’y avait aucune différence évidente entre les isolats provenant de régions différentes et de périodes différentes. Sur la base de l'homologie de la séquence entière du gène E, le virus de l'encéphalite japonaise peut être divisé en cinq génotypes (I, II, III, IV et V), et chaque génotype a un fort effet de protection immunitaire croisée. La distribution des génotypes est quelque peu régionale, et les principaux génotypes répandus dans mon pays sont les génotypes I et III. Cela semble très compliqué, alors comment est-il cultivé ? Le virus de l'encéphalite japonaise peut proliférer dans diverses cellules primaires et transmises telles que les cellules C6/36 d'Aedes albopictus, les cellules Vero et les cellules BHK21 et provoquer des effets cytopathiques évidents. Parmi elles, les cellules C6/36 sont les cellules les plus sensibles au virus de l’encéphalite japonaise et sont largement utilisées dans l’isolement et la culture du virus. Les souris allaitantes sont les animaux les plus sensibles. Comment se propage l'infection ? Les principales sources d’infection par le virus de l’encéphalite japonaise sont le bétail, la volaille et divers oiseaux tels que les porcs, les bovins, les moutons, les chevaux, les ânes, les canards, les oies, les poulets, etc. qui sont porteurs du virus. Dans mon pays, les porcs sont la source d’infection et l’hôte intermédiaire la plus importante, en particulier les porcelets nés la même année. En raison de leur manque d’immunité, ils présentent un taux d’infection élevé et un titre élevé de virémie. Les éleveurs et les personnes qui les entourent peuvent être infectés en raison de contacts à haute fréquence avec le virus. Habituellement, la période d’infection maximale des porcs survient environ trois semaines plus tôt que la période d’incidence maximale des humains, de sorte que la tendance épidémique de l’année peut être prédite en examinant le taux d’infection des porcs. L’homme est l’hôte final de la chaîne de transmission de l’encéphalite japonaise. Les moustiques infectés peuvent transporter le virus pendant l’hiver et le transmettre par le biais des œufs. Les moustiques sont donc à la fois des vecteurs et des hôtes réservoirs importants. Avec le soutien de l’hôte, le virus de l’encéphalite japonaise devient endémique. Le principal vecteur du virus de l’encéphalite japonaise est Culex tritaeniorhynchus. De plus, Culex pipiens, Aedes albopictus, Culex twotaeniorhynchus, Culex snowbacked, Anopheles sinensis, etc. peuvent également être porteurs du virus. En plus des moustiques, le virus de l'encéphalite japonaise a également été isolé chez les moucherons, les moucherons pointus et les Culicoides, de sorte que ces insectes peuvent également être les vecteurs du virus de l'encéphalite japonaise. Après que le moustique a sucé le sang, le virus se multiplie d'abord dans les cellules épithéliales de l'intestin moyen, puis pénètre dans les glandes salivaires par la cavité sanguine et se transmet par la piqûre d'animaux sensibles tels que les porcs, les bovins, les moutons, les chevaux et autres animaux d'élevage ou de volaille. Le virus forme un cycle naturel de l’animal au moustique par l’intermédiaire des moustiques. Durant cette période, les moustiques infectés piquent les humains et provoquent une infection humaine. Alors, quelle est la pathogénicité du virus de l’encéphalite japonaise et pourquoi est-il si mortel ? Après que le virus pénètre dans le corps humain par la piqûre d'un moustique infecté, il prolifère d'abord dans les cellules de Langerhans, les macrophages et les ganglions lymphatiques locaux de la peau, puis pénètre dans la circulation sanguine par les capillaires et les vaisseaux lymphatiques, provoquant la première virémie. Le virus se propage dans la circulation sanguine jusqu'aux monocytes et aux macrophages du foie, de la rate, etc., continue de proliférer en grande quantité et pénètre à nouveau dans le sang, provoquant une deuxième virémie, qui se manifeste cliniquement par des symptômes pseudo-grippaux tels que fièvre, maux de tête, frissons et inconfort général. La grande majorité des personnes infectées ne développent plus la maladie et deviennent des infections avortées. Cependant, chez un petit nombre de personnes infectées ayant une faible immunité, le virus peut franchir la barrière hémato-encéphalique et envahir le système nerveux central, proliférer dans les cellules nerveuses du tissu cérébral, provoquer une dégénérescence des cellules nerveuses, une nécrose, une inflammation du parenchyme cérébral et des méninges, ainsi que des symptômes et des signes du système nerveux central, tels qu'une forte fièvre, des maux de tête, des troubles de la conscience, des convulsions et une irritation méningée. Dans les cas graves, la maladie peut évoluer vers un coma, une insuffisance respiratoire centrale ou une hernie cérébrale. Le taux de mortalité peut atteindre 10 à 30 %. Environ 5 à 20 % des survivants présentent des séquelles, se manifestant par une démence, une aphasie, une paralysie et des troubles mentaux. Si elle est infectée au cours du premier ou du deuxième mois de grossesse, elle peut entraîner une mortinatalité et une fausse couche. On constate que le taux de mortalité n’est pas faible dans les cas graves, alors comment peut-il être prévenu et traité ? Les principales mesures de prévention de l’encéphalite japonaise comprennent la vaccination, la lutte contre les moustiques et la gestion des réservoirs animaux. Il existe deux types de vaccins contre l’encéphalite japonaise : les vaccins inactivés et les vaccins vivants atténués. Le vaccin contre l’encéphalite japonaise largement utilisé à l’échelle internationale est principalement le vaccin inactivé purifié contre le cerveau de souris. Depuis 1968, mon pays utilise des vaccins inactivés cultivés à partir de cellules rénales de hamster pour mener à bien une vaccination planifiée des enfants, ce qui a permis d’obtenir des résultats remarquables et de contrôler efficacement la prévalence de l’encéphalite japonaise. Le vaccin vivant atténué contre l’encéphalite japonaise SA14-14-2, développé avec succès dans mon pays en 1988, présente de bons effets en termes de sécurité et de protection immunitaire. Il est désormais devenu le principal vaccin contre l’encéphalite japonaise dans mon pays et est également le seul vaccin vivant atténué contre l’encéphalite japonaise actuellement utilisé chez l’homme. Les porcs sont la principale source d’infection et l’hôte intermédiaire du virus de l’encéphalite japonaise. Par conséquent, le taux d’incidence dans la population humaine peut être réduit en gérant correctement les porcs ou en immunisant les troupeaux de porcs. Actuellement, il n’existe pas de traitement spécifique contre l’encéphalite japonaise. On peut constater que l’encéphalite japonaise est une maladie qu’il est plus important de prévenir que de guérir. Le printemps et l’été sont des lieux de reproduction pour les moustiques. À l’heure actuelle, nous devrions en apprendre davantage sur le virus de l’encéphalite japonaise afin d’améliorer notre sensibilisation à la prévention et de devenir notre propre gardien de sécurité. Les références dans cet article proviennent de la neuvième édition de Medical Microbiology |
>>: L’infection au VPH se transmet-elle uniquement par contact sexuel ?
Recommander des articles
eMarketer : le volume des transactions de paiement de proximité aux États-Unis dépassera 300 milliards de dollars en 2020
Compilation originale 199IT L'utilisation de ...
C'est quoi le problème avec trop de salive
Je ne sais pas si vous avez déjà prêté attention ...
L’ère sans antibiotiques est-elle vraiment en marche ? Ne soyez pas heureux trop tôt
Récemment, les médias ont rapporté que « les anti...
Le mélanome peut-il être guéri ?
Les tumeurs peuvent généralement être divisées en...
Shampoing antipelliculaire et anti-démangeaisons
De nombreuses personnes ont beaucoup de pellicule...
Quel est le meilleur moment pour faire de l'exercice le soir et comment le faire
Faire de l'exercice le soir est le meilleur m...
Ma bouée de sauvetage : une histoire émouvante qui dépeint les réalités de la jeunesse
« Ma ligne de vie » : le charme et l'importan...
L'efficacité de boire des tranches de Panax notoginseng trempées dans l'eau
Le Panax notoginseng est largement utilisé dans l...
Comment faire du vin avec des mûres_Comment faire du vin avec des mûres
La mûre est un fruit que les gens peuvent souvent...
À quel âge convient l'Essence Hydratante Shi Tingluya ? Que diriez-vous de l'Essence Hydratante Shi Tingluya ?
De nos jours, il existe de nombreux masques hydra...
À quoi ressemble le lait de pomme ciré ?
En ce qui concerne les pommes de cire, je pense q...
Dois-je acheter des billets pour la Grande Muraille de Badaling à l'avance ? Comment se rendre à la Grande Muraille de Badaling ?
La Grande Muraille est un paysage très spectacula...
Quels sont les moyens de nourrir les poumons en automne ?
L'automne est une saison que tout le monde ai...
Que puis-je manger pour améliorer la miction fréquente ?
La miction est un comportement tout à fait normal...
Comment traiter les piqûres de moucherons
Dans certaines zones envahies par les mauvaises h...