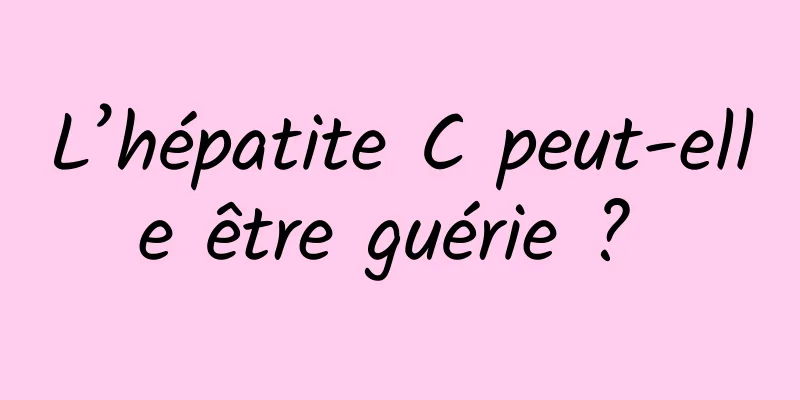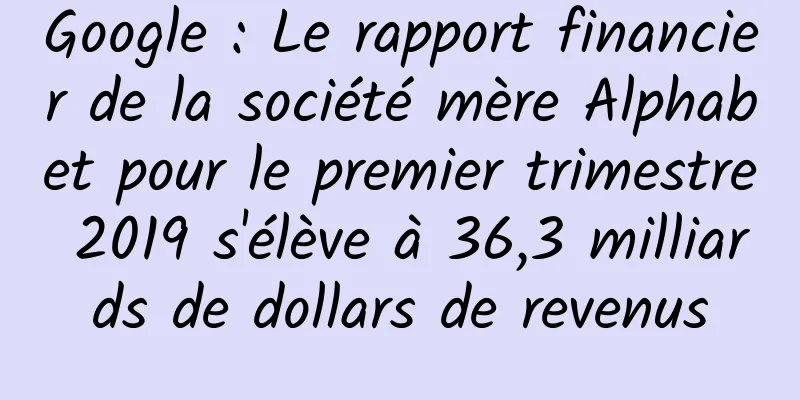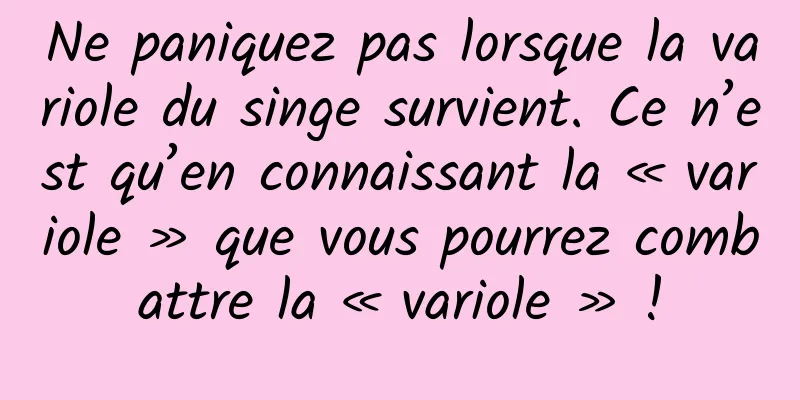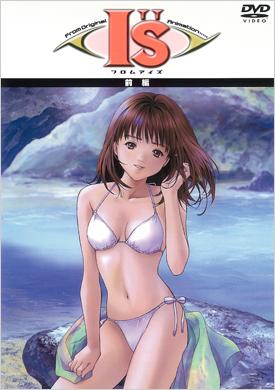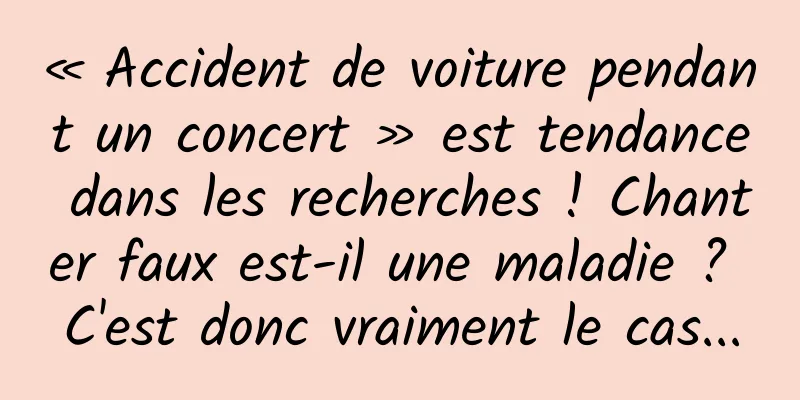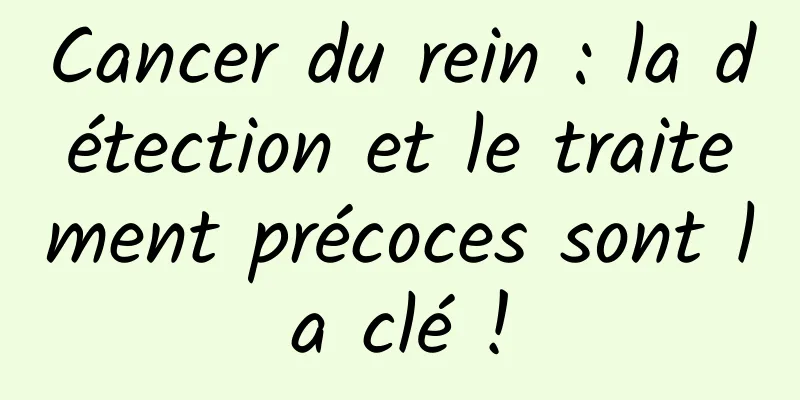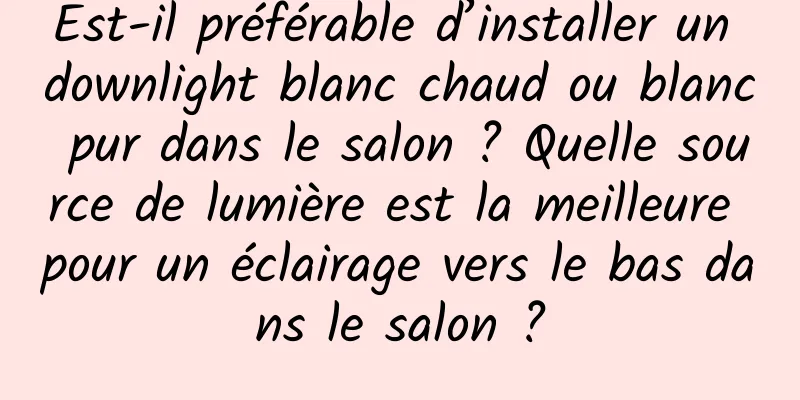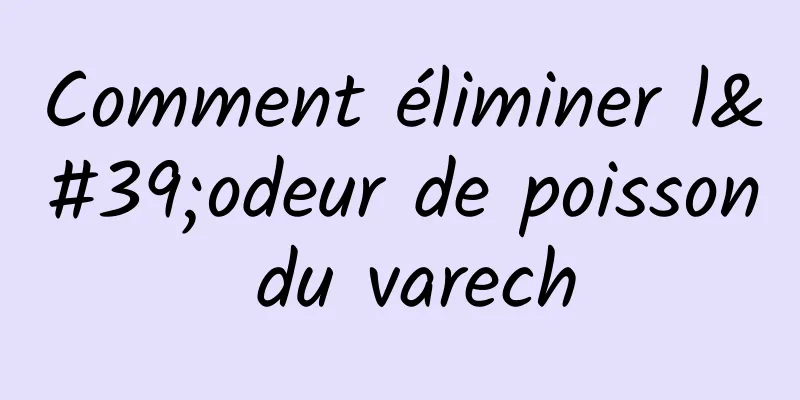Le virus qui « survit au plus fort » deviendra-t-il finalement le roi ?

|
David Quammen, un écrivain scientifique américain doué pour raconter des histoires, a publié le livre Spillover: Animal Infections and the Next Human Pandemic en 2012, qui revient sur les différentes maladies infectieuses auxquelles les humains ont été confrontés dans le passé et explore et réfléchit sur la relation entre les humains, les animaux sauvages et la nature. Il avait prédit que la prochaine pandémie serait toujours un virus, et maintenant, sa prédiction s’est malheureusement réalisée. Cet article est autorisé à être extrait du chapitre 6 « Stratégies de survie des virus » de la traduction chinoise du livre (« Fatal Contact », CITIC Press, 2020.6, 2e édition), qui explique les deux principales caractéristiques des virus : l'infectiosité et la toxicité. Du point de vue de la survie des virus, il explique l'importance des différents modes d'infection et de la toxicité des virus, et utilise l'exemple de l'Australie introduisant des virus pour tuer des lapins pour voir que le virus de la « survie du plus apte » deviendra finalement le roi. Cet article a été légèrement modifié. Accédez au compte public « Fanpu », cliquez sur « Lecture » et postez vos réflexions dans la zone de commentaires. D’ici 12h00 le 16 juillet 2020, nous sélectionnerons 3 messages et remettrons à chaque personne un exemplaire du livre. Par David Quammen Traduit par Liu Ying Relecture | Zhang Jinshuo, Xu Hengmin La prochaine épidémie virale, un concept que j’ai mentionné au début de ce livre, est un concept auquel les scientifiques du monde entier font fréquemment référence. Ils y ont réfléchi à plusieurs reprises, en ont discuté en profondeur et sont déjà habitués à ce qu’on leur pose des questions sur le sujet. Mais jusqu’à présent, le mystère n’a pas été résolu. Mais la pensée de la prochaine épidémie virale est toujours présente dans leur esprit. Le SIDA est aujourd’hui la maladie infectieuse la plus courante. Jusqu'à présent, sa puissance ultime (portée des dégâts et zone de contact) ne peut même pas être prédite. Actuellement, environ 30 millions de personnes sont mortes du sida et environ 34 millions de personnes ont été infectées. Cette infection continue toujours et aucune fin n’est en vue. La polio était également une maladie grave, du moins aux États-Unis, où elle est devenue célèbre parce qu’un homme qu’elle a infecté est devenu plus tard président des États-Unis. (Note de l'éditeur : Des études ultérieures ont montré que c'était le syndrome de Guillain-Barré qui était à l'origine de la paralysie des membres inférieurs de Franklin Roosevelt.) Au cours des années les plus graves de l'infection par la polio, des milliers d'enfants ont souffert de la maladie, et beaucoup d'entre eux sont malheureusement devenus paralysés ou sont même morts. Face à une maladie aussi répandue, le public est aussi abasourdi et impuissant qu’un cerf face aux phares éblouissants. Cependant, la propagation de la polio a entraîné des changements radicaux dans la manière dont la recherche médicale à grande échelle était financée et gérée. La plus grande maladie infectieuse du XXe siècle fut la pandémie de grippe de 1918-1919. Avant cela, la variole était également un problème important pour les habitants du continent nord-américain. Il a été introduit avec la force expéditionnaire d'Espagne vers 1520 et a aidé Cortés à conquérir le Mexique. Si l’on considère l’Europe d’il y a deux siècles, la peste noire était probablement à cette époque une sorte de peste. Que la bactérie à l'origine de la peste soit un bacille ou une bactérie plus mystérieuse (de nombreux historiens ont récemment débattu de cette question), il ne fait aucun doute que la peste noire était une maladie extrêmement menaçante qui a causé la mort d'humains à l'époque. Entre 1347 et 1352, au moins 30 % des Européens sont morts de cette maladie infectieuse. En résumé : si une population est dynamique, a une densité de population élevée et qu’une nouvelle maladie infectieuse apparaît parmi elle, l’infection n’est qu’une question de temps. Vous remarquerez peut-être que tous ces agents pathogènes ne sont pas des virus, mais la plupart d’entre eux le sont. Maintenant que les antibiotiques sont largement utilisés, réduisant considérablement le taux de mortalité des infections bactériennes, nous pouvons sans risque supposer que la prochaine épidémie majeure sera toujours d’origine virale. Pour comprendre pourquoi certaines épidémies virales ont des conséquences si graves, certaines provoquent même de graves catastrophes, tandis que d’autres passent simplement à toute vitesse ou disparaissent silencieusement sans causer de dommages, considérons deux aspects des virus : l’infectiosité et la virulence. Ce sont deux paramètres très importants, tout comme la vitesse et la masse en physique, qui jouent un rôle décisif. Ces deux facteurs, ainsi que plusieurs autres, déterminent en grande partie l’ampleur globale de l’épidémie. Aucune des deux n’est constante et la relation entre les deux est relative. Ils reflètent le lien entre le virus et son hôte et le virus et le monde extérieur, reflétant l’environnement externe, et pas seulement les micro-organismes eux-mêmes. L’infectiosité et la virulence sont le yin et le yang de l’écologie virale. Les différentes stratégies de transmission ont leurs propres avantages et inconvénients. La description la plus simple de l’infectiosité est que les virus doivent se répliquer et se propager pour survivre. Vous avez sûrement déjà entendu des déclarations comme celle-ci. Les virus ne peuvent se répliquer que dans les cellules hôtes, pour les raisons que nous avons déjà mentionnées. La transmission fait référence au transfert d’un virus d’un hôte à un autre, et la contagiosité fait référence à un ensemble de propriétés qui permettent à un virus de se propager. Les particules virales pourraient-elles s’accumuler dans la gorge ou les voies respiratoires de l’hôte, provoquant une toux ou un éternuement chez l’hôte, utilisant ainsi cette force pour propager le virus ? Une fois que les virus pénètrent dans l’environnement extérieur, peuvent-ils résister à l’épreuve de la dessiccation et des rayons ultraviolets, même pendant quelques minutes ? Lorsqu'ils envahissent un nouvel individu, peuvent-ils atterrir sur un autre type de muqueuse (nez, gorge, yeux), s'y attacher, puis pénétrer dans la cellule pour démarrer un autre cycle de réplication ? Si cette série d’étapes est réalisée avec succès, le virus est très contagieux et peut être transmis d’un hôte à un autre par voie aérienne. Heureusement, tous les virus ne se propagent pas par voie aérienne. Si le VIH-1 pouvait être transmis par l’air, vous et moi serions probablement morts depuis longtemps. Si la rage pouvait être transmise par voie aérienne, elle serait l’agent pathogène le plus terrifiant au monde. La grippe est une maladie très aéroportée, c’est pourquoi de nouvelles souches peuvent se propager dans le monde entier en quelques jours seulement. Le virus du SRAS se transmet également par cette voie, ou par des gouttelettes provenant des éternuements et de la toux. Il peut flotter dans les couloirs d’un hôtel ou se déplacer librement dans la cabine d’un avion. Un environnement d’une telle capacité, associé à un taux de mortalité de près de 10 %, est la raison pour laquelle il a donné froid dans le dos à de nombreuses personnes qui le connaissaient en 2003. Mais d’autres virus empruntent d’autres voies de transmission, chacune avec ses propres avantages et inconvénients. La voie de transmission fécale-orale semble dégoûtante, mais elle est très courante. Cette voie de transmission est efficace pour certains virus car les organismes hôtes (y compris les humains) sont souvent impuissants, en particulier lorsqu’ils vivent dans des groupes à forte densité, où l’eau ou la nourriture qu’ils consomment sont susceptibles d’être contaminées par les excréments des autres membres. C’est l’une des raisons pour lesquelles les enfants meurent de déshydratation dans les camps de réfugiés lorsqu’il pleut. Le virus pénètre dans l’hôte par la bouche et se réplique dans l’abdomen ou les intestins de l’hôte, provoquant des maladies gastro-intestinales et une diarrhée sévère. Bien entendu, le virus peut également se propager à d’autres parties du corps. La diarrhée fait partie d’une stratégie de transmission efficace de ce virus. Les virus qui se propagent de cette manière auraient beaucoup de mal à se propager dans l’environnement extérieur, car ils devraient rester près du puits d’égout pendant un jour ou deux jusqu’à ce que quelqu’un assoiffé et affamé vienne boire l’eau. Il existe toute une classe de virus qui se transmettent de cette manière : les entérovirus, un groupe d’environ 70 virus, dont le polio. Ils attaquent tous l’intestin humain et la plupart n’infectent que les humains et ne provoquent pas de maladies zoonotiques. De toute évidence, ils n’ont plus besoin d’infecter les animaux, car le monde humain surpeuplé suffit à assurer leur survie. Les voies de transmission des virus transmissibles par le sang sont relativement complexes. D’une manière générale, ce canal de communication doit s’appuyer sur un tiers : le support de communication. Le virus se réplique entièrement dans le sang de l’hôte, provoquant une virémie sévère (sang rempli de particules virales). Le vecteur (un insecte suceur de sang ou un autre arthropode) doit se régaler de l'hôte, siroter le sang de l'hôte ainsi que le sang du virus, puis l'emporter. Le vecteur lui-même doit être un hôte hospitalier pour que le virus puisse se répliquer dans son corps et produire davantage de virémie. Le sang viral doit atteindre la cavité buccale du vecteur et être prêt à être libéré à tout moment. Ensuite, lorsque le vecteur pique l’hôte, il libère de la virorrhée (tout comme en crachant de la salive anticoagulante). Le virus de la fièvre jaune, le virus du Nil occidental et le virus de la dengue se propagent tous de cette manière. Ce mode de communication présente des avantages et des inconvénients. L’inconvénient est que la transmission vectorielle nécessite une adaptation à deux environnements très différents : la circulation sanguine des vertébrés et la cavité abdominale des arthropodes. Un virus peut bien se développer dans un environnement mais ne pas être capable de survivre du tout dans un autre. Le virus doit donc préparer deux ensembles de gènes génétiques. L’avantage de cette voie de transmission est que les virus transmissibles par le sang ont un porteur qui peut transporter le virus sans relâche et avec empressement à trouver un nouvel hôte. Les gouttelettes d'air provenant d'un éternuement doivent voyager quelque peu au hasard avec le vent, mais les moustiques peuvent voler contre le vent vers leurs victimes. C’est pourquoi la communication médiatique est un moyen de communication si efficace. Les virus transmissibles par le sang peuvent également être transmis à de nouveaux hôtes par des injections sous-cutanées et des transfusions sanguines, mais ces possibilités de transmission sont modernes et accidentelles, et ne sont qu'un complément aléatoire aux voies de transmission traditionnelles formées par l'évolution. Ebola et le VIH sont deux virus complètement différents avec des stratégies d’adaptation à l’environnement très différentes, mais ils peuvent tous deux être transmis par les aiguilles, tout comme l’hépatite C. Quant au virus Ebola, il se transmet également de personne à personne par contact sanguin étroit, par exemple lorsqu’une personne prend soin d’une autre. Dans une clinique au Congo, il y avait une infirmière dont les mains étaient gercées et avaient de petites coupures. Il ne lui a fallu que quelques minutes pour nettoyer les excréments sanglants de dysenterie sur le sol de sa petite clinique, mais cela a suffi pour qu'elle soit infectée par le virus Ebola. Il s’agit d’un mode de transmission particulier, et la manière dont le virus se propage dépend de lui-même. La manière normale dont le virus Ebola se propage est qu'il se transmet entre individus d'une manière ou d'une autre à l'aide d'un certain moyen de transmission (qui est encore inconnu à ce jour) comme hôte réservoir. Les modes de transmission ordinaires suffisent à perpétuer le virus Ebola. Des moyens spéciaux de diffusion peuvent déclencher chez eux une frénésie de réplication, les rendant extrêmement notoires, mais ils attireront bientôt le désastre sur eux-mêmes. Dans les petites cliniques à travers l’Afrique, le virus Ebola se transmet d’une personne à l’autre par l’intermédiaire de chiffons tachés de sang et d’aiguilles réutilisées. Ce n’est pas une stratégie à long terme pour sa survie ; il ne s’agit que d’un mode de transmission occasionnel et il a peu d’importance dans l’histoire évolutive plus large du virus Ebola (du moins jusqu’à présent). Bien sûr, cela pourrait changer. La transmission sexuelle est une bonne stratégie de transmission pour les virus qui ont une faible résistance à l’environnement extérieur. Cette voie de transmission ne nécessite pas de contact avec l’environnement extérieur, d’exposition à la lumière et à l’air sec. Lors de l'accouplement, les cellules des organes génitaux et des muqueuses de l'hôte entrent en contact direct et intime, et les particules virales peuvent être transmises directement d'un individu à un autre, et l'infection peut se produire simplement par friction (aucune pression requise). La transmission sexuelle est une stratégie conservatrice qui réduit le risque de transmission virale et élimine le besoin pour le virus de développer des défenses contre la sécheresse et la lumière du soleil. Mais cette méthode de transmission présente également des inconvénients : les possibilités de ce type de transmission sont évidemment relativement rares. Même les humains les plus lubriques n’ont pas de relations sexuelles aussi souvent qu’ils le prétendent. Par conséquent, les virus transmis par les rapports sexuels sont généralement plus patients. Ils passent par une longue période d’incubation, avec des récidives intermittentes (comme les virus de l’herpès) et une réplication lente (comme le VIH-1 et le virus de l’hépatite B), et n’apparaîtront pas à nouveau tant qu’ils ne se seront pas répliqués dans une certaine mesure. Cette patience du virus au sein de l’hôte lui permet de gagner du temps. Ils profitent de ce temps pour rencontrer davantage de partenaires sexuels et continuer à se propager. La transmission verticale est la transmission de la mère à l’enfant, qui est un autre mode de transmission lent et prudent. Le virus peut se propager de cette manière lorsqu’un animal est enceinte, met bas ou (dans le cas des mammifères) allaite ses petits. Par exemple, le VIH-1 peut être transmis de la mère au fœtus par le placenta, ou au nouveau-né par le canal génital, ou au bébé par l’allaitement, mais ces transmissions sont évitables et la prise de médicaments à l’avance peut réduire la possibilité de transmission de la mère à l’enfant. La rubéole (souvent considérée comme une forme de rougeole allemande) est causée par un virus qui peut se propager verticalement et par voie aérienne et peut tuer le fœtus ou lui causer des dommages très graves, notamment des troubles du rythme cardiaque et la cécité ou la surdité. C’est pourquoi, avant le vaccin contre la rubéole, il était conseillé aux jeunes filles de contracter le virus de la rubéole et de subir une légère poussée avant d’atteindre l’âge de procréer, après quoi elles seraient définitivement immunisées. Cependant, d’un point de vue strictement évolutif, la transmission verticale seule ne constitue pas une stratégie pour la survie à long terme du virus de la rubéole. Un fœtus avorté ou un enfant aveugle souffrant d’une maladie cardiaque sont tout aussi susceptibles d’être le point final d’une épidémie de rubéole qu’une infirmière congolaise porteuse du virus Ebola. Quelle que soit la manière dont un virus a tendance à se propager (par voie aérienne, fécale-orale, sanguine, sexuellement transmissible, verticalement ou simplement par la salive des mammifères comme la rage), il existe une vérité universelle : la transmission à elle seule ne peut pas provoquer la propagation d’un virus, et son rôle n’est qu’un aspect du yin et du yang écologiques. Toxicité : plus c'est fort, mieux c'est. La toxicité est un autre aspect de l’écologie virale, et sa signification est plus complexe. En fait, le mot toxicité est trop sophistiqué et constitue un concept relatif. Certains experts n'aiment pas utiliser ce mot, ils préfèrent utiliser « pathogénicité ». Ces deux mots sont presque synonymes, mais il y a une légère différence entre eux. La pathogénicité fait référence à la capacité d’un micro-organisme à provoquer une maladie, tandis que la virulence fait référence à la gravité de cette maladie, en particulier par rapport aux maladies causées par d’autres agents pathogènes d’espèces similaires. Dire qu’un virus est virulent peut sembler une tautologie ; après tout, le nom et l'adjectif viennent de la même racine. Mais si le mot « virus » est ramené à son nom original de « mucus toxique », alors lorsque vous entendez « pathogénicité », vous vous demanderez : « À quel point est-il toxique ? » Que vous dira la toxicité ? C'est la partie la plus compliquée. En matière de toxicité, la plupart d’entre nous ont entendu la vieille histoire : la première règle d’un parasitisme réussi est de ne pas tuer l’hôte. Un historien de la médecine fait remonter cette idée à Louis Pasteur, qui a noté que les parasites les plus efficaces sont ceux qui « coexistent harmonieusement avec leurs hôtes », de sorte que l’infection asymptomatique devrait être « l’état idéal du parasitisme ». Zinsser fait la même remarque dans Rats, Lice, and History. Grâce à l'observation à long terme d'un parasite et d'un hôte, il a découvert que les deux continuaient à s'adapter au cours de l'évolution, et finalement « l'envahisseur et l'envahi ont atteint un état de tolérance mutuelle ». Macfarlane Burnett est d'accord : En bref, lorsque deux organismes développent une relation hôte-parasite, le parasite ne peut survivre que parce que l’hôte lui fournit le meilleur service. Au lieu d’être détruit par l’hôte, le parasite développe une relation équilibrée et harmonieuse avec l’hôte. Les substances présentes dans le corps de l’hôte sont suffisantes pour fournir l’énergie nécessaire à la croissance et à la réplication du parasite, et l’énergie consommée n’est pas suffisante pour provoquer la mort de l’hôte. À première vue, cela semble logique, mais certaines personnes – du moins celles qui n’ont pas étudié la théorie de l’évolution parasitaire – pensent que ce point de vue est arbitraire. Cependant, même des experts renommés tels que Zinsser et Burnett n’ont pas donné de réponse directe quant à la raison pour laquelle ils étaient d’accord avec ce point de vue. Ils devaient savoir que cette « loi » n’était qu’une généralisation de cas individuels et avait une certaine signification. Mais certains virus notoires tuent leurs hôtes, avec un taux de mortalité allant jusqu’à 99 %, et peuvent maintenir ce record pendant un certain temps. Le virus de la rage et le VIH-1 en sont de bons exemples. Cependant, la question clé n’est pas de savoir si le virus tuera son hôte, mais quand il le fera. « Un pathogène qui tue rapidement son hôte se met en danger de survie, car il doit alors trouver de nouveaux hôtes très rapidement et fréquemment pour assurer sa survie et sa survie », a écrit l’historien William H. McNeill dans son livre phare de 1976 Plagues and Peoples. McNeill avait raison ; le mot clé de cette phrase est « rapidement ». Le temps c'est la vie. Les agents pathogènes tuent lentement leurs hôtes, ce qui est cruel et impitoyable, mais cela permet d’éviter la crise de survie. L’infectiosité et la toxicité du virus s’influencent et interagissent constamment les unes avec les autres, maintenant un équilibre dynamique. Où se situe le point d’équilibre de cet équilibre dynamique ? Cela dépend de la situation. Certains virus peuvent continuer à se propager pendant longtemps même s’ils tuent tous leurs hôtes, car ils peuvent trouver l’hôte suivant avant que l’hôte précédent ne meure. C’est le cas du virus de la rage, dont les hôtes sont généralement des chiens, des renards, des mouffettes ou d’autres mammifères carnivores qui ont généralement des dents acérées et un penchant pour la viande. Le virus de la rage infecte le cerveau de l'hôte, ce qui provoque chez lui une agressivité soudaine, incitant ainsi l'hôte fou à mordre sauvagement. Pendant ce temps, le virus infecte également les glandes salivaires de l'hôte et peut donc infecter avec succès la victime mordue. Même si l'hôte d'origine mourait finalement ou était abattu avec le vieux fusil de l'avocat Atticus Finch (NDLR : un personnage du roman « To Kill a Mockingbird » de l'écrivain américain Harper Lee), la transmission du virus ne serait toujours pas affectée. La rage survient parfois chez les bovins et les chevaux, mais on en entend rarement parler, probablement parce que les herbivores mordent rarement par colère, empêchant ainsi la transmission du virus. Un taureau enragé peut hurler pitoyablement ou fracasser un mur avec sa tête, mais il est peu probable qu'il poursuive les passants sur une route de campagne en grognant follement. En Afrique de l'Est, des cas occasionnels de rage sont signalés chez les chameaux, ce qui inquiète beaucoup les éleveurs de chameaux, car le plus ennuyeux chez les dromadaires est qu'ils mordent les gens. Une dépêche en provenance de la frontière nord-est de l'Ouganda rapporte qu'un chameau infecté par la rage est devenu fou, « sautant de haut en bas, mordant d'autres animaux et finissant par mourir ». Dans un autre cas au Soudan, un chameau enragé est devenu extrêmement agité, détruisant parfois des objets inanimés et parfois se mordant les pattes. Se mordre la jambe n’est pas grave, mais cela reflète la résistance de ce virus. Même les humains infectés par la rage peuvent infecter d’autres personnes en les mordant lorsqu’elles se débattent violemment dans les derniers stades de la maladie. Selon l’Organisation mondiale de la santé, aucun cas n’a été confirmé, mais certaines précautions sont parfois prises. Il y a quelques années, un agriculteur cambodgien est tombé malade après avoir été mordu par un chien enragé. Dans les derniers stades de la maladie, il a commencé à avoir des hallucinations et à souffrir de graves convulsions, qui sont finalement devenues si graves qu'il « aboyait comme un chien ». « Nous l’avons enchaîné et enfermé », se souvient plus tard sa femme. Comme pour le VIH-1 et la rage, presque tous les hôtes sont tués sans exception. Si l’on considère les virus les plus mortels, dans les décennies obscures précédant l’arrivée de la thérapie antirétrovirale combinée, c’était sans aucun doute le VIH-1, et c’est probablement toujours le cas (le temps nous le dira). Les décès ont diminué parmi plusieurs catégories de personnes séropositives (principalement celles qui peuvent se permettre des « cocktails » coûteux, une combinaison de médicaments), mais personne ne dit que le virus lui-même devient moins dangereux. Le VIH est essentiellement un organisme à évolution lente, il est donc classé comme un virus lent avec d’autres virus à évolution lente tels que le virus de l’excrétion de la myéline du mouton, le virus de l’immunodéficience féline et le virus de l’anémie infectieuse équine. Le VIH-1 peut pénétrer dans la circulation sanguine humaine et survivre dans le corps pendant dix ans, voire plus. Durant cette période, il se réplique progressivement et lentement, échappant au système de défense de l'organisme, provoquant de fortes fluctuations du nombre de virus et détruisant petit à petit les cellules qui régulent la fonction immunitaire. Finalement, le VIH mature porte le coup fatal. Au cours de ce processus, en particulier dans les premiers stades de l’infection (lorsque le taux sanguin viral augmente mais avant de redescendre), le virus a amplement le temps et la possibilité de se propager d’une personne à l’autre. Plus tard, lorsque nous avons étudié la manière dont le VIH s’est propagé initialement, le virus a gagné plus de temps et d’opportunités pour infecter. Dans le même temps, on peut affirmer que l’évolution a pu induire une grande variété de changements dans le VIH, une grande variété d’adaptations, une grande variété de nouvelles tendances, mais il n’y a aucune raison d’imaginer qu’une classe de variantes serait moins mortelle. L’exemple le plus connu de virulence virale réduite est le virus du myxome chez les lapins australiens. Cet exemple est devenu un paradigme. La myxomatose n’est pas une zoonose, mais elle a joué un rôle modeste mais important en aidant les scientifiques à comprendre comment la virulence virale est régulée au cours de l’évolution. Quel type de virus survit à la fin ? L'histoire se déroule au milieu du XIXe siècle. Un propriétaire terrien blanc, Thomas Austin, a eu l'idée d'introduire des lapins sauvages d'Europe en Australie. Il n’était pas le premier à introduire des lapins en Australie, mais il était le premier à introduire des lapins sauvages. Il les garde en liberté dans son domaine de Victoria, l'État le plus au sud de l'Australie continentale. Ces lapins sont libres de vivre dans une maison et peuvent survivre dans la nature, ils se reproduisent donc naturellement très rapidement (ce sont des lapins après tout). S'il avait simplement voulu profiter du plaisir de chasser les lapins, ou utiliser les lapins comme proies pour les chiens de chasse, alors la situation réelle était loin de ce qu'il imaginait. En seulement six ans, 20 000 lapins ont été tués sur son domaine, et d'innombrables autres se sont échappés de toutes les directions du domaine. En 1880, les lapins avaient traversé la rivière Murray jusqu'en Nouvelle-Galles du Sud, d'où ils ont continué à se propager vers le nord et l'ouest. L'avant-garde de cette armée de lapins avance à un rythme formidable d'environ 70 miles par an, y compris des arrêts occasionnels pour se reposer, récupérer et se reproduire. Au fil des décennies, il ne faisait aucun doute que la situation s’était aggravée. En 1950, on estimait à 600 millions le nombre de lapins en Australie, en concurrence avec la faune et le bétail locaux pour la nourriture et l'eau. Les Australiens ne pouvaient plus tolérer cela et décidèrent de prendre des mesures immédiates pour contrôler ces lapins. La même année, le gouvernement australien a accepté d’importer un virus de la variole du lapin, une forme de myxome, du Brésil. Ce virus peut infecter les lapins brésiliens mais ne cause pas beaucoup de dommages. Dans son Brésil natal, il ne provoque que de petits ulcères cutanés chez des hôtes familiers qui ne s'étendent pas et guérissent lentement. Cependant, les lapins brésiliens appartiennent à la catégorie des lapins des forêts d'Amérique du Sud, et des expériences ont montré que les conséquences de l'infection des lapins européens par ce virus américain peuvent être extrêmement graves. Oui, le myxome a agi comme une peste, tuant environ 99,6 % des lapins infectés. Ces lapins ont également développé des ulcères, mais ils n’étaient pas de petite taille. Il s’agissait plutôt de lésions ulcéreuses à grande échelle, non seulement sur la peau, mais aussi sur tous les organes du corps. La situation était très grave et les lapins mourraient dans les deux semaines suivant leur maladie. Le virus est principalement propagé par les moustiques, et les moustiques australiens sont non seulement très nombreux et assoiffés de sang, mais aussi désireux de sucer le sang de nouvelles espèces. Le virus semble se transmettre physiquement plutôt que biologiquement, ce qui signifie que les particules virales adhèrent à la bouche du moustique, plutôt que de se répliquer dans l'estomac ou les glandes salivaires du moustique pour produire des substances toxiques. Cette méthode de communication physique est une forme de communication médiatique relativement maladroite, mais elle est simple et efficace dans certaines situations. Après plusieurs lâchers expérimentaux du virus, la myxomatose a envahi les lapins de la vallée du Murray, provoquant une « épizootie spectaculaire ». Cela peut s’expliquer par le fait que la vitesse et l’ampleur de la propagation de la maladie sont « sans précédent dans l’histoire des maladies infectieuses ». C’est grâce aux brises que les moustiques et les moucherons transportent, sinon le virus ne se serait pas propagé aussi rapidement. Des milliers de carcasses de lapins ont été empilées comme des collines à travers Victoria, la Nouvelle-Galles du Sud et le Queensland. À l’exception des sympathisants des lapins et de ceux qui vivent de la fourrure de lapin bon marché, ce résultat est tout simplement gratifiant. Au cours de la décennie, deux choses se sont produites : le virus est devenu moins toxique et les lapins survivants sont devenus plus résistants au virus. Deuxièmement, le taux de mortalité a chuté et la population de lapins a commencé à rebondir. D’un point de vue simple à court terme, les choses sont ainsi, et nous pouvons en tirer une conclusion évidente : l’évolution peut réduire la toxicité des virus, et les virus et les hôtes ont tendance à être plus « mutuellement tolérants ». Mais ce n’est pas tout à fait exact. Les faits ont été établis grâce à des expériences minutieuses menées par un microbiologiste australien nommé Frank Fenner et ses collègues. En fait, la toxicité du virus a rapidement chuté d’une limite initiale de plus de 99 %, puis est restée stable à un niveau relativement bas, mais toujours assez élevé. Pouvez-vous croire qu’un taux de mortalité de « seulement » 90 % peut amener le virus et l’hôte à se tolérer ? Je n'y crois pas non plus. La toxicité maximale du virus est aussi élevée que le taux de mortalité du virus Ebola dans les zones rurales du Congo. Mais Fennell a découvert que c’était le cas. Lui et ses collègues ont collecté de nombreux échantillons de virus dans la nature, les ont testés pour détecter une infection sur des lapins propres et sains en captivité, puis ont comparé les conditions d'infection de chaque échantillon un par un pour étudier les changements de toxicité du virus. Ils ont découvert qu’il existait une grande diversité de variantes du virus. À des fins d’analyse, ils ont divisé ces variantes en cinq niveaux de myxome australien, allant des taux de mortalité élevés aux taux de mortalité faibles. Le premier niveau est la variété originale, avec un taux de mortalité proche de 100 % ; le deuxième niveau a un taux de mortalité supérieur à 95 % ; le troisième niveau se situe au milieu des cinq niveaux, avec un taux de mortalité compris entre 70 % et 95 % ; le quatrième niveau est légèrement plus doux ; le cinquième niveau est une version atténuée du virus (les symptômes provoqués sont très légers), seuls quelques lapins mourront et il est très approprié pour être utilisé comme vaccin. Quelle proportion de ces cinq niveaux est présente chez les lapins infectés ? En collectant des échantillons dans la nature, en effectuant des tests pour déterminer la présence de chaque catégorie, puis en suivant les changements dans la dominance proportionnelle au fil du temps, Fennell et ses collègues espèrent répondre à certaines questions fondamentales, notamment : le virus devient-il vraiment moins virulent ? L’évolution mutuelle des lapins et des microbes se dirige-t-elle vers ce que Zinsser appelle une « meilleure tolérance mutuelle », comme ce cinquième niveau inoffensif ? Les myxomes apprennent-ils à tuer leurs hôtes ? La réponse est non. Une décennie plus tard, Fennell et ses collègues ont découvert que les myxomes de grade tertiaire prédominaient et provoquaient toujours un taux de mortalité de plus de 70 % chez les lapins, représentant plus de la moitié de tous les échantillons collectés. Le type le plus mortel (niveau 1) a presque disparu, et le type le moins nocif (niveau 5) est encore rare. La situation semble s’être stabilisée. Mais est-ce que la situation s’est vraiment stabilisée ? Dix ans ne représentent qu’un clin d’œil dans le long voyage de l’évolution, et même pour les virus et les lapins qui se reproduisent rapidement, ce n’est qu’un clin d’œil. Fennell a continué à regarder. Vingt ans plus tard, il a signalé un changement radical : en 1980, les myxomes de grade tertiaire représentaient la moitié des échantillons collectés ; ils en représentent désormais les deux tiers. Un taux de mortalité élevé ne signifie pas toujours la mort. Le fait que le myxome du troisième pôle prospère dans la nature est un exemple d’évolution réussie. Une variété très douce, la cinquième année, a aujourd'hui disparu. Ce n’est pas qu’il n’était pas compétitif, mais pour une raison quelconque, il semblait échouer au test de Darwin : les inaptes étaient éliminés. Comment expliquer ce résultat inattendu ? Fennell a astucieusement émis l’hypothèse que la relation dynamique entre la virulence virale et la transmissibilité pourrait expliquer tout cela. Il a testé tous les virus à différents niveaux en utilisant des lapins et des moustiques capturés et a constaté que l'efficacité de la transmission était liée au nombre de virus disponibles sur la peau du lapin. Plus de lésions, ou une durée de lésions plus longue, signifie que plus de virus est disponible. Plus il y a de virus qui adhèrent à la bouche du moustique, plus le risque de transmission est élevé. Mais le « virus utilisable » est supposé provenir d’un lapin vivant, encore en train de saigner, ce qui signifie que le vecteur s’y intéresse toujours. Un lapin mort et raide n’attirera pas l’attention des moustiques. Fennell a trouvé un équilibre entre les deux résultats extrêmes de l’infection, entre les lapins qui se sont rétablis et ceux qui sont morts. « Des études en laboratoire ont montré que toutes les souches capables de produire des lésions fournissent suffisamment de virus pour la transmission », a-t-il écrit. Mais les virus hautement pathogènes (stades I et II) tuent les lapins rapidement, « si rapidement que les lésions ne restent contagieuses que quelques jours ». Les variétés les plus douces (grades 4 et 5) ont produit des lésions qui ont guéri rapidement. La riposte à une guérison rapide, a-t-il ajouté, est que « les lapins infectés par le virus de niveau 3 restent très contagieux pendant un certain temps avant de mourir, et ceux qui survivent restent contagieux encore plus longtemps ». À ce stade, le niveau 3 était encore capable de tuer environ 67 % des lapins exposés au virus. Après trois décennies de recherche, Fennell a découvert que le niveau de toxicité extrêmement mortel du virus du myxome maximise sa transmissibilité. Le virus tue la plupart des lapins infectés mais assure également sa propre survie, entretenant une infection continue. Est-ce le premier cas d’un parasite qui s’établit avec succès ? Le succès du myxome en Australie suggère que quelque chose est différent de la cristallisation de la sagesse conventionnelle que j’ai mentionnée plus tôt. Il ne s’agit pas de ne pas tuer votre hôte, mais de ne pas brûler les ponts. Quant à savoir qui a créé de telles règles, ce n’est qu’une question d’évolution. Plus tard, les scientifiques ont établi un modèle de dynamique épidémique (SIR) et ont proposé le taux de reproduction de base des personnes infectées, qui peut refléter la stratégie optimale pour l’évolution du virus. Un virus est directement lié à son taux de propagation au sein d’une population hôte et a une relation inverse et complexe avec sa pathogénicité, son taux de guérison et sa mortalité naturelle due à d’autres causes. Cependant, des circonstances spécifiques de transmissibilité et de toxicité doivent toujours être mentionnées. Cela dépend de l'écologie et de l'évolution. Les virus de l'ARN ont un taux de mutation élevé et un grand nombre, ce qui entraînera que le virus produira des changements plus adaptatifs. Le virus s'efforce de dépasser le système immunitaire de chaque hôte, de gagner le dessus et d'évacuation rapidement avec tout ce dont il a besoin avant que les défenses de l'hôte ne les combattent, puis en continuant. Mais les virus d'ADN présentent les caractéristiques extrêmes opposées. Leur taux de mutation est très faible et leur nombre global n'est pas important. La recherche d'auto-préservation et d'immortalité est devenue leur stratégie de survie, et ils ont tendance à emprunter une guerre prolongée. Si vous étiez ce virus coincé, sans garanties de sécurité à long terme, pas de temps à perdre, sans paris perd et seulement la capacité de s'adapter à de nouvelles circonstances, que feriez-vous? Jusqu'à présent, la recherche que nous avons faite a été sur la question qui m'intéresse le plus: "Ils sont souvent sélectionnés entre les espèces", a déclaré Edward C. Holmes, expert du virus. |
Recommander des articles
Puis-je bouger mon poignet cassé ?
En règle générale, si le poignet est fracturé mai...
F5 Networks : la moitié des utilisateurs d'Asie-Pacifique estiment que la sécurité est très importante pour l'expérience applicative
Les consommateurs d'Asie-Pacifique apprécient...
Critique de Doraemon le film « L'aventure spatiale de Nobita » : une histoire émouvante d'aventure spatiale et d'amitié
Doraemon le film : Chronique d'exploration sp...
Quelle est la raison de la sécheresse de la peau de la bouche
En fait, avec le changement de température, de no...
Quels sont les effets de la rétention d'urine en temps normal
De nombreuses personnes ont la mauvaise habitude ...
Le varech contient-il beaucoup de potassium ?
Le corps humain manque souvent de certains oligo-...
Les méfaits du vinaigre blanc et du miel
L'une des méthodes de perte de poids les plus...
Le rôle du corps ciliaire
Le corps ciliaire est un tissu épaissi en forme d...
Comment lire le rapport d'analyse sanguine ? | Musée des sciences
Je suis allé à l'hôpital pour un rhume et on ...
Canalys : les expéditions d'appareils audio intelligents en Inde ont augmenté de 55 % au deuxième trimestre 2022
Selon les dernières prévisions de Canalys, les ex...
Combien de temps faut-il pour que la douleur liée à une augmentation mammaire disparaisse ?
De nos jours, de nombreuses femmes sont très souc...
Quels sont les bienfaits de l'ananasier ?
L'ananas géant est également connu sous le no...
Personne ne ressent de douleur lorsque vos mains et vos pieds sont froids ?
Personne ne ressent de douleur lorsque ses mains ...
Comment corriger la protrusion de la hanche
L'os de la hanche est l'un des os les plu...