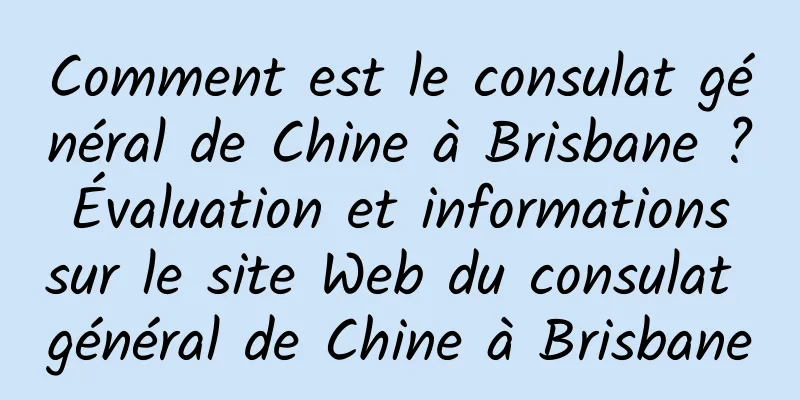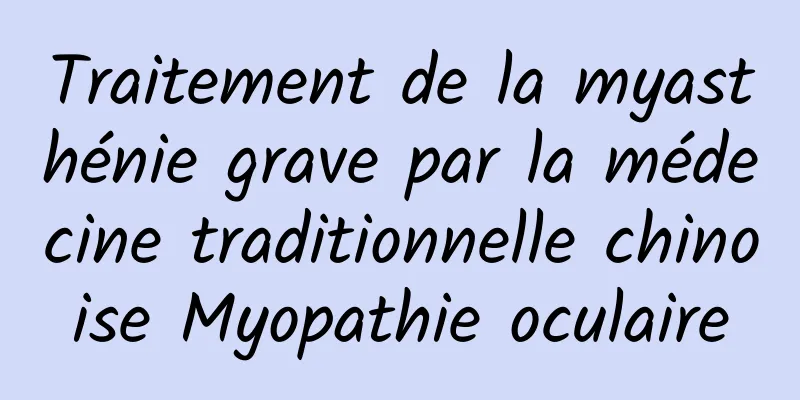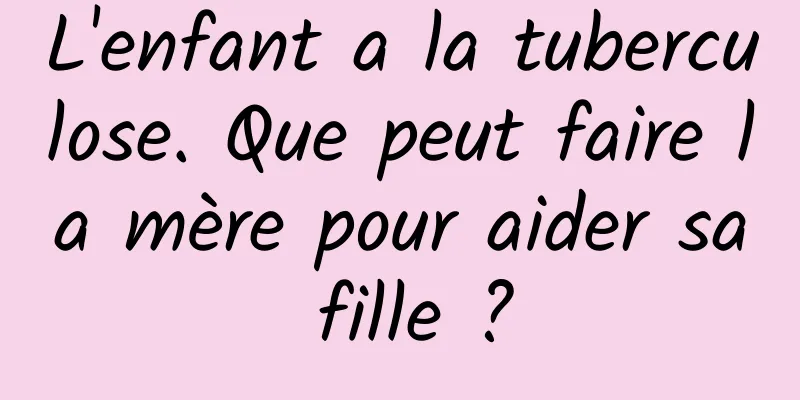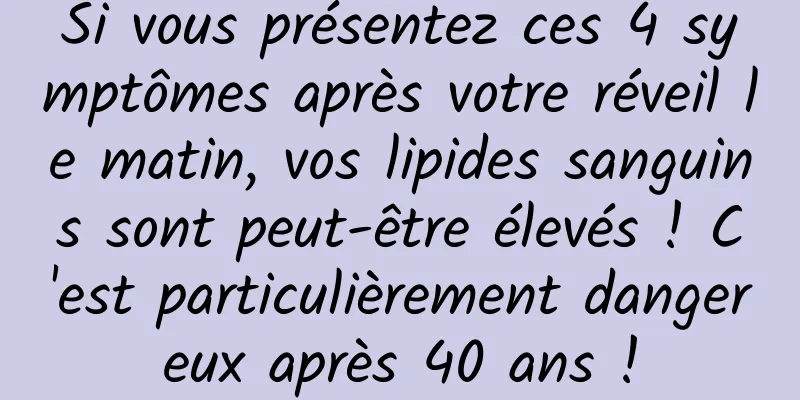Avez-vous une mentalité de victime ?
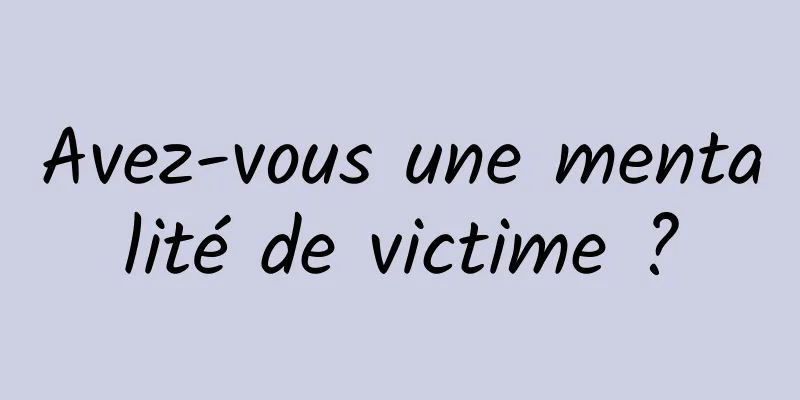
|
Presse Léviathan : Ces derniers jours, j'ai eu la chance de lire la nouvelle selon laquelle Zhu, le criminel impliqué dans l'affaire du meurtre de sa femme et de la dissimulation de son corps à Shanghai, a été exécuté le mois dernier. Je n’entrerai pas ici dans les détails de l’affaire. Les personnes intéressées peuvent rechercher elles-mêmes des rapports connexes. Ce qui m'intéresse, c'est combien de points Zhu obtiendrait s'il répondait à la question suivante sur la « tendance à la victimisation interpersonnelle » - en fait, il n'est pas difficile de voir, d'après les reportages des médias et ses aveux, que le manque de perception de la douleur des autres (empathie) de Zhu se reflète clairement en lui, et la logique à deux poids deux mesures de la mère de Zhu pour défendre son fils après l'incident est également sans voix et choquante. La « mentalité de victime » dans cet article concerne souvent ceux qui infligent du mal aux autres sans s’en rendre compte. De plus, ils ont souvent le sentiment que leurs « bonnes actions » ne sont pas comprises, ce qui donne naissance au sentiment que « les autres me doivent quelque chose ». La manifestation de cette personnalité anxieuse et dépendante est pleine de contradictions, mais sa logique interne est une boucle fermée cohérente - elle devient ainsi une « personne peu impressionnante ». Ce qui est le plus important pour moi, c’est que la personne qui m’a blessé se rende compte que j’ai été traité injustement. Si vous obtenez un score élevé (4 ou 5) à toutes ces questions, vous avez peut-être ce que les psychologues appellent une tendance à la victimisation interpersonnelle. Ambiguïté sociale La vie sociale est toujours ambiguë. Il se peut que votre rendez-vous ne réponde pas à votre SMS ; vos amis ne vous souriront peut-être pas en retour lorsque vous leur souriez ; et les étrangers peuvent parfois avoir des expressions malheureuses sur leurs visages. La question est : comment interprétez-vous ces situations ? Considérez-vous que tout cela vous est adressé ? Ou envisagez-vous des scénarios plus probables comme celui où votre ami passe une mauvaise journée, celui où votre nouveau rendez-vous est toujours intéressé mais essaie de faire la sourde oreille, et celui où l'étranger dans la rue est en colère à propos de quelque chose et ne remarque même pas votre existence ? Alors que la plupart des gens sont capables de surmonter ces ambiguïtés sociales relativement facilement en régulant leurs émotions et en acceptant que cela fait partie intégrante de la vie sociale, certaines personnes ont tendance à se considérer comme des victimes perpétuelles. Rahav Gabay et ses collègues définissent la victimisation interpersonnelle comme « un sentiment persistant d'être victime, omniprésent dans de multiples relations. De ce fait, la victimisation devient un élément fondamental de l'identité de l'individu. » Ceux qui ont une mentalité de victime perpétuelle ont tendance à avoir un « locus de contrôle externe ». Ils croient que la vie d’une personne est entièrement soumise à des forces extérieures à elle-même, telles que le destin, la chance ou la miséricorde des autres. (www.researchgate.net/publication/341548585_The_Tendency_for_Interpersonal_Victimhood_The_Personality_Construct_and_its_Consequences) Grâce à l’observation clinique et à la recherche, les chercheurs ont découvert qu’il existe quatre aspects principaux des tendances interpersonnelles à la victimisation : (a) Chercher continuellement à être reconnu comme victime ; (b) l’élitisme moral ; (c) le manque d’empathie pour la souffrance des autres; (d) Rumination fréquente sur des expériences de victimisation passées. Il est important de noter que les chercheurs n’associent pas le fait de vivre un traumatisme à une mentalité de victime. Ils soulignent qu’une mentalité de victime peut se développer sans subir de traumatisme ou de préjudice grave. À l’inverse, subir un traumatisme grave ou une victimisation ne signifie pas nécessairement qu’une personne développera une mentalité de victime. Cependant, la mentalité et le comportement de victime ont des processus et des résultats psychologiques similaires. De plus, les quatre caractéristiques de la mentalité de victime identifiées par les experts se situent au niveau individuel (les résultats de la recherche proviennent d’une étude d’échantillon de Juifs israéliens). Par conséquent, les résultats ne s’appliquent pas nécessairement au niveau du groupe. Mais il existe des écrits qui suggèrent qu’au niveau collectif, les deux mentalités de victime présentent des similitudes frappantes (comme je le soulignerai ci-dessous). Avec ces mises en garde à l’esprit, examinons de plus près les principales caractéristiques de la mentalité de victime perpétuelle. Mentalité de victime En quête constante de reconnaissance en tant que victime. Les personnes qui obtiennent un score élevé dans ce domaine ont un besoin constant que leur douleur soit reconnue. D’une manière générale, il s’agit d’une réponse psychologique normale à un traumatisme. Vivre un traumatisme nécessite souvent de briser nos hypothèses selon lesquelles le monde est un endroit juste et moral. Reconnaître sa propre condition de victime est une réponse normale au traumatisme et aide une personne à retrouver confiance dans le fait que le monde est un endroit juste et équitable où vivre. De plus, il est normal que les victimes souhaitent que leurs agresseurs assument la responsabilité de leurs méfaits et expriment leur culpabilité. Des recherches examinant les témoignages de patients et de thérapeutes ont révélé que la reconnaissance du traumatisme du patient est importante pour développer le rétablissement après un traumatisme et une victimisation. (www.researchgate.net/publication/15034528_Guilt_An_Interpersonal_Approach) Élitisme moral. Ceux qui obtiennent un score élevé dans cette dimension se considèrent comme ayant une position morale élevée et tous les autres comme immoraux. L’élitisme moral permet de contrôler les autres en les accusant d’être immoraux, injustes ou égoïstes, tout en se considérant comme « l’empereur moral ». (journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0533316414545707) L’élitisme moral se développe souvent comme un mécanisme de défense contre des émotions profondément douloureuses et devient un moyen de maintenir une image de soi positive. En conséquence, les personnes en détresse nient souvent leurs propres pulsions agressives et destructrices et les projettent sur les autres. L’« autre » est perçu comme menaçant, tandis que le soi est perçu comme persécuté, vulnérable et moralement supérieur. (journals.sagepub.com/doi/10.1177/0533316414545843) Même si les gens qui divisent le monde en « saints » et « démons » peuvent se protéger de la douleur et des dommages causés à leur image de soi, cette mentalité freine en fin de compte la croissance et le développement et ignore la capacité de voir la complexité de nous-mêmes et de la société. Manque d’empathie pour la douleur et la souffrance des autres. Les personnes qui obtiennent un score élevé dans cette dimension sont tellement concentrées sur leur propre statut de victime qu’elles sont aveugles à la douleur et à la souffrance des autres. Les recherches montrent que les personnes qui viennent d’être lésées ou qui se souviennent d’avoir été lésées dans le passé se sentent en droit de se comporter de manière agressive et égoïste, en ignorant la douleur des autres, en s’attribuant le mérite et en laissant les autres sans recours. Emily Zitek et ses collègues suggèrent que ces personnes peuvent avoir le sentiment d’avoir suffisamment souffert elles-mêmes, et qu’elles ne se sentent donc plus obligées de se soucier de la douleur et de la souffrance des autres. Ils laissent donc passer l’occasion d’aider leurs semblables. (pdfs.semanticscholar.org/34ae/fcaa1b7f3c7ca7c968bbe5294bdf8d2e951d.pdf) Au niveau du groupe, les recherches montrent qu’une attention accrue portée aux victimes au sein du groupe conduit à une diminution de l’empathie envers les groupes rivaux et les adversaires sans lien entre eux. La simple suggestion d’une victimisation peut même accroître un conflit en cours. Cette mentalité conduit à moins d’empathie pour l’adversaire. Les gens ne sont pas disposés à accepter une culpabilité collective à grande échelle pour les dommages actuels. En effet, les recherches sur la « victimisation compétitive » suggèrent que les membres d’un groupe engagés dans un conflit violent ont tendance à considérer leurs victimes comme exclusives et à minimiser, dévaloriser ou carrément nier la douleur et la souffrance de leurs adversaires. (www.jstor.org/stable/20447126) (journals.sagepub.com/doi/10.1177/1088868312440048) Si un groupe est complètement concentré sur sa propre souffrance, il développera ce que les psychologues appellent « l’égoïsme de la victimisation », c’est-à-dire que les membres sont incapables de voir les choses du point de vue du groupe rival, ne peuvent pas ou ne veulent pas sympathiser avec la souffrance du groupe rival et ne veulent pas assumer la responsabilité du préjudice causé par leur propre groupe. Réfléchissez fréquemment aux expériences passées de victimisation. Ceux qui obtiennent un score élevé dans cette dimension ruminent et parlent continuellement des erreurs qu’ils commettent dans leurs relations interpersonnelles et de leurs causes et conséquences, plutôt que de réfléchir ou de discuter de solutions possibles. Cela peut inclure l’anticipation d’un comportement agressif futur en fonction d’un comportement agressif passé. Les recherches montrent que les victimes ont tendance à ruminer les torts interpersonnels qu’elles ont subis, et cette rumination augmente le désir de se venger, réduisant ainsi le désir de demander pardon. Au niveau de l’analyse de groupe, le groupe de victimes avait tendance à ruminer fréquemment sur leurs événements traumatisants. Par exemple, la prévalence du matériel sur l’Holocauste dans les programmes scolaires juifs israéliens, les produits culturels et le discours politique a augmenté au fil des ans. Bien que les Juifs israéliens modernes ne soient généralement pas des victimes directes de l’Holocauste, les Israéliens sont de plus en plus préoccupés par l’Holocauste et craignent qu’il ne se reproduise. (citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.882.1430&rep=rep1&type=pdf) Conséquences d'une mentalité de victime Dans les conflits interpersonnels, chaque partie est motivée à maintenir une image morale positive d’elle-même. Par conséquent, différentes parties sont susceptibles de produire deux réalités subjectives complètement différentes. Les délinquants ont tendance à minimiser la gravité de leurs infractions, tandis que les victimes ont tendance à considérer les motivations du délinquant comme arbitraires, stupides et immorales, et plus graves. Par conséquent, l’état d’esprit qu’une personne développe en tant que victime ou agresseur a un impact fondamental sur la façon dont les gens perçoivent et se souviennent des situations. Gabay et ses collègues ont identifié trois principaux biais cognitifs qui caractérisent la victimisation interpersonnelle : le biais d’interprétation, le biais d’attribution et le biais de mémoire. Ces trois biais peuvent rendre les gens réticents à pardonner aux autres. Examinons de plus près ces biais. Expliquer les biais Le premier type de biais interprétatif concerne le caractère offensant perçu des situations sociales. Les chercheurs ont constaté que les personnes ayant des tendances plus élevées à la victimisation interpersonnelle considéraient les infractions de faible gravité (comme le manque d’entraide) et les infractions de forte gravité (comme les remarques offensantes sur leur intégrité et leur caractère) comme plus graves. Le deuxième type de biais d’interprétation implique des attentes de préjudice dans des situations ambiguës. Les chercheurs ont constaté que les personnes plus vulnérables dans leurs relations étaient également plus susceptibles de croire qu’un nouveau responsable de leur service ne se soucierait pas autant d’elles ou ne serait pas aussi disposé à les aider avant de les rencontrer. Attribution d'un comportement nuisible Les personnes ayant des tendances à la victimisation interpersonnelle étaient également plus susceptibles d’attribuer une intention négative aux auteurs et de ressentir une plus grande intensité et une plus longue durée d’émotions négatives après l’événement de victimisation. Ces résultats concordent avec les recherches montrant que la perception qu’ont les gens du caractère nuisible d’une interaction est souvent liée à leur perception que le comportement nuisible était proactif. Comparativement à ceux qui ont obtenu des scores plus faibles en matière de tendances interpersonnelles de victime, les personnes ayant des tendances interpersonnelles de victime étaient plus susceptibles de se sentir offensées parce qu’elles percevaient le délinquant comme ayant des intentions plus malveillantes. (journals.sagepub.com/doi/10.1177/0093650205277319) Ce biais existe également au niveau collectif. La psychologue sociale Noa Schori-Eyal et ses collègues ont constaté que les personnes qui obtenaient un score plus élevé sur une échelle d’« orientation de victimisation permanente au sein du groupe », qui mesure la croyance que l’on se sent continuellement victimisé et persécuté par différents ennemis au sein de son groupe à différents moments, étaient plus susceptibles de catégoriser les autres groupes comme hostiles à leur propre groupe et de réagir plus rapidement à une telle catégorisation (indiquant qu’une telle catégorisation est plus automatique). Les personnes qui obtiennent un score élevé sur cette échelle sont également plus susceptibles d’attribuer une intention malveillante à d’autres membres du groupe dans des situations ambiguës. Lorsqu’on leur rappelle un traumatisme historique de groupe, ils sont plus susceptibles d’attribuer de mauvaises intentions à d’autres groupes. (www.researchgate.net/publication/317777288_Perpetual_ingroup_victimhood_as_a_distorted_lens_Effects_on_attribution_and_categorization) Il est à noter que dans leur étude, même si la majorité des participants étaient des juifs israéliens, il existait encore une variation considérable dans la mesure dans laquelle les gens approuvaient l’orientation victime du groupe. Cela prouve une fois de plus que le fait qu’une personne soit une victime ne signifie pas qu’elle doit se considérer comme telle. La mentalité de victime est différente de celle d’une personne qui a réellement vécu un traumatisme collectif ou interpersonnel, et il existe de nombreuses personnes qui ont vécu le même traumatisme mais refusent de se considérer comme des victimes perpétuelles du groupe. Biais de mémoire Les personnes ayant des tendances plus fortes à la victimisation interpersonnelle ont également un biais de mémoire négatif plus important. Ils se souvenaient davantage de mots représentant un comportement agressif et des sentiments de blessure (tels que « trahison », « colère » et « déception ») et étaient plus susceptibles de se souvenir d’émotions négatives. Les tendances à la victimisation interpersonnelle n’étaient pas associées à des interprétations positives, à des attributions ou à un rappel de mots émotionnels positifs, ce qui suggère plus spécifiquement que les stimuli négatifs activaient un état d’esprit de victimisation. Ces résultats sont cohérents avec des recherches antérieures qui ont montré que la rumination augmente les souvenirs et les perceptions négatifs d’événements dans différents contextes psychologiques. (citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.336.1616&rep=rep1&type=pdf) Au niveau du groupe, les groupes sont susceptibles de reconnaître et de se souvenir des événements qui ont eu le plus grand impact sur eux, y compris les événements au cours desquels le groupe a été lésé par un autre groupe. pardonner Les chercheurs ont également constaté que les personnes qui étaient facilement victimisées dans leurs relations étaient moins disposées à pardonner à leurs agresseurs après avoir été blessées, exprimaient un désir de vengeance plus fort lorsqu'elles l'évitaient et étaient en fait plus susceptibles de riposter. Les chercheurs suggèrent qu’une explication possible des faibles tendances d’évitement est que les personnes qui obtiennent des scores plus élevés en matière de tendances à la victimisation interpersonnelle ont un besoin plus élevé d’approbation. Il est important de noter que cet effet était médiatisé par la perspective cognitive, qui était associée négativement à la victimisation interpersonnelle. Des résultats similaires ont été observés au niveau du groupe. Des sentiments plus forts de victimisation collective étaient associés à une moindre volonté de pardonner et à un plus fort désir de vengeance. Cette conclusion a été confirmée dans différents contextes, notamment à travers l’examen de l’Holocauste, du conflit en Irlande du Nord et du conflit israélo-palestinien. L'origine de la mentalité D’où vient la mentalité de victime ? Au niveau individuel, de nombreux facteurs différents entrent certainement en jeu, notamment les expériences passées de victimisation réelle d’une personne. Cependant, les chercheurs ont découvert que la personnalité d’attachement anxieuse était un antécédent particulièrement fort des tendances à la victimisation interpersonnelle. Les personnes anxieusement attachées ont tendance à compter sur l’approbation et l’affirmation constante des autres. Doutant de leur propre valeur sociale, ils chercheront constamment du réconfort. Cela amène la personne anxieusement dépendante à considérer les autres d’une manière très ambivalente. D’un côté, les personnes anxieusement attachées anticipent le rejet des autres. D’un autre côté, ils ont besoin de compter sur les autres pour valider leur estime de soi et leur valeur. Quant au lien direct entre l'attachement anxieux et la victimisation interpersonnelle, les chercheurs notent que « d'un point de vue motivationnel, la victimisation interpersonnelle semble fournir aux individus anxieusement attachés un cadre efficace pour construire des relations instables avec les autres, y compris la recherche d'attention, de sympathie et d'évaluation de la part des autres, tout en éprouvant et en exprimant des émotions négatives difficiles dans les relations interpersonnelles. » Au niveau du groupe, Gabay et ses collègues soulignent le rôle potentiel des processus de socialisation dans le développement d’une mentalité de victime collective. Ils soulignent que, comme les croyances humaines, la mentalité de victime peut s’apprendre. Grâce à de nombreux canaux différents, tels que l’éducation, les programmes télévisés et les médias sociaux, les membres du groupe peuvent apprendre que le statut de victime peut être utilisé comme un jeu de pouvoir et que l’agression peut être légale et juste même si l’une des parties est lésée. Les gens peuvent apprendre qu’intérioriser une mentalité de victime peut leur donner du pouvoir sur les autres et les protéger de toutes les conséquences du harcèlement et de la honte en ligne qui pourraient être imposés aux membres perçus comme faisant partie du groupe extérieur. (journals.sagepub.com/doi/10.1177/1088868315607800) De la victime à la croissance Le fait est que nous vivons actuellement dans une culture dans laquelle de nombreux groupes et individus politiques et culturels mettent l’accent sur leur statut de victime et participent ensemble aux « Jeux olympiques des victimes ». Charles Sykes, auteur de A Nation of Victims: The Decay of the American Character, soutient que ce phénomène découle en partie du droit des groupes et des individus à rechercher le bonheur et l’épanouissement. S’appuyant sur les travaux de Sykes, Gabay et ses collègues notent que « lorsque ces sentiments de droit sont combinés à des niveaux élevés de tendances à la victimisation au niveau individuel, les luttes pour le changement social sont plus susceptibles de prendre des formes agressives, dégradantes et condescendantes ». Mais voici le problème : si le processus de socialisation peut inculquer une mentalité de victime chez les individus, alors le même processus peut certainement inculquer un état d’esprit de croissance personnelle chez les gens. Et si nous savions dès notre plus jeune âge que nos traumatismes ne doivent pas nous définir ? Après avoir vécu un traumatisme, le sentiment d’être une victime n’est-il pas au cœur de notre identité ? Est-il même possible pour nous de grandir à partir d’un traumatisme et de devenir de meilleures personnes, en utilisant les expériences de notre vie pour essayer d’insuffler de l’espoir et des possibilités à d’autres personnes qui se trouvent dans des situations similaires ? Et si nous réalisions tous que nous pouvons maintenir la fierté d’un groupe sans haïr les autres ? Et si nous réalisons que nous attendons de la gentillesse des autres et que nous devons être plus gentils nous-mêmes ? Et si nous réalisions que personne n’a droit à quoi que ce soit, mais que nous méritons d’être traités comme des êtres humains ? Ce serait un changement de paradigme assez important, mais il serait cohérent avec les dernières avancées en sciences sociales selon lesquelles une mentalité de victime perpétuelle nous amène à voir le monde à travers un filtre. Une fois que nous enlevons le filtre, nous pouvons voir que « ceux qui ne sont pas de mon espèce doivent avoir un cœur différent » n’est pas vrai, et personne dans notre groupe n’est un saint. Nous sommes tous des êtres humains avec les mêmes besoins sous-jacents d’appartenir, d’être vus, d’être entendus, d’avoir un sens à la vie. Voir la réalité aussi clairement que possible est une étape importante vers un changement durable, et je crois qu’une étape importante sur ce chemin consiste à s’éloigner d’une mentalité de victime perpétuelle vers quelque chose de plus productif, constructif, plein d’espoir et prêt à construire des relations positives avec les autres. Par Scott Barry Kaufman Traduit par Sue Relecture/boomchacha Article original/www.scientificamerican.com/article/unraveling-the-mindset-of-victimhood/ Cet article est basé sur une licence Creative Commons (BY-NC) et est publié par Sue sur Leviathan L'article ne reflète que les opinions de l'auteur et ne représente pas nécessairement la position de Leviathan |
>>: Combien de ces rumeurs sur la nutrition des aliments avez-vous crues ?
Recommander des articles
Quels sont les effets et les fonctions du radis vert ?
Les principales fonctions et effets du radis vert...
Comment prévenir et traiter la carence en fer chez les enfants
1. Qu'est-ce que le fer ? Le fer est l’un des...
Quels sont les bienfaits du vin santé Five Elements
Le vin santé Five Elements est un aliment santé r...
Laquelle des 7 postures les plus nocives est la vôtre ?
La santé est le capital de la vie, sans santé tou...
Aujourd'hui c'est l'équinoxe d'automne. Pour prévenir la sécheresse automnale, je vous apprends 5 conseils santé automnaux !
L'équinoxe d'automne est un tournant impo...
Comment choisir un oreiller pour bébé
La qualité de l'oreiller aura un impact direc...
Puis-je fumer avant un examen physique ?
Un examen physique annuel peut vous aider à avoir...
Critique de « Kaleido Star: New Wings » : Quelle est la brillance qui colore ce nouveau chapitre émotionnel ?
Kaleido Star: New Wings - un divertissement émouv...
Que se passe-t-il avec un menton serré et des favoris serrés
Dans la vie, quand les gens sont nerveux, leurs v...
Conférence bimensuelle sur la médecine chinoise | Écorce de Morus alba
· Histoires intéressantes · Le mûrier regorge de ...
Super pratique ! Méthodes d'auto-examen de la santé rénale à collectionner
1. Observez les changements de couleur de l'u...
Maux de tête viraux
Le mal de tête viral fait référence à un mal de t...
Comment traiter efficacement la perforation du tympan
La perforation du tympan est très courante dans l...
Est-il utile de prendre une douche froide quand on a de la fièvre ?
Nous attrapons souvent des rhumes et de la fièvre...