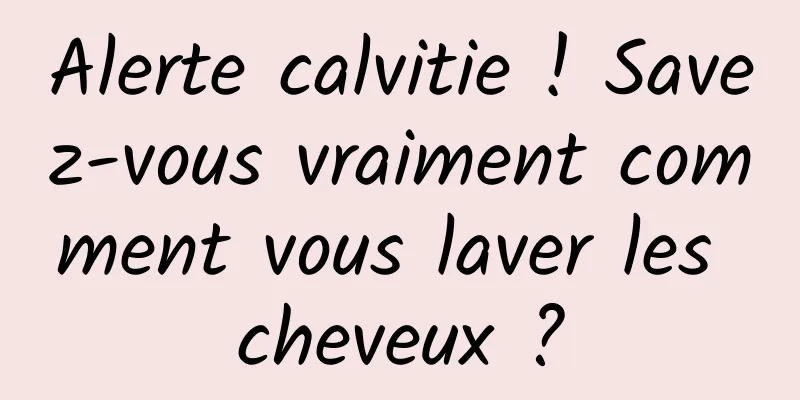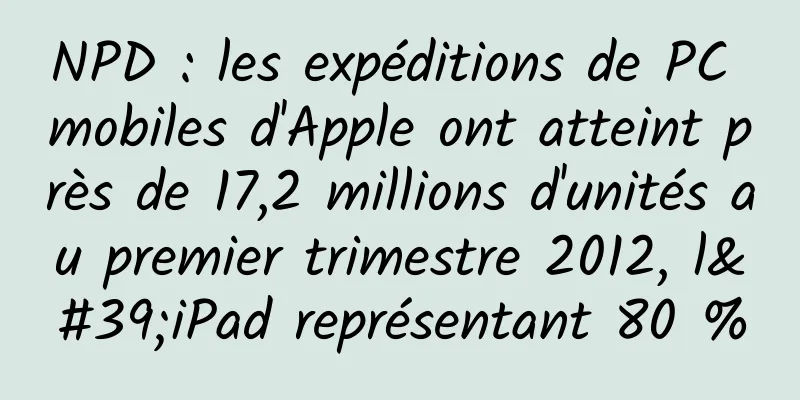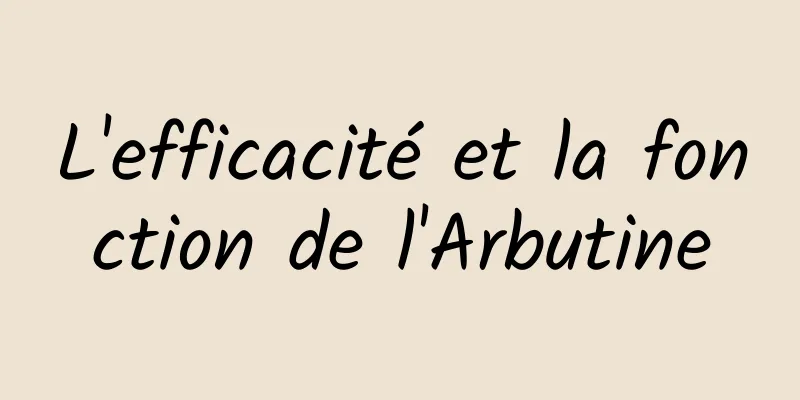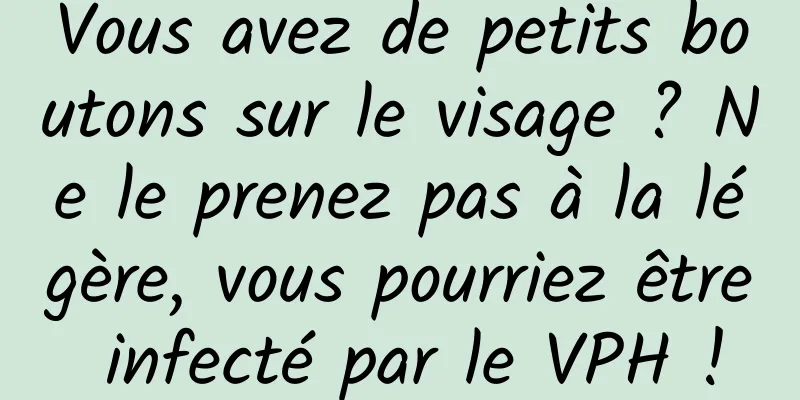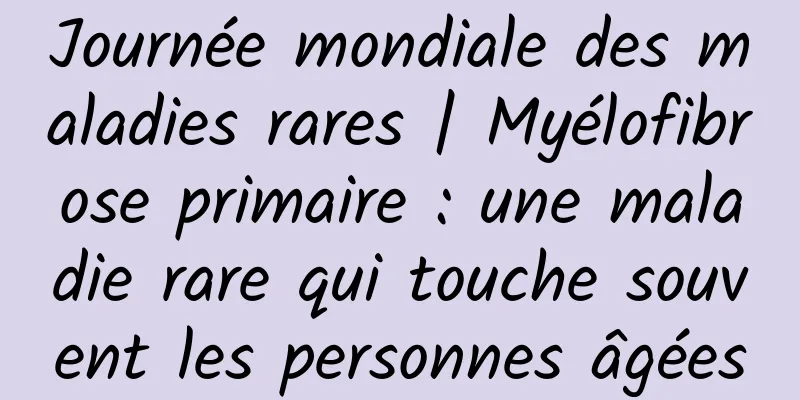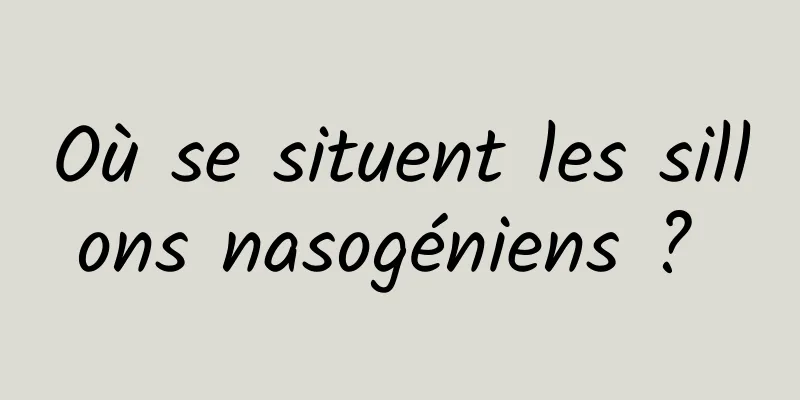Épidémiologie, caractéristiques cliniques, techniques de diagnostic et mesures de prévention et de contrôle de l'infection par le parvovirus de l'oie

|
1 Épidémiologie pathogène. Le parvovirus de l'oie (GPV) est un membre de la famille des Parvoviridae et du genre Parvovirus. Ses caractéristiques biologiques sont similaires à celles du parvovirus du canard de Barbarie. La microscopie électronique a révélé que les particules virales sont rondes ou hexagonales, disposées dans un réseau symétrique icosaédrique, avec un diamètre d'environ 20 à 24 nm. Il n’a pas de capsule et c’est un virus à ADN. Comme le virus n’a pas d’enveloppe, il a une forte capacité à résister à l’environnement. Par exemple, il sera inactivé après avoir été chauffé à 56°C pendant 3 heures et il est insensible à la trypsine, aux détergents et aux conditions de pH bas. Animaux sensibles. Dans des conditions d'infection naturelles, seuls les oisons et les canetons de Barbarie peuvent être infectés, tandis que les autres oiseaux et mammifères ne le seront pas. Les oisons âgés de 3 à 20 jours sont sensibles, et il existe certaines différences dans les taux d'incidence et de mortalité parmi les oies d'âges différents, avec des conditions immunitaires différentes et dans différentes régions, mais plus l'âge de la maladie est jeune, plus le taux de mortalité est élevé. Voies de transmission. La maladie se transmet principalement par voie fécale-orale, c'est-à-dire que le principal mode de transmission de la maladie est le contact direct avec des oies malades ou la transmission mécanique par le biais d'aliments contaminés par des virus, d'ustensiles, d'œufs de reproduction, etc. 2 Symptômes cliniques et modifications à l'autopsie 2.1 Symptômes cliniques Pour les oisons de moins de 15 jours, qu'ils soient infectés naturellement ou artificiellement, la période d'incubation est généralement de 3 à 5 jours ; pour les oisons sensibles âgés de plus de 15 jours, qu'ils soient infectés naturellement ou artificiellement, la période d'incubation est de 1 à 2 jours plus longue que la précédente. La maladie provoque principalement des symptômes au niveau des systèmes digestif et nerveux des oies malades. Selon la durée de la maladie, elle peut être divisée en trois types, à savoir le type le plus aigu, le type aigu et le type subaigu. Le type le plus aigu. La maladie est plus fréquente chez les oisons de moins de 7 jours, qui se développent souvent soudainement et meurent rapidement. Ils s'affaiblissent généralement quelques heures après être devenus déprimés, ou tombent au sol, les jambes en l'air, et meurent rapidement. De plus, les oisons malades présentent une petite quantité de sécrétions séreuses dans leurs narines, qui peuvent se propager à l'ensemble du troupeau en quelques jours seulement. Type aigu. Elle est plus fréquente chez les oisons âgés de 7 à 14 jours. Après être tombé malade, les principaux symptômes sont la dépression, la perte d’appétit ou même l’insomnie complète. Après environ 12 heures, les oies malades ont souvent l'air ternes, le cou rétracté et les yeux fermés, et se déplacent lentement et faiblement. Ils sont incapables de se tenir debout de manière stable et s'accroupissent souvent. Ils arrêtent de manger mais boivent plus d'eau et excrètent des excréments liquides jaune-vert ou jaune-blanc, les excréments étant attachés à l'anus. De plus, les oies malades respirent la bouche ouverte, leurs narines sont sales, leur bec est cyanosé, leurs pattes palmées sont de couleur terne, leur jabot devient mou et contient du liquide et des bulles, leur corps se déshydrate, leur conjonctive devient sèche et elles finissent par mourir de choc. Ils souffrent de convulsions ou de paralysie des jambes avant de mourir, et l'évolution de la maladie dure généralement environ 2 jours. Type subaigu. Elle apparaît généralement à un stade avancé d’une épidémie et est plus susceptible de se produire chez les oisons âgés de plus de 14 jours. Après être tombés malades, ils présentent une apathie, une alimentation réduite ou arrêtée, des sécrétions dans les narines, des mouvements lents, une incapacité à se tenir debout de manière stable, souvent accroupis, accompagnés de diarrhée et de matières fécales contaminant la zone autour de l'anus. L’évolution de la maladie dure un peu plus longtemps, généralement de 3 à 7 jours ou plus, et peut guérir d’elle-même. 2.2 Les changements observés lors de l'autopsie sont principalement des lésions intestinales, c'est-à-dire que tous les segments de l'intestin grêle sont congestionnés et gravement gonflés, avec une grande quantité de mucus, une petite quantité d'exsudat cellulosique jaune-blanc en forme de goutte d'œuf sur la muqueuse et une couche de pseudomembrane jaune clair recouvrant les segments intestinaux moyens et inférieurs. Parfois, de fines bandes de coagulants peuvent être observées, ce qui donne à l'intestin grêle une lésion en forme de « saucisse ». Le type le plus aigu. L'autopsie a montré que la muqueuse duodénale était diffusement rouge en raison de la congestion et qu'il y avait une grande quantité de mucus à la surface. Type aigu. L'autopsie a révélé des lésions caractéristiques dans l'intestin, principalement dans les segments moyen et inférieur de l'intestin grêle, en particulier les segments intestinaux proches de la région iléo-caecale et de la tige du sac vitellin, qui étaient manifestement d'apparence élargie, atteignant souvent 3 à 4 fois le volume d'un segment intestinal normal, et étaient en forme de saucisse et fermes au toucher. Après avoir ouvert la paroi intestinale au niveau de la partie bombée, on a constaté que la paroi intestinale était devenue plus fine et tendue, et qu'il y avait des emboles coagulés jaune clair ou blanc grisâtre clair dans la cavité intestinale. Ils étaient composés d'exsudat fibrineux coagulé et de tissu muqueux intestinal nécrotique, provoquant le blocage complet de la cavité intestinale. Type subaigu. L'autopsie montre principalement une entérite catarrhale aiguë, le foie étant jaune-rouge ou rouge-violet foncé et hypertrophié, la vésicule biliaire considérablement hypertrophiée et contenant une grande quantité de bile vert foncé ; la rate et le pancréas sont congestionnés et il y a parfois des taches nécrotiques gris-blanc. 3 Techniques de diagnostic en laboratoire 3.1 Techniques de diagnostic sérologique Test de neutralisation virale. Le principe de base est la réaction antigène-anticorps, c'est-à-dire qu'une fois que l'anticorps correspondant se lie au site clé du virus, il ne peut pas s'adsorber et infecter normalement, et ne peut donc pas provoquer d'effet cytopathique (CPE). Il s’agit de la méthode de diagnostic sérologique la plus couramment utilisée. Dosage immuno-enzymatique (ELISA). Cette méthode est actuellement l’une des technologies de détection les plus couramment utilisées dans le domaine de la biologie et a progressivement été utilisée comme moyen de routine pour détecter les agents pathogènes répandus chez les animaux. Cette technologie présente les avantages d’une bonne sécurité, d’un fonctionnement simple, d’une sensibilité élevée et de résultats rapides. Les méthodes couramment utilisées comprennent le test ELISA double sandwich et le test ELISA spot. Il faut généralement seulement 3 à 4 heures pour établir un diagnostic, ce qui est adapté au diagnostic précoce chez les oies. Cependant, comme cette technologie nécessite la préparation d’anticorps monoclonaux, sa promotion clinique dans les cliniques vétérinaires primaires est soumise à certaines limitations. Méthode de diagnostic par immunofluorescence. La méthode comprend la méthode de fluorescence directe et la méthode de fluorescence indirecte. Parmi elles, la méthode de fluorescence directe est la méthode d’inspection la plus couramment utilisée en laboratoire. Il s'agit de marquer des pigments fluorescents sur des anticorps ou des antigènes et de les utiliser pour une réaction antigène-anticorps. Il se caractérise par une sensibilité élevée, une bonne spécificité et une consommation de temps courte. Cependant, en raison du problème de coloration non spécifique, les résultats du jugement sont relativement subjectifs. La méthode d'immunofluorescence indirecte consiste à transformer le matériel malade à tester en morceaux ou en tranches tactiles, puis à ajouter respectivement des sérums anti-GPV négatifs et positifs standard, et enfin à ajouter des anticorps secondaires marqués par fluorescence pour le développement de la couleur, mais elle nécessite l'utilisation d'un microscope à fluorescence. Technologie d'immunochromatographie à l'or colloïdal. Cette technologie a été appliquée dans de nombreux aspects des tests. Ses avantages sont une utilisation simple, aucun besoin d’instruments complexes, une forte spécificité, une sensibilité élevée et des résultats de test intuitifs. 3.2 Technologie de détection en biologie moléculaire : technologie PCR. Cette technologie est la méthode de détection la plus sensible parmi les différentes technologies de diagnostic virologique actuellement disponibles. Ses avantages sont une bonne spécificité et la capacité de détecter un grand nombre d’échantillons à la fois sans avoir besoin d’isoler et de purifier le virus. Technique d'hybridation in situ. Cette technologie utilise une sonde ADN GPVSS marquée à la digoxine pour détecter le parvovirus de l'oie. Cela est dû au fait que la sonde ne peut réagir positivement qu'avec l'acide nucléique du virus, mais ne réagira pas avec le liquide allantoïdien de l'embryon d'oie, le tissu embryonnaire normal de l'oie, le foie de l'oie et d'autres tissus. Il présente donc une sensibilité très élevée et une forte spécificité. De plus, cette technologie permet de détecter avec précision et rapidité la présence d’acide nucléique du parvovirus de l’oie avec une répétabilité élevée. Technique d'amplification isotherme circulaire. Le point clé de cette technologie est de concevoir 4 amorces spécifiques pour les 6 régions du fragment cible, et d'amplifier efficacement le fragment cible à l'aide de l'ADN polymérase à déplacement de chaîne dans des conditions de température constante d'environ 65°C. Ses avantages sont une utilisation simple, une sensibilité élevée, une forte spécificité et une consommation de temps courte. Il ne nécessite aucun instrument coûteux et ne nécessite qu'un bain-marie pour terminer l'opération. Il est généralement applicable au diagnostic en laboratoire dans les services vétérinaires de base et au diagnostic clinique sur le terrain. 4 Mesures de prévention et de contrôle 4.1 Gestion des épidémies Les oies malades doivent être isolées immédiatement après leur découverte. Les oies mortes doivent être enterrées profondément. Nettoyez d'abord le poulailler, puis rincez à l'eau haute pression, puis vaporisez une solution d'hydroxyde de sodium à 2 % pour la désinfection. En même temps, faites tremper les mangeoires et les abreuvoirs dans une solution de permanganate de potassium à 1 % pour les désinfecter. Les oies doivent également être désinfectées au moins 3 fois par semaine pendant 2 semaines. Pour les oisons qui ne sont pas malades, 0,5 à 0,8 ml d'antisérum à titre élevé ou 1,0 ml d'anticorps de jaune d'œuf raffiné peuvent être injectés par voie sous-cutanée pour chaque oison. Notez qu’une quantité appropriée d’antibiotiques à large spectre peut être ajoutée à l’anticorps sérique ou au jaune d’œuf. Pour les oisons malades, 1,0 mL d’antisérum à titre élevé ou 1,5 mL d’anticorps de jaune d’œuf raffiné peuvent être injectés par voie sous-cutanée pour chaque oison. En même temps, 4 g de boisson multivitaminée électrolytique peuvent être ajoutés par kilogramme d'eau potable. Cela peut augmenter le taux de guérison et réduire l’apparition du stress. 4.2 Vaccination Actuellement, le principal moyen de prévenir l’apparition de cette maladie est d’immuniser les oies avec le vaccin contre le parvovirus de l’oie. On peut utiliser à la fois un vaccin vivant et un vaccin inactivé. Parmi eux, le vaccin inactivé présente les avantages de la sécurité, de la facilité de stockage et de la longue période d’immunité, et convient à l’application clinique. Programme de vaccination recommandé : Les oies reproductrices doivent recevoir la première vaccination 20 jours avant la ponte et la deuxième vaccination à 120 jours d'âge, chaque oison recevant 1 ml de vaccin à chaque fois ; les oisons doivent recevoir la première vaccination à l'âge de 3 jours, chaque oison recevant 0,5 ml de vaccin, et la deuxième vaccination à l'âge de 90 jours, chaque oison recevant 1,0 ml de vaccin. Pour les oisons sans anticorps maternels, étant donné qu'il y aura une période sans anticorps, il est préférable d'utiliser du sérum hautement immun ou des anticorps jaunes après l'éclosion pour prévenir la maladie. |
>>: Comprendre correctement le « sac de richesse »
Recommander des articles
Points d'acupuncture sur le gros orteil
Les personnes qui trempent régulièrement leurs pi...
Comment vérifier les problèmes neurologiques
Les problèmes neurologiques sont un problème rela...
Que se passera-t-il si vous mangez de l'eau florale
L'eau florale contient des médicaments tradit...
Comment est l'Université nationale de Chonbuk ? Évaluation de l'Université nationale de Chonbuk et informations sur le site Web
Quel est le site Web de l'Université nationale...
Comment nettoyer les prothèses dentaires amovibles
De nombreuses personnes posent des prothèses dent...
Série « La santé par l’alimentation » | Les nouilles instantanées sont-elles de la « malbouffe » ? Quatre malentendus à connaître
Depuis que les nouilles instantanées ont été inve...
Prêter attention à la gestion du poids chez les patients atteints de schizophrénie | Journée mondiale de la santé mentale
La schizophrénie est un groupe de troubles mentau...
Est-il acceptable de manger des palourdes pendant la grossesse ? Quelles sont les précautions à prendre pour consommer des palourdes pendant la grossesse ?
Nous savons tous qu’il y a beaucoup de choses aux...
Peux-tu serrer ton meilleur ami dans tes bras ? Quels sont les effets d’un câlin envers son meilleur ami ?
C'est rare d'avoir un véritable ami dans ...
Critique de « Ma femme est une lycéenne » : un drame où la jeunesse et la famille se croisent
« Ma femme est une lycéenne » - Une comédie roman...
Comment se remettre d'une tension à l'aine, éviter les exercices intenses
Les tensions à l'aine sont courantes, en part...
Les effets et les fonctions du clou de girofle cannelle
Le clou de girofle et la cannelle sont deux alime...
Dois-je prendre de la vitamine C après ou avant les repas ?
Les vitamines jouent un rôle très important dans ...
Sept conseils pour être à l'heure au quotidien
1. Passez un examen physique régulier De nombreus...